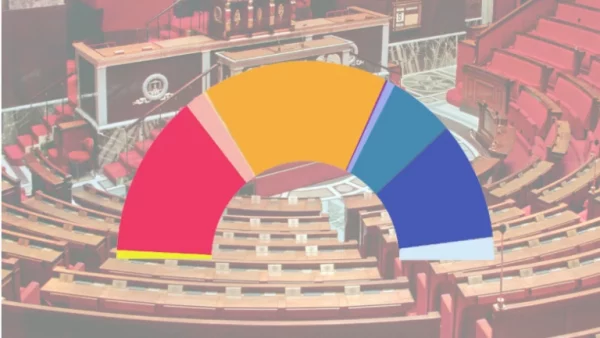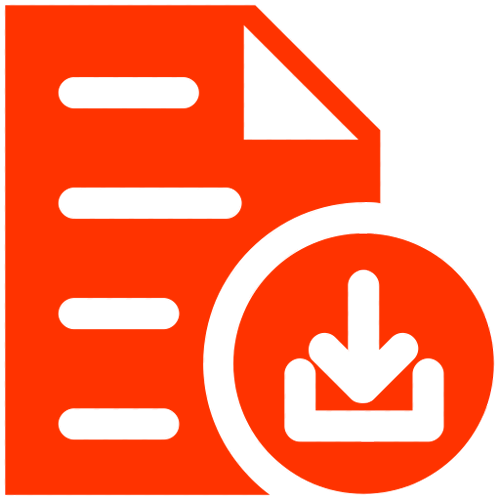Raymond Aron cancellé

Rédactrice en chef Idées à L’Express et essayiste, elle est notamment l'auteur de De la France : ce pays que l'on croyait connaître (2022).

Dans sa contribution à notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Laetitia Strauch-Bonart loue son désir de précision et son éthique intellectuelle. Revenant sur l’isolement dont il a été fréquemment victime, elle estime que ses positions se sont révélées clairvoyantes.
« Comme d’habitude, je n’étais pas d’accord. Je suis donc resté solitaire. »
Raymond Aron, Le Spectateur engagé
Il ne fait pas bon être libéral en France. Il ne fait pas bon, non plus, l’avoir été. Outre la méfiance que suscite la pensée libérale auprès des tenants d’un État fort ou interventionniste, trois destins attendent aujourd’hui les grandes figures intellectuelles du libéralisme : l’oubli, la diabolisation ou ce qu’on pourrait appeler la consensualisation. Le fin penseur qu’était Raymond Aron se trouve dans ce dernier cas. Comme Benjamin Constant, comme Alexis de Tocqueville, Aron est certes souvent invoqué mais d’autant plus qu’il n’est plus guère lu. La gauche le tolère, le cite même, ce qui en dit long ; la droite lui rend vaguement hommage ; les journalistes et les étudiants le mentionnent. Cet Aron-là plaît à tout le monde parce qu’il n’est véritablement connu de personne.
Cette ignorance relative, qui fait perdurer le mythe d’un personnage lisse et tiède, fait dans le même temps oublier que son souci permanent de justesse provoqua bien souvent l’ire de ses contemporains, y compris, on tend à l’oublier, à droite. En l’espèce, il fut plus qu’à son tour, dans un milieu et à une époque non exempts de grégarisme, solitaire. Ainsi, sa consécration méritée, en fin de carrière, ne doit pas masquer l’isolement qu’il a fréquemment subi – un fait malheureux que d’aucuns nomment volontiers aujourd’hui, comme s’il s’agissait d’un phénomène nouveau, la « cancel culture ».
Raymond Aron obtient son doctorat en 1938. Sa thèse, qui sera publiée sous le titre Introduction à la philosophie de l’histoire, s’avère déjà en rupture avec le positivisme qui domine la philosophie française. Politiquement, il signale déjà son originalité. « Une fois de plus, expliquera-t-il plus de quarante ans plus tard, comme d’habitude dans ma vie, j’étais dans un petit groupe, solitaire, entre les blocs, c’est-à-dire entre le bloc de ceux qui étaient déchaînés contre le Front populaire, et ceux qui croyaient que c’était une aube nouvelle de la société… » Pour autant, il ne cautionne pas « la politique antérieure ; je la trouvais parfaitement déraisonnable également, dans l’autre sens ». Sans compter qu’« une bonne partie de la droite, celle des hebdomadaires Je suis partout, Candide, Gringoire, qui étaient horribles, une droite extrême, me rendait non seulement de gauche mais fou furieux ». Alors qu’il s’inquiète, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, de la mésentente croissante entre Français de gauche et de droite, il se retrouve entre les deux, « sans grande chance de pouvoir m’exprimer et d’être écouté » (1).
« Il ne fait pas bon être libéral en France. Il ne fait pas bon, non plus, l’avoir été. »
Lorsqu’il rejoint Charles de Gaulle à Londres, Aron fait preuve de la même distance critique, ce qui rend difficile son rattachement au mouvement gaulliste sans pourtant en faire l’un de ses opposants. « Si être gaulliste c’était être le féal du général de Gaulle, ou croire en lui quelles que fussent ses opinions, alors, en effet, je ne l’étais pas ». Même face à la guerre, il se refuse à être « dans l’extrême », ce qui le condamne, constate-t-il, à l’écriture et à isolement (1).
A la fin de la guerre, Aron s’oriente vers le journalisme plutôt qu’une carrière universitaire – décision qu’il regrettera plus tard – et finit par rejoindre Le Figaro comme éditorialiste. Il s’engage de surcroît, en 1947, au Rassemblement du Peuple Français (RPF), le tout nouveau parti gaulliste. Autant de choix qui dénotent une personnalité singulière, avide d’action autant que de pensée. Mais comme il ne s’engage pas à gauche comme il est d’usage, il en devient, selon les termes de son biographe Nicolas Baverez, un « homme seul » et un « intouchable, banni par ses pairs ». « La violente réaction de rejet dont il fut victime, ajoute Baverez, se traduisit par l’échec de sa candidature à une chaire de philosophie de la Sorbonne en 1948 ». (2) Il y sera finalement élu en 1955, non sans obstacles. Commentant cette période, Aron usera de l’euphémisme : « Je me sentais solitaire, dépouillé de mes amitiés de jeunesse. Bien entendu, je recevais aussi beaucoup de lettres de félicitations, mais j’y étais peu sensible parce qu’elles provenaient d’hommes qui m’étaient trop étrangers. Mais c’est vrai, je n’étais pas bien toléré par l’intelligentsia française dans cette période. (…) J’étais un homme de droite, j’écrivais dans Le Figaro, etc. » (1)
Aron fait d’autant plus grincer des dents parmi les intellectuels que la guerre froide bat son plein. Sa ferme défense de l’Alliance atlantique lui aliène un large spectre de politiques et d’intellectuels. En 1951, la sortie de ses Guerres en chaîne, où il montre qu’entre les deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, la paix est impossible mais la guerre improbable, provoque un véritable « tir de barrage ». « Aron, relate Baverez, dut alors affronter une sainte alliance des communistes, des progressistes et des neutralistes, qui marqua son complet isolement. » Une fausse rumeur, propagée par le philosophe et neutraliste Etienne Gilson, le présente comme un agent payé par les Etats-Unis. Ostracisme et intolérance règnent tout autant à l’Institut d’études politiques où il enseigne de 1948 à 1954 et où ses idées sur le marxisme, la guerre froide et la IVè république « heurtaient de front le catéchisme progressiste » de la quasi-totalité des autres enseignants. Sa candidature implicite à un poste de professeur fut écartée avec élégance » (2).
Dévasté par le décès brutal de l’une de ses filles en 1950, il devient, poursuit son biographe, « un solitaire, rejeté par l’université et enfoui dans sa peine » (2). Il publiera dans cette période l’un de ses chefs-d’œuvre, L’Opium des intellectuels, en 1955, où il soutient qu’il est impossible de constater l’existence du goulag sans devenir anticommuniste dans le même temps. Sa cible n’est pas tant les intellectuels communistes que « mes amis qui reconnaissent l’existence des camps de concentration, qui ne sont pas communistes mais qui ne veulent pas être anticommunistes », comme Sartre à cette époque. Il épingle ce « mouvement intellectuel dont il n’y a guère eu l’équivalent ailleurs » faits de « ceux qui étaient entre les deux, qui étaient à tel point attirés par le prolétariat, le socialisme, l’histoire, la révolution, la gauche, qu’ils n’acceptaient pas les conséquences de la rupture avec le communisme » et qui, partant, « ne pouvaient admettre que la rupture avec l’Union soviétique conduisît nécessairement à mon chemin, c’est-à-dire à accepter l’Alliance atlantique et la coalition des anticommunistes » (1).
Son anti-communisme aurait pu en faire la coqueluche de la droite non-gaulliste. Il n’en est rien car Aron s’en prend à l’une de ses vaches sacrées, l’Algérie française. Convaincu dès l’après-guerre que « la décolonisation, d’abord, était inévitable, ensuite qu’elle était conforme aux valeurs que les Occidentaux défendent » (1), autrement dit, pour reprendre des termes aroniens, que l’existence de colonies n’est plus ni « possible » ni « souhaitable », il approfondit l’argument dans La Tragédie algérienne qu’il publie en 1957. L’ouvrage « provoqua un réel séisme politique, relate Baverez. Aron s’aliéna la droite – prompte à s’élever contre la trahison de l’auteur de L’Opium (…) -, mais aussi la gauche – qui dénonçait sous la plume de Jean Daniel « le passage du conservatisme au défaitisme » (2).
A droite, les attaques sont rudes. Il se trouve alors en contradiction avec la ligne du journal dont il est éditorialiste. On l’accuse de faire le jeu du FLN, on s’étouffe lorsqu’il explique que « la politique de la France ne pouvait pas être déterminée par un million de Français d’Algérie », on prétend qu’il voudrait « mettre les Français d’Algérie dans des camps de concentration » (1). Jacques Soustelle, gouverneur général de l’Algérie au début de la guerre en 1955-1956 et fervent partisan de l’Algérie française, publie peu après La Tragédie algérienne une brochure au titre évocateur, Le Drame algérien et la décadence française, réponse à Raymond Aron. Ces échauffourées livresques masquent la popularité de la position aronienne. Pour une fois, Aron est l’homme de la majorité silencieuse puisqu’il exprime publiquement « ce que la majorité des Français et la quasi-totalité de la classe politique pensaient sans oser se l’avouer » (2). Il commentera modestement deux décennies plus tard : « J’ai eu une influence très limitée, mais j’ai apporté, si je puis dire, aux hommes politiques modérés une représentation générale du monde qui justifiait leur politique » (1).
« L’anti-communisme de Raymond Aron aurait pu en faire la coqueluche de la droite non-gaulliste. Il n’en est rien car Aron s’en prend à l’une de ses vaches sacrées, l’Algérie française. »
La reconnaissance universitaire tant attendue advient pendant la décennie 1960 puisqu’il devient directeur d’études à l’École pratique des hautes études. Point de retrouvailles, en revanche, avec la communauté intellectuelle en raison de ses prises de position, philosophique et politique, face à l’événement qui donnera un nouveau souffle à la gauche, mai 1968. Dans La Révolution introuvable, publiée la même année, il cherche à donner un sens sociologique à l’épisode, loin du mythe d’une jeunesse révolutionnaire salvatrice. Il prend position, par un certain nombre d’articles publiés en mai dans Le Figaro, contre « le terrorisme du pouvoir étudiant » qui souhaite s’immiscer dans la gouvernance de l’université. Ici, Aron, ne s’aliène pas seulement les usual suspects comme Sartre lequel, sous prétexte d’appeler Aron à pratiquer l’autocritique – un professeur doit savoir, selon la novlangue de l’époque, « se contenter » – frise l’insulte en proclamant qu’« il faut (…) que les étudiants puissent regarder Raymond Aron tout nu » (2) ; des hommes plus modérés, tels Pierre Hassner et François Furet, prennent leurs distances face à un positionnement qu’ils jugent trop sévère (2).
Quant aux gaullistes, il conservera avec eux une relation ambivalente. Bien que dans l’ensemble favorable à la politique étrangère gaullienne, il en critiquera de plus en plus le style, notamment la rhétorique anti-américaine, qu’il juge illusoire et dangereuse. De façon similaire, s’il est satisfait du retour du général de Gaulle en 1958, il n’oubliera pas de remarquer que celui-ci s’est trouvé « à la limite du coup d’État » quand il est revenu au pouvoir.
Dans les années 1970, Aron a réalisé la prédiction de Malraux qui avait auparavant annoncé à son ami : « Attendez, attendez, quand vous aurez soixante-dix ans, ça s’arrangera, on vous reconnaîtra » (2). Au soir de sa vie, il reconnaîtra que ses idées ont marqué maints universitaires et hommes politiques. Pour autant, non seulement il « n’y a pas une secte aronienne », jugera-t-il, mais il dira rester « isolé et opposant, destin normal d’un authentique libéral » (1).
Selon les propres explications du philosophe, son isolement venait de son adoption d’« un certain nombre d’attitudes » (1). Ce dernier terme, polysémique, peut se référer au contenu même de ses positions, mais aussi, et c’est ce point que nous voudrions explorer, à la méthode aronienne menant à leur formulation.
Comme le titre du livre d’entretiens accordé par Aron à Jean-Louis Missika et Dominique Wolton en 1981 l’indique, Aron se voulait un « spectateur engagé ». « La volonté de voir, de saisir la vérité, la réalité, d’un côté, et de l’autre côté agir : ce sont, me semble-t-il, les deux impératifs auxquels j’ai essayé d’obéir toute ma vie », développe-t-il (1). Cette formule, qui se distingue de l’engagement au sens sartrien, lie ensemble la pensée et l’action de telle sorte que, si l’on ne peut pas bien agir sans avoir pensé au préalable, on ne peut pas non plus bien penser si l’on n’a pas l’action en ligne de mire. La pensée, en d’autres termes, est bornée par ce qu’Aron nomme le réel ou la réalité. Le réel oblige, autrement dit, il impose une éthique intellectuelle qui se distingue du réflexe idéologique. Décrivant les « intellectuels », Aron remarque qu’ « ils sont inquiets, angoissés par ce que notre régime existant comporte de mal (et tous les régimes comportent du mal), (qu’)ils sont assoiffés de la solution qui donnerait la société universalisable. Ils ont bien une opinion sur ce qu’il faut faire contre l’inflation ou au sujet du réarmement de l’Allemagne, mais c’est essentiellement des opinions à partir d’impératifs ou de postulats et non pas à partir d’une analyse de la conjoncture ». Or analyser la conjoncture, c’est vouloir produire un raisonnement adapté à chaque situation, c’est faire du sur-mesure, c’est être mesuré, non pas au sens de la tiédeur mais de l’exactitude. Ou encore, « avoir des opinions politiques, ce n’est pas avoir une fois pour toutes une idéologie, c’est prendre des décisions justes dans des circonstances qui changent » (1).
Cette éthique, dans le paysage politico-intellectuel de son époque, était rare. D’abord parce que nombre de politiques et intellectuels, à gauche mais aussi à droite, pétris d’idéologie, ne se préoccupaient que du « souhaitable » et non du « possible ». Ensuite parce qu’en passant d’un camp à l’autre en fonction des changements de circonstances, Aron se démarquait de ses camarades qui privilégiaient la loyauté clanique. Avoir Aron de son côté pour un temps ne signifiait pas avoir gagné son soutien en toutes circonstances. « Quand je vote, je vote pour Giscard d’Estaing et non pas pour Mitterrand, commentait-il. Donc si on définit la place d’un intellectuel par ses votes, je suis un intellectuel de droite, mais d’un caractère un peu particulier, c’est-à-dire indiscipliné et rarement d’accord avec celui pour lequel il a voté. Je critique avec la même liberté l’homme pour lequel j’ai voté que je le ferais si l’autre était élu. » (1) Pour le dire autrement, il était libre.
« Avoir Aron de son côté pour un temps ne signifiait pas avoir gagné son soutien en toutes circonstances. »
Au vu de la trajectoire d’Aron et de son influence intellectuelle posthume, nous savons aujourd’hui que son isolement n’a pas empêché sa réussite. Mieux, la plupart de ses positions, choquantes à l’époque pour certains, apparaissent rétrospectivement comme celles qu’il fallait adopter pour préserver la concorde nationale. Le temps a fait son œuvre et révélé, progressivement, la clairvoyance aronienne. Nous pouvons en tirer, pour le présent, une leçon. Tous les penseurs atypiques et isolés ne deviennent pas des Aron, mais en pensant atypiquement et en acceptant la solitude qui accompagne l’honnêteté intellectuelle, en refusant la logique clanique, on n’est pas seulement plus libre, on met toutes les chances de son côté pour, même beaucoup plus tard, avoir raison.
Pour lire notre recueil en intégralité, cliquer ICI.
Sources :
- (1) Raymond Aron, Le Spectateur engagé. Entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton, Paris, Julliard, 1981
- (2) Nicolas Baverez, Raymond Aron. Un moraliste au temps des idéologies, Tempus, 2006 Raymond Aron, Mémoires. 50 ans de réflexion politique, Julliard, 1983 Raymond Aron, L’Opium des intellectuels, Calmann-Lévy, 1955