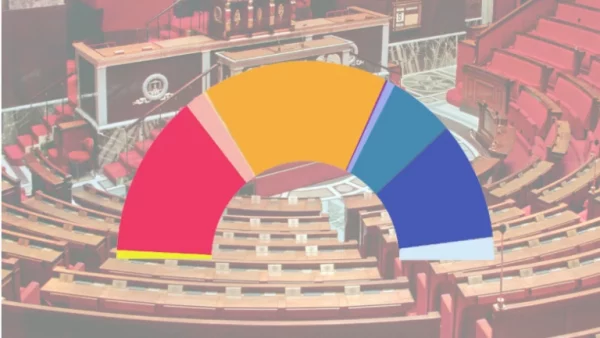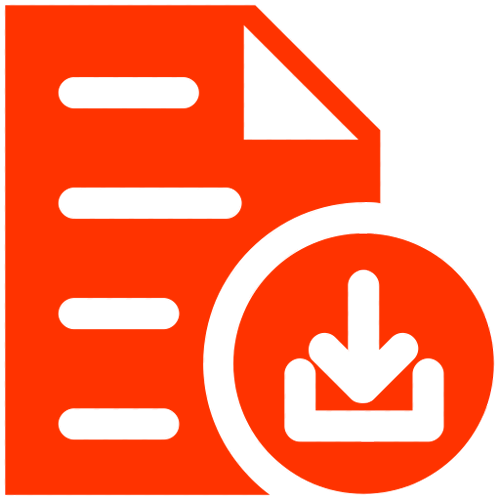Raymond Aron, entre sociologie et philosophie

Professeur en philosophie politique à l'Université Panthéon-Assas, il est notamment l'auteur de La Laïcité, Histoire d'une singularité française (2019).

Dans sa contribution à notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Philippe Raynaud analyse la dimension sociologique des œuvres de l’intellectuel. Il y décrit l’influence majeure de Weber et de Montesquieu dans le lien que Raymond Aron tisse entre sociologie, libéralisme et philosophie politique.
Au cours des dernières décennies, l’œuvre de Raymond Aron a gardé un prestige certain et on pourrait même dire que sa pensée jouit aujourd’hui dans les milieux académique et intellectuel d’une légitimité plus forte que ce n’était le cas de son vivant. Mais cette reconnaissance tardive a aussi quelque chose de paradoxal ; elle concerne pour l’essentiel l’analyste politique, dont on reconnaît enfin la lucidité supérieure et dont, chez les meilleurs, on perçoit que cette lucidité est intimement liée à une certaine attitude philosophique, mais elle fait assez peu de place à la qualité de « sociologue » qu’Aron n’a pas cessé de revendiquer tout au long de sa carrière académique. Aron apparaît aujourd’hui comme un penseur politique de premier plan, dont les vrais philosophes politiques reconnaissent la profondeur, mais ne semble pas qu’il soit considéré comme un des « classiques de la sociologie ».
La récente publication de ses cours au Collège de France de 1970-1971 et 1971-1972 (1) peut être l’occasion de revenir sur ce que la « sociologie » signifiait pour Aron. Dans ses Mémoires, il est lui-même très sévère pour cette critique de la pensée sociologique, dont le but était d’esquisser une suite des Étapes de la pensée sociologique, qui aurait étudié le devenir intellectuel (et institutionnel) de la sociologie après la génération des fondateurs (Comte, Marx, Tocqueville) et celle des classiques (Durkheim, Pareto, Weber) : « Je manquais totalement ce cours ; tout au plus m’a-t-il aidé à apercevoir ce que devait être cette critique (2) ». Cette sévérité me paraît très excessive, car ce cours est riche en analyses subtiles et originales sur quelques grandes questions classiques (l’histoire de la notion de « critique » de Kant à Marx, la naissance de la sociologie, le devenir de l’héritage de Marx chez Pareto et Weber) tout en donnant une vue très juste des controverses d’une sociologie qui est supposée être arrivée à maturité « scientifique » mais qui reste traversée par des divisions nombreuses. Il me semble en fait que la déception d’Aron devant les résultats de son propre enseignement traduit sous une forme trop modeste sa déception devant ce qu’on pourrait appeler les «désillusions du progrès scientifique ».
« La sociologie de Raymond Aron est inséparable d’un certain libéralisme , qui est lui-même fondé sur une philosophie politique. »
D’un côté, en effet, il semble difficile de ne pas transposer à la sociologie ce qu’Aron dit de la science économique : « Dans la mesure où l’on admet l’existence d’une telle science, il est impensable qu’elle ait pu être formulée de façon définitive aux environs des années 1860 (3) et qu’un siècle après, en dépit du fait que des milliers d’esprits supérieurs ont étudié les problèmes de l’économie, ils n’aient rien ajouté, ni comme schémas abstraits, ni comme analyses concrètes (4) ». La sociologie a sans doute connu des progrès comparables, mais, d’un autre côté, ceux-ci laissent toujours les lecteurs insatisfaits pour des raisons dont on voit mal comment elles pourraient être surmontées. La sociologie reste divisée en trois « tendances », qui étaient déjà présentes chez les « fondateurs » et chez les « classiques ». Elle peut mettre l’accent sur « la recherche de la communauté en fonction de la prise de la conscience de la désagrégation des sociétés traditionnelles » ; elle peut se présenter comme une « critique sociale par le contraste entre les idées dont se réclame la société moderne et la réalité dont celle-ci nous offre le spectacle » ; elle peut, enfin, chercher à « interpréter historiquement la société moderne ». Mais la permanence de ces questions fondamentales, qui étaient au centre des projets de Comte et de Durkheim, de Marx et de Tocqueville ou de Marx et Weber, s’accompagne aujourd’hui d’un scepticisme général et sans doute justifié sur la possibilité d’une « théorie unitaire de la société » – qui semble bien avoir été le projet qui animait secrètement les « fondateurs » et les « classiques ».
Cette reconnaissance quelque peu désenchantée des limites de la connaissance sociologique conduit, comme le fait du reste Aron vers la fin de son cours, à reconnaître une certaine proximité entre la sociologie et la philosophie : « Donc la philosophie a bien quelque chose de commun avec la philosophie. Léon Brunschvicg a écrit en petit livre, De la connaissance de soi, qui commence par une citation de Pascal ; la sociologie pourrait avoir d’une certaine manière pour titre : La connaissance de soi. La sociologie est une forme de connaissance de soi, à condition de ne pas oublier que la seule façon de se connaître comme soi, c’est de connaître les autres (5) ».
« Aron apparaît aujourd’hui comme un penseur politique de premier plan, […] , mais ne semble pas considéré comme un des « classiques de la sociologie ». »
Naissance d’une pensée
Pour comprendre la relation entre la sociologie et la philosophie dans la pensée d’Aron, il faut partir à la fois de ses premières œuvres et de ses premières expériences politiques.
Dans ses premiers travaux, il s’appuie sur des auteurs allemands contemporains comme Dilthey, Rickert, Simmel et, surtout, Max Weber, qui lui apparaissent à la fois comme les promoteurs d’un renouvellement de la philosophie critique et comme des représentants d’une conception des sciences sociales très différente de celle qui devient alors prédominante en France avec le succès de la sociologie durkheimienne. On sait que cette approche, développée notamment dans la thèse principale d’Aron (Introduction à la philosophie de l’histoire) fut en fait assez mal accueillie par la génération universitaire précédente, comme en témoignent les discussions très vives qui eurent lieu lors de sa soutenance (26 mars 1938). Paradoxalement, l’intérêt d’Aron pour « la philosophie critique de l’histoire » et pour la « sociologie allemande contemporaine » le mettait en conflit avec les deux courants dominants de la philosophie française, qui reposent l’un et l’autre sur une confiance sereine dans les progrès de la Raison et qui sont deux expressions complémentaires d’un certain républicanisme français : le néo-kantisme façon Léon Brunschvicg, fondé sur une certaine idée des progrès de la science et de la conscience européennes et la sociologie durkheimienne, qui reprend et transforme l’héritage de Saint-Simon et de Comte s’opposent l’un et l’autre aux versions « allemandes » du projet criticiste et de la sociologie.
Cette divergence philosophique se traduisait aussi par une relation originale avec la politique, qui apparut au grand jour un peu plus d’un an après la soutenance d’Aron, lorsque celui-ci prononça devant la Société française de Philosophie une conférence sur « États démocratiques et États totalitaires » (17 juin 1939), qui montre clairement la nature de son différend avec la philosophie dominante. Aron voit clairement la nature inédite et révolutionnaire du nazisme et la capacité de celui-ci à mobiliser durablement une partie considérable des masses au service d‘un État totalitaire et surarmé, là où la majorité de ses collègues pensent avoir affaire à un simple épisode réactionnaire que l’appel à la raison, à la démocratie et, pour tout dire, à la République ne manquera pas de surmonter ; il annonce, en fait, les difficultés que vont rencontrer les démocraties et en tout premier lieu la France, sans pour autant céder au pacifisme si puissant alors dans la gauche française. On se rappellera aussi que, quelques années plus tôt, en 1933, le jeune Raymond Aron avait été très frappé par la réponse d’un Secrétaire d’État auquel il avait fait un brillant exposé sur les relations entre la France et l’Allemagne et qui lui avait répondu en substance : « tout cela est bien beau, mais que feriez-vous à la place du Président du Conseil ? (6) ». Aron a gardé de cet épisode une certaine idée de l’action qui l’a conduit à considérer que le penseur politique ne peut pas se contenter d’« appliquer » les normes découvertes par la raison mais qu’il doit reconnaître une certaine pertinence au point de vue du Geschäftsmann, l’homme d’action impliqué dans la réalité des affaires humaines, celui-là même que critique Kant dans le célèbre texte « sur l’expression courante « Il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique cela ne vaut rien » ». Ce refus du formalisme moral et ce choix délibéré en faveur d’une éthique conséquentialiste, combiné avec une philosophie théorique essentiellement criticiste est sans doute une des raisons de son admiration jamais démentie pour Max Weber, qui cherchait déjà à penser les exigences de l’éthique de responsabilité sans tomber dans le cynisme ou le pur pragmatisme.
Pour finir, on comprend bien quelle était la situation de départ d’Aron: si la conception criticiste de la connaissance restait indépassable, la voie de la philosophie kantienne orthodoxe était fermée et, d’un autre côté, les sciences sociales devaient s’émanciper de l’orthodoxie durkheimienne, dont la soutenance de thèse avait du reste rappelé la profonde affinité avec l’idéalisme républicain ; d’un autre côté, le marxisme, qui prétendait unir la science et l’action dans une perspective révolutionnaire ne pouvait évidemment pas satisfaire l’auteur de La philosophie critique de l’histoire. Dans ces conditions, l’œuvre de Weber, qui articule une conception exigeante de la science sociologique sur une théorie de la connaissance fondamentalement criticiste et qui reprend dans un cadre non « marxiste » certains éléments importants de la pensée de Marx devait naturellement conserver une place centrale dans la pensée d’Aron, sans que l’on puisse pour autant voir en lui un simple « wébérien ». La solution sera finalement trouvée dans une conception originale de la sociologie, qui est mise en œuvre dans les grands ouvrages des années 1960, notamment les trois cours sur les sociétés modernes (7) Paix et guerre entre les nations et dont les fondements sont mis au jour dans Les étapes de la pensée sociologique.
Philosophie, politique et sociologie
Dans Les étapes de la pensée sociologique, Aron semble apporter deux réponses à la question de la naissance de la sociologie. Au point de départ de son enquête, il fait de Montesquieu plus qu’un « précurseur », un des « doctrinaires de la sociologie ». Montesquieu est sociologue par la manière dont il cherche à penser la diversité des sociétés humaines et, surtout, par son insistance sur les liens entre les lois ou les régimes politiques et les autres forces qui jouent sur l’action humaine : les lois sont des « rapports qui dérivent de la nature des choses », « plusieurs choses gouvernent les hommes ». Mais il reste « encore un philosophe classique dans la mesure où il considère qu’une société est essentiellement définie par son régime politique et où il aboutit à une conception de la liberté », si bien que l’on peut dire que « Montesquieu est en un sens le dernier des philosophes classiques et le premier des sociologues (8) ». D’un autre côté, si Montesquieu n’apparaît pas comme un des « pères fondateurs » de la sociologie, c’est parce qu’il « ne médite pas sur la société moderne », qui est au contraire la question centrale qui va dominer la génération des fondateurs (9). De ce point de vue, la naissance de la sociologie n’est pas seulement liée à une nouvelle conception de la science mais aussi et surtout à la conscience que, au tournant de la fin du XVIIIe siècle, la condition humaine a connu des changements majeurs qui ont rendu possible et nécessaire cette orientation nouvelle. De là l’idée que la grande tradition sociologique se constitue autour de la définition de la société nouvelle qui naît au XIXe siècle et donne lieu à trois grandes interprétations : Auguste Comte la définit comme société industrielle, Marx comme société capitaliste et Tocqueville considère que la grande révolution en cours est l’avènement de la société démocratique caractérisée par le développement « providentiel » de l’ « égalité des conditions ».
« Aron fait de Montesquieu plus qu’un « précurseur », un des « doctrinaires de la sociologie ».»
Il n’est pas difficile de montrer que, dans son œuvre de sociologue, Aron s’est attaché à montrer que ces trois approches étaient d’une certaine manière complémentaires et que, plus d’un siècle après la génération des fondateurs, il restait pertinent de considérer la société moderne à travers les schémas de Comte, Marx ou Tocqueville. C’est le cas notamment dans les trois grands cours sur les sociétés modernes, dont les thèmes dominants renvoient aux trois auteurs majeurs de la génération des fondateurs : les Dix-huit leçons sur les sociétés industrielles développent une problématique héritée de Comte, Les luttes de classes examinent l’apport de Marx, Démocratie et totalitarisme prolongent la réflexion de Tocqueville sur l’avenir de la liberté dans la société moderne.
Ces trois cours doivent être lus comme un tout cohérent. Il s’agit d’une œuvre considérable, souvent sous-estimée aujourd’hui chez certains penseurs du « totalitarisme » et même chez certains amis d’Aron, du fait d’une légende tenace : Aron aurait finalement participé d’une illusion courante à partir de la mort de Staline et de la fin de la guerre froide, celle de la convergence des systèmes communiste et capitaliste dans une même « société industrielle ». Tout en reconnaissant qu’il avait pu lui-même contribuer à cette « erreur d’interprétation », Aron a fait justice de cette légende dans Le spectateur engagé (10) mais elle ressurgit néanmoins périodiquement parce que, la plupart du temps, on ne saisit pas le sens de la comparaison capitalisme/socialisme dans les 18 leçons ou entre Démocratie et totalitarisme.
En fait, on ne comprend pas ces livres si on oublie qu’ils sont issus de cours donnés à la Sorbonne devant un public d’étudiants en philosophie dont beaucoup étaient communistes ou du moins marxistes et dont il fallait d’abord ébranler les certitudes avant de chercher à les convaincre. La notion de « société industrielle » permet dans ce contexte une désublimation de la prétention de la société soviétique à incarner une alternative radicale à société « capitaliste » mais cela ne veut pas dire que ces deux sociétés se confondent, ni qu’elles doivent vraiment converger. Aron s’en explique dans la préface de la Lutte de classes où il remarque d’ailleurs que la Literaturnaya Gazeta ne s’y est pas trompée et où il précise que la coexistence pacifique ne prendrait vraiment de sens que si les marxistes-léninistes renonçaient à leur prétention à la vérité. Loin de prévoir une convergence naturelle des deux régimes, Aron est très sceptique sur les capacités de réforme du communisme et il propose une critique aiguë du marxisme optimiste d’Isaac Deutscher, qui attendait de la croissance économique la démocratisation du régime soviétique. Aron accepte certes trop facilement l’idée que le régime peut apporter une certaine prospérité économique sous condition de certaines réformes (c’est l’époque de Libermann), il convient que les occidentaux et les communistes ont en commun certaines « valeurs » mais il tient que la réforme du régime ne peut venir en URSS (à la différence de ce qui aurait pu se produire en Pologne et en Hongrie) que d’une crise interne de l’élite qui aboutirait à sa destruction.
C’est à partir de là que l’on peut comprendre les thèses de Démocratie et totalitarisme, qui se situent dans un contexte différent de celui de l’avant-guerre, et qui constatent que le régime soviétique pose un problème qui n’est pas de même nature que celui que posait le nazisme. Celui-ci développait une dynamique conquérante qui devait rapidement conclure à un conflit global. Dans Paix et guerre entre les nations , Aron montre au contraire que le monde de la « guerre froide » reste un monde un qui ne va pas nécessairement vers la conflagration, mais qui est néanmoins fondamentalement divisé : le système international n’est pas seulement bipolaire mais asymétrique.
Résumons-nous. Toutes ces œuvres se réclament de la sociologie, mais d’une sociologie qui reconnaît la centralité de la politique et qui s’appuie largement sur les apports de la science politique, mais qui refuse l’idée d’une science reine qui unifierait toutes les approches possibles du politique et de la politique. Dix-huit leçons sur les sociétés industrielles part de Comte pour proposer une critique de l’auto-interprétation marxiste de la société soviétique, dans laquelle la différenciation politique entre l’Est et l’Ouest est décisive. La lutte de classes fait droit à certaines thèses de Marx dans le cadre d’une sociologie qui met davantage l’accent sur la domination que sur l’exploitation, et elle utilise largement certaines œuvres de la science politique américaine (Schumpeter).
« Aron montre au contraire que le monde de la « guerre froide » reste un monde un qui ne va pas nécessairement vers la conflagration, mais qui est néanmoins fondamentalement divisé : le système international n’est pas seulement bipolaire mais asymétrique. »
Démocratie et totalitarisme part d’une version dramatisée de l’alternative tocquevillienne entre les deux versions possibles de la société démocratique pour faire une large place à la question du régime. On peut rapprocher Démocratie et totalitarisme de l’Essai sur les libertés, qui date de la même période, et où Aron met en scène un dialogue imaginaire entre Tocqueville et Marx pour éclairer la relation entre les libertés « formelles » et les libertés « réelles » (11). Mais on doit aussi remarquer que, significativement, Aron rapproche Tocqueville de Montesquieu en notant que l’un et l’autre sont à la fois sociologues et philosophes et que cette double identité tient, d’une part, à l’importance qu’ils continuent d’attribuer à la question du régime politique et, de l’autre, à leur attachement à la cause de la liberté.
Comme il le dira lui-même dans sa leçon inaugurale au Collège de France, qui traite significativement de la « Condition historique du sociologue », la sociologie de Raymond Aron est inséparable d’un certain libéralisme , qui est lui-même fondé sur une philosophie politique. Ce libéralisme essentiellement politique est assez éloigné de celui des différentes écoles libérales d’aujourd’hui, car il ne se fonde ni sur une théorie du marché ni sur une philosophie du droit. Aron est ainsi fidèle aux choix philosophiques et existentiels de sa jeunesse, mais il s’inscrit aussi dans la continuité de la pensée de Montesquieu et de Tocqueville : Le libéral participe à l’entreprise du nouveau Prométhée, il s’efforce d’agir selon les leçons, si incertaines soient-elles de l’expérience historique, conformément aux vérités partielles qu’il recueille plutôt que par référence à une vision faussement totale. « Ayez donc de l’avenir cette crainte salutaire qui fait veiller et combattre et non cette terreur molle et oisive qui abat les cœurs et les énerve ». Vous avez reconnu la voix d’Alexis de Tocqueville.
Pour lire notre recueil, cliquer ICI.
Sources :
- (1) Raymond Aron, Critique de la pensée sociologique, Odile Jacob, 2023. 67
- (2) Raymond Aron, Mémoires, Cinquante ans de réflexion politique, Julliard, 1983, p. 661.
- (3) Pour ce qui concerne la sociologie, on parlerait sans doute plutôt des années 1900.
- (4) Critique..., op. cit., p. 174.
- (5) Id., Ibid., p. 414-415.
- (6) Mémoires, op. cit., 59.
- (7) Raymond Aron, Dix-huit leçons sur les sociétés industrielles, Gallimard, 1963 ; La lutte de classes, Gallimard, 1964 ; Démocratie et totalitarisme, Gallimard, 1965.
- (8) Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967, p. 66.
- (9) Id., ibid., p. 66.
- (10) Raymond Aron, Le spectateur engagé, Julliard, p. 229-230. 73
- (11) Raymond Aron, Essai sur les libertés (1965), Préface de Philippe Raynaud, Hachette-Littératures, coll. « Pluriel », 1998, 2005.