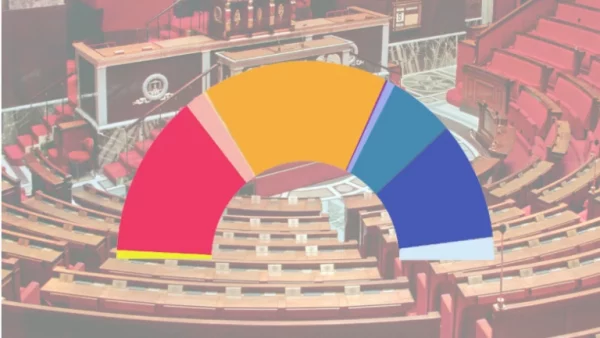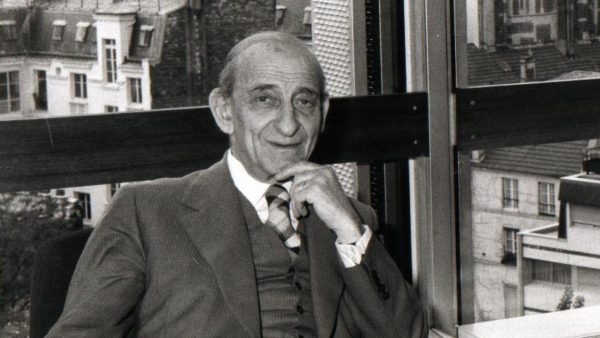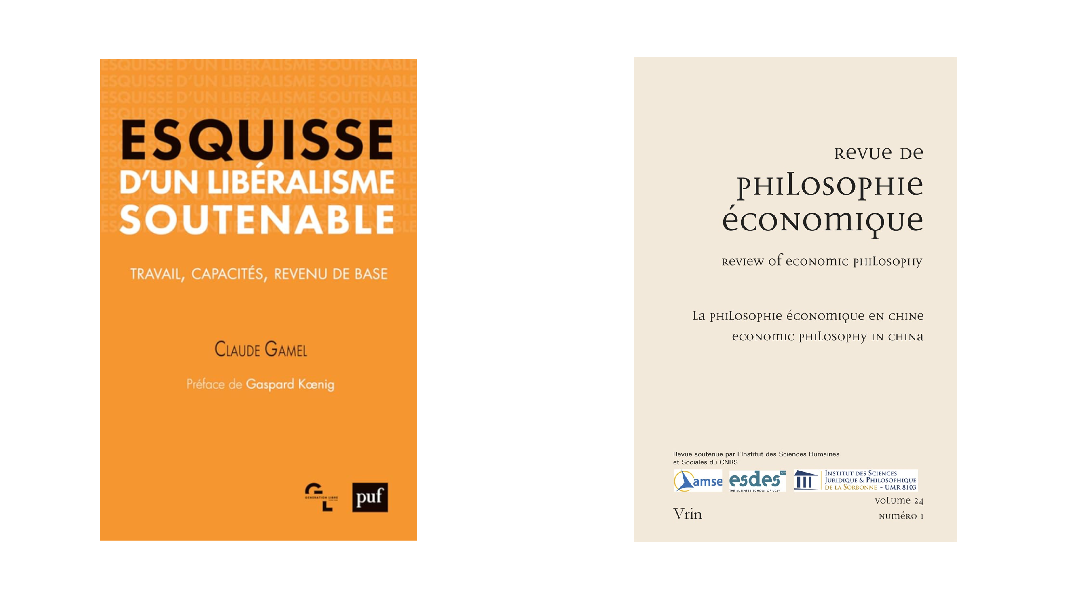
Dans la Revue de philosophie économique, Benoît Walraevens publie une belle recension de notre ouvrage « Esquisse d’un libéralisme soutenable » signé Claude Gamel, troisième ouvrage de la collection de notre think tank aux Puf sorti en 2021.
À l’aune des travaux d’Hayek et de Rawls, Claude Gamel nous livre dans cet ouvrage une utopie libérale à la française adaptée à nos enjeux socio-économiques, ainsi que des propositions de politique publique ambitieuses et efficaces. Loin d’être une simple conception utopique non réalisable, il s’agit plutôt d’un « modèle de société alternatif et idéal » selon la définition de Benoît Walraevens.
« Le but avoué de Gamel est d’identifier les principes libéraux qui, « correctement appliqués », permettent « d’amplifier les avantages du capitalisme et de voir ses inconvénients au mieux neutralisés », afin d’imaginer et de dessiner un libéralisme socialement et écologiquement « soutenable ». »
Benoît Walraevens explique que dans son ouvrage, Claude Gamel juge l’approche libérale de Hayek trop rigoureuse et « peu désirable pour les individus », tandis que celle de Rawls lui apparaît « supportable » et permettant de « réconcilier libéralisme et égalitarisme ». Aux yeux de l’auteur de la recension, la vision de Rawls semble donc se rapprocher de la devise de la République française, ce que Claude Gamel tente aussi de faire en préservant la notion de justice dans sa proposition libérale. Pour ce faire, Claude Gamel nous partage sa vision d’un « libéralisme soutenable » et détaille dans cet ouvrage des propositions que GL défend ardemment : le revenu universel ainsi que la tarification carbone.
Pour commencer sa recension, Benoît Walraevens explique que Claude Gamel prône une démocratie de propriétaires qui vise à une « dispersion maximale du pouvoir économique » pour éviter les dérives oligarchiques. Ce dernier appelle à plus de fluidité dans le marché du travail, qu’il juge trop « rigide et protecteur ». C’est pourquoi il propose un ensemble de solutions nouvelles et radicales (se rapprochant des idées de Piketty) : suppression du CDI, mise en place d’un contrat de travail unique, partage du profit entre l’entreprise et ses salariés, forme de cogestion pour plus de représentativité des salariés…
« Toujours est-il que ce genre de mesures permet de dessiner le cadre institutionnel possible d’une démocratie de propriétaires et s’inscrit bien dans la lignée du libéralisme égalitaire, visant à atténuer certains effets délétères du libéralisme économique. »
Aussi, Benoît Walraevens revient sur le « financement alternatif de la protection sociale » que Claude Gamel défend, notamment par la suppression des cotisations sociales (financée par la seule CSG). Cette idée, portée de longue date par GL, implique la mise en place d’un revenu universel inconditionnel, qui inclurait les risques famille et pauvreté et s’inscrit dans sa théorie de justice sociale. Ce système « à l’anglaise » permettrait d’assurer à chacun un minimum essentiel et d’être libre de se protéger, ou non, face à certains risques sociaux.
« La mise en place de ce crédit d’impôt universel nécessite, en parallèle, une réforme profonde à la fois de la protection sociale et de la fiscalité, en commençant par la première. Ainsi, l’allocation universelle viendrait remplacer les divers minimas sociaux (…). »
Benoît Walraevens met ensuite en exergue les « politiques d’enrichissement des capacités » défendues par Claude Gamel, c’est-à-dire sa volonté de réformer des institutions et secteurs particuliers afin d’offrir plus de choix de vie individuels (formations, démocratisation qualitative de l’enseignement supérieur, accès à la culture, traitement de la pauvreté et du handicap…). Claude Gamel y cible trois axes : le développement de la capacité du jeune mineur, la capacité du jeune adulte et aussi la possibilité de changer de voie au cours de sa vie.
Dans la dernière partie du livre, Claude Gamel s’attarde sur la mise en place d’un revenu universel qu’il considère comme « l’instrument d’une liberté réelle ». Benoît Walraevens émet cependant certaines réserves quant à la forme et surtout au montant de ce revenu, qu’il juge relativement faible (500 euros par mois). Comme le préconisent notre fondateur Gaspard Koenig et notre expert Marc de Basquiat, ce « socle de protection sociale » serait financé par un impôt sur le revenu à taux unique de 25%. Claude Gamel reste pragmatique quant à la mise en place d’une telle réforme, qui doit être instaurée de manière progressive avec un réel consensus autour d’un nouveau contrat social.
« Gamel reconnaît que le montant de son revenu de base serait inférieur à celui des différents transferts sociaux ciblés auxquels il se substituerait, mais que cette perte économique serait compensée, « au moins en partie », par les « avantages en nature » que celui-ci génèrerait comme un pouvoir (de négociation) accru et une plus grande dignité. »
Dans la conclusion de cet ouvrage, Claude Gamel évalue la viabilité de son libéralisme soutenable à long terme. Une des problématiques soulevées étant celle de l’urgence climatique, Claude Gamel y répond par l’éventuelle instauration d’une taxe carbone et d’un marché de droits à polluer. Concernant l’instauration d’une taxe carbone, il se base sur l’estimation faite par Christian Gollier du prix de la tonne de CO2 (soit 50 euros) avec un taux d’actualisation de 4% par an. Néanmoins, Claude Gamel relève lui-même deux limites majeures à cette taxe carbone. Tout d’abord, l’acceptabilité sociale qu’il solutionne par la mise en place d’un dividende carbone, c’est-à-dire en redistribuant les recettes sous la forme d’un montant identique pour tous. Puis, « les fuites de carbone », similaires aux évasion fiscales, qu’on pourrait éventuellement éviter grâce à la généralisation de cette taxe carbone au niveau mondial (trop compliquée à mettre en place).
« Cette question [écologique] est centrale aujourd’hui pour toute théorie de la justice sociale, et en particulier pour une théorie de la justice se revendiquant du libéralisme comme ici, car il n’est pas simple a priori de lutter efficacement contre le réchauffement climatique tout en accordant une prééminence aux libertés individuelles. »
Benoît Walraevens se penche sur la seconde solution proposée par Claude Gamel : celle d’un « marché mondial, unique, de droits à polluer » instauré de manière progressive. Il suggère la mise en place une « carte carbone mondiale », c’est-à-dire l’instauration d’un quota de CO2 attribué à chacun de manière individuelle. Cependant, Benoît Walraevens y voit une forme de contrôle social et donc, une menace au respect des libertés individuelles.
« Il défend l’instauration d’une carte carbone mondiale, c’est-à-dire d’un quota d’émissions égal octroyé à tous les habitants de la planète, conforme à l’idéal d’égalité en termes de justice climatique, soit une forme de « crédit universel de droits à polluer » en sus du crédit universel d’impôt que constitue le revenu de base. »
Même si l’auteur de cette recension soulève dans son argumentaire certaines limites, il rappelle que cet ouvrage ne représente finalement qu’une simple « esquisse » d’un libéralisme soutenable, ambitieuse bien que perfectible. Bien entendu, l’objectif n’est pas de modeler une société parfaite, mais plutôt de proposer des réformes radicales de notre modèle actuel afin d’atteindre un mode de fonctionnement viable, soutenable et efficace, tout en restant fidèles à nos valeurs.
« Il incombe maintenant à ses lecteurs de s’en emparer et de compléter ainsi ce nouvel horizon (libéral) des possibles que dessine l’ouvrage de Gamel. »
Pour lire la recension de l’ouvrage, cliquer ICI.
Pour (re)découvrir l’ouvrage « Esquisse d’un libéralisme soutenable », cliquer ICI.
Publié le 20/09/2023.