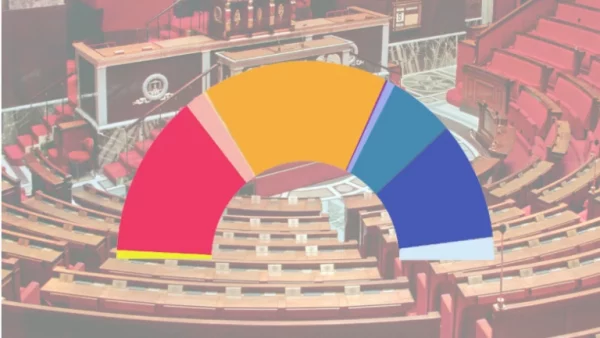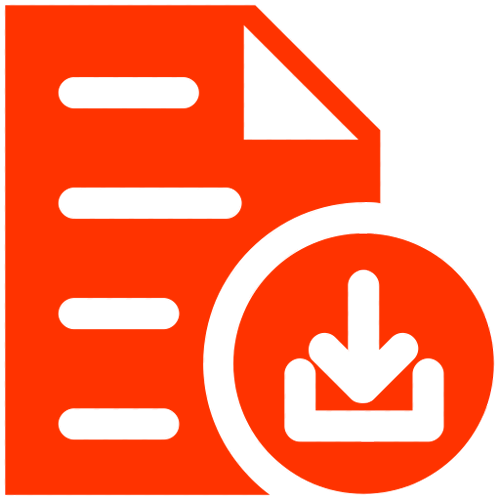Interview : Aron vu par Jean-Louis Bourlanges

Député de la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine et président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.

Dans un entretien pour notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Jean-Louis Bourlanges souligne le pessimisme de l’intellectuel et vante sa lucidité sur les totalitarismes du XXème siècle. Selon lui, Raymond Aron nous inviterait à considérer les périodes de paix du XXème siècle comme « une fugace parenthèse dans une histoire plus que jamais remplie de bruit et de fureur. ».
GenerationLibre : Quel est votre rapport à l’œuvre de Aron ? Quel est l’apport d’un Aron dans la pensée d’un Président de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale ?
Jean-Louis Bourlanges : Initialement, je n’ai pas abordé Raymond Aron par les questions de politique étrangère et ce n’est qu’au bout de quelques années de fréquentation de son œuvre que je me suis lancé dans son grand ouvrage théorique sur les questions internationales : Paix et guerre entre les nations. En plus des articles du Figaro, j’avais jeté mon dévolu sur les trois grands cours de sociologie dispensés à la Sorbonne à la charnière des décennies cinquante et soixante du siècle dernier. Ces leçons délivrées en pleine déstalinisation éclairaient les dimensions économiques, sociales et politiques du conflit Est / Ouest. Aron y apparaissait comme l’un des seuls intellectuels à refuser le discours lénifiant à la mode sur la convergence prévisible des systèmes opposés et à expliquer pourquoi le caractère totalitaire du système soviétique le rendait inassimilable.
Mes coups de cœur sont toutefois allés à ses grands livres de philosophie politique, de l’Opium des intellectuels aux Marxismes imaginaires. Aron aura été l’un des seuls de nos « grands esprits » à n’être jamais tenté par les délires et les démons de ce qu’il y a de pire dans notre magasin des engagements. Il m’a permis de découvrir une vérité déconcertante sur le monde des intellectuels, à savoir que les grands professionnels de l’intelligence, dont Sartre était le modèle caricatural, avaient tendance à professer bien plus souvent que les gens ordinaires, les pires et les plus odieuses inepties politiques. L’Opium nous a montré qu’il n’y a aucune corrélation, sauf peut-être négative, entre le coefficient intellectuel des idéologues et leur aptitude à comprendre la réalité. Grâce à Aron, j’ai donc été vacciné très tôt contre la fascination des signatures prestigieuses enluminant des motions intellectuellement indigentes ou irresponsables !
« Aron n’établit pas un lien particulier entre violence et valeurs libérales. Il pense en revanche que tout est conditionné dans l’ordre international par les rapports de forces. »
La force de Raymond Aron, c’est d’avoir avec une humilité, il est vrai, soigneusement dissimulée, traversé le vingtième siècle en prenant chaque fois la juste mesure du péril dominant et des responsabilités corrélatives à assumer. Sartre avait ignoré le nazisme et encensé le stalinisme avant de radicaliser – et d’histrioniser – son opposition à la guerre d’Algérie. Aron a tout de suite perçu la gravité du nazisme et dénoncé sans faiblesse non seulement les crimes de Staline mais l’intrinsèque perversité du système soviétique. Il a enfin précédé et accompagné le pays dans sa résignation à l’indépendance algérienne. Ce n’est pas rien de pouvoir sortir la tête haute d’une éprouvante confrontation avec les principales tragédies de son siècle.
C’est donc le citoyen, le militant et l’élu que je suis, autant que l’un des contrôleurs parlementaires de notre politique étrangère, qui a une dette immense envers celui qui lui a appris à savoir où mettre – et surtout où ne pas mettre – les pieds.
« Laissons à d’autres, plus doués pour l’illusion, le privilège de se mettre par la pensée au terme de l’aventure et tâchons de ne manquer ni à l’une ni à l’autre des obligations imposées à chacun de nous : ne pas s’évader d’une histoire belliqueuse, ne pas trahir l’idéal ; penser et agir avec le ferme propos que l’absence de guerre se prolonge jusqu’au jour où la paix deviendra possible–à supposer qu’elle ne le devienne jamais ». A travers cette citation, Raymond Aron synthétise une pensée qui mêle à la fois utopisme (« ne pas trahir l’idéal ») et réalisme (« ne pas s’évader de l’histoire belliqueuse »). Que vous inspire ce « en même temps » ?
La question et la citation qui l’introduit me semblent contenir toutes les réponses ! Il n’y a aucun « en même temps » dans ces maximes, sauf à considérer qu’une politique étrangère devrait ignorer soit les rapports de force qui la contraignent, soit les valeurs qui l’inspirent. Je partage l’adhésion d’Aron aux observations de Max Weber soulignant que la politique est « un va et vient entre le réel et les valeurs » et qu’elle consiste de ce fait « à tarauder des planches de bois dur ». Une politique qui n’est pas guidée par des valeurs est insignifiante et, ignorant où elle doit aller, elle ne peut que tourner en rond sur elle-même. Pétain et Maurras, qui se sont en plus trompés sur le vrai rapport de forces, en ont fait la misérable démonstration. Weber disait dans son essai, préfacé par Aron, sur Le Savant et le Politique, qu’il ne voyait rien de plus médiocre et de plus vide de sens que la politique de puissance, entendez une politique qui vise à la puissance pour la puissance, il a raison. Songeons à de Gaulle qui en 1940 a su placer son action à l’exacte intersection d’un combat pour la liberté et d’un rapport de forces génialement anticipé.
La démarche aronienne en matière de relations internationales, c’est un refus de la pure théorie, reconnaissant la valeur fondamentale de la subjectivité des acteurs en présence dans l’explication des relations entre Etats. A quel point cette irréductibilité de la subjectivité est-elle palpable dans vos travaux à la commission des affaires étrangères ?
Que la subjectivité des acteurs compte pour beaucoup dans la détermination et la mise en œuvre d’une politique étrangère est une évidence qu’Aron se garde bien entendu d’ignorer. Rabelais l’avait montré : quand on est vaniteux comme Picrochole, on ne mène pas la même politique que le sage Grandgousier ! Aujourd’hui, on a d’ailleurs tout lieu d’être inquiet pour l’avenir du monde quand on voit le nombre et la puissance des marionnettes sanglantes qui sont au pouvoir un peu partout. Jamais depuis la seconde guerre mondiale, nous n’avons vu aux affaires un tel nombre de responsables internationaux, publics et privés, exclusivement habités par la volonté de puissance et l’appât du gain. Partout où presque, les drapeaux de la liberté et de la solidarité sont en berne.
« La force de Raymond Aron, c’est d’avoir avec une humilité, il est vrai, soigneusement dissimulée, traversé le vingtième siècle en prenant chaque fois la juste mesure du péril dominant et des responsabilités corrélatives à assumer. »
Je me rappelle l’observation quelque peu désenchantée que m’avait faite Pierre Hassner : « l’hypocrisie est un premier pas vers la vertu. » Or aujourd’hui le cynisme s’affiche sans la moindre pudeur. C’est un grand changement par rapport aux décennies de l’après-guerre et c’est plus que préoccupant.
Je ne crois pas cependant qu’Aron ait accordé à la subjectivité des acteurs une place excessive, ni bien sûr exclusive, dans l’analyse des relations internationales. Ce qui caractérise sa démarche, c’est le souci d’une approche multifactorielle des situations. La subjectivité des acteurs tient sa place à côté d’un grand nombre de problématiques, géopolitiques, économiques, idéologiques et culturelles. L’un des grands mérites d’Aron, ce n’est pas l’éclectisme, car ses analyses sont toujours cohérentes et structurées, mais c’est l’absence d’œillères.
Raymond Aron soulignait l’inévitable de la violence pour le maintien des valeurs libérales. Les événements liés au conflit russo-ukrainien ne nous rappellent-ils pas cette dure réalité d’un ordre international fondamentalement soutenu par la violence ? Quelles conséquences politiques et pratiques doit-on en tirer ?
Aron n’établit pas un lien particulier entre violence et valeurs libérales. Il pense en revanche que tout est conditionné dans l’ordre international par les rapports de forces. D’où son insistance à rappeler l’importance conjointe de la lucidité et du réalisme d’un côté, et de la force morale de mobilisation de l’autre, dans la gestion des affaires du monde. Rien ne résume mieux son message que la devise de la revue Commentaire qu’il a fondée avec Jean- Claude Casanova : « Il n’est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. » On peut craindre au demeurant que dans la France d’aujourd’hui, le compte n’y soit pas.
De même, ces événements n’impliquent-ils pas que la France soit condamnée à s’inscrire dans des logiques de puissance pour se maintenir dans l’ordre international ? La France pourrait-elle se comporter comme la Suisse ?
La Suisse, avec ses montagnes, son armée, ses banques, son industrie, sa diplomatie hyper professionnelle, sa neutralité et même ses engagements humanitaires, s’inscrit pleinement dans une logique de puissance mais elle le fait à sa manière, qui n’est pas la plus sotte. Disons qu’elle préfère se situer au fléau de la balance plutôt que sur l’un des plateaux. Nous sommes, quant à nous, résolument installés sur le plateau occidental de ladite balance mais nous y sommes un peu remuants car nous ne faisons pas semblant d’ignorer que nous avons de vraies différences, et même parfois de vraies divergences d’intérêt, avec certains de nos partenaires et alliés, américains, bien sûr, mais aussi européens. Il nous faut donc être forts, solidaires et vigilants. Ne pas mettre sur le même plan les contentieux entre alliés et les conflits entre adversaires. Depuis de Gaulle, la quête de ce délicat équilibre est un sport national. Il n’est pas certain que nous le jouions avec l’énergie requise pour gagner.
On connaît l’attachement pragmatique de Aron à l’atlantisme, pour maintenir un espace libéral dans l’ordre international. L’actuel équilibre des puissances condamne-t-il l’Europe à perpétuer l’atlantisme ?
Raymond Aron avait beaucoup réfléchi à l’enchaînement fatal qui avait conduit à la seconde guerre mondiale et à l’effondrement de la France. Il avait tiré de ses réflexions l’idée que le refus américain de signer le traité de Versailles et le repli isolationniste des États-Unis avaient été la cause profonde du désastre de 1940, car l’Europe dessinée à Versailles ne pouvait être stabilisée par les Britanniques et les Français, les premiers n’en ayant cure et les seconds n’en n’ayant pas les moyens. Son philo-américanisme, renforcé par la proximité universitaire et culturelle, venait de ce constat.
« La force de Raymond Aron, c’est d’avoir avec une humilité, il est vrai, soigneusement dissimulée, traversé le vingtième siècle en prenant chaque fois la juste mesure du péril dominant et des responsabilités corrélatives à assumer. »
Après la Seconde Guerre mondiale, les choses étaient devenues encore plus claires : non seulement une Europe occidentale ruinée était incapable de se protéger de l’URSS sans les États-Unis mais Français et Allemands étaient même incapables de se réconcilier hors de la médiation tutélaire des Américains. Aron approuvait l’orientation fondamentale de la politique européenne des États-Unis consistant à régler le problème allemand en refusant d’humilier et de punir la population et en satisfaisant à ses aspirations légitimes à l’unité, à la démocratie, à la sécurité et à la prospérité. Il avait raison et la France, celle de Jean Monnet mais, à sa manière, celle aussi du général de Gaulle, seraient bien vite forcée d’en convenir.
Que penserait Aron de la situation actuelle, marquée par de grandes incertitudes sur l’avenir de l’engagement américain en Europe ? Difficile de le dire. Gageons qu’il serait à la fois très attaché à la pérennité du lien transatlantique et très soucieux de voir les États européens sortir enfin de leur pacifisme subliminal et prendre une part accrue à leur propre défense. Il était plutôt sceptique sur la capacité des Européens à bâtir une défense commune. L’incertitude électorale américaine suffirait-elle à vaincre son scepticisme en la matière ? Ce serait bien téméraire de se prononcer même si j’ai plutôt tendance à en douter.
Une autre leçon de Raymond Aron en matière de relations internationales, c’est le caractère fondamentalement expansionniste des régimes autoritaires, que ce soit par des actions militaires ou d’influence. Il affirmait ainsi, à l’occasion d’une communication devant la Société française de philosophie : « La pensée des dictateurs accorde un primat évident à la politique extérieure. L’autre fait incontestable, ce sont les ambitions impérialistes de ces régimes. » Comment doivent se comporter les démocraties libérales en face ?
Aron désigne un certain type de dictateur, ceux qui ont à la fois une pulsion de joueur désireux, tel Napoléon, de relancer indéfiniment les dés jusqu’à leur échec final et soucieux dans le même temps d’éblouir une opinion publique avide de gloire. Aron opposait ces dispositions d’esprit à celles qui caractérisent les démocraties. Il partageait les analyses de Tocqueville sur le pacifisme fondamental des démocraties.
« Il est de ceux qui pensent que les optimistes ont tendance à finir mal et que seuls les pessimistes sont capables de survivre. Il est clair à ses yeux que face aux méchants, il faut être dur. »
Ce que l’auteur de Paix et guerre a vécu tout au long des années Trente, c’est l’extrême difficulté à mobiliser des opinions inertes contre les initiatives agressives répétées des dictatures. Il est vrai qu’Hitler a toujours pris soin de justifier ses initiatives par référence aux grands principes en honneur dans les démocraties : souveraineté et égalité des États, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Or une démocratie est incapable de faire la guerre contre ses propres principes. Aron pointe cette asymétrie et met en garde les démocrates contre les conséquences d’une soumission excessive à l’état de droit. Il est conscient du danger d’incohérence morale auxquels sont exposés ceux-ci dès lors qu’ils veulent mettre en échec leurs adversaires. D’où l’insistance aronienne sur les exigences de l’éthique de responsabilité par rapport à celles de l’éthique de conviction.
Remarquons toutefois que tous les dictateurs ne sont pas portés à la surenchère et à la démesure. A côté du modèle César, il y a le modèle Sylla. A côté du modèle Hitler-Mussolini, il y a le modèle Franco. Songeons aussi à Kemal-Atatürk qui a su tailler une nation moderne dans les restes de l’Empire Ottoman et s’est bien gardé de s’embarquer dans des utopies impérialistes périlleuses comme l’avait fait Enver Pacha.
En vérité, Aron était moralement pessimiste. Il était donc porté à voir les hommes menés par la libido dominandi. Ceci le rapproche en matière de politique internationale de l’école réaliste, celle de Kennan et bien sûr de Kissinger. Dans Paix et guerre entre les nations, il présente équitablement les deux écoles, réaliste et idéaliste, mais sa préférence de bon Européen pour le réalisme est claire. Il est de ceux qui pensent que les optimistes ont tendance à finir mal et que seuls les pessimistes sont capables de survivre. Il est clair à ses yeux que face aux méchants, il faut être dur.
Raymond Aron refusait malgré tout l’abandon de toute forme d’idéal. Comment, en dépit d’un ordre international qui semble être plus soutenu par la violence plutôt que le droit, ne pas diluer l’idéal des démocraties libérales au profit d’un pur réalisme ?
Nous voici de retour à la case départ. Raymond Aron estimait que pour imposer le respect sur la scène internationale, il faut combiner un tempérament fort et des principes qui ne le sont pas moins. Le naïf est un crétin qui risque d’aller trop vite au Ciel. Le cynique est un salaud qui va tout droit en enfer. Seule la prise en compte simultanée de la réalité et de l’idéal permet de rester sur terre et d’y vivre une existence respectable et respectée.
« Au risque de céder à une forme d’idéalisme, Aron estimait qu’une culture commune des valeurs démocratiques et du respect de l’État de droit n’était pas sans incidence sur la nature des relations entre les Etats. »
Taïwan, Iran, Afghanistan : trois cas pratiques qui illustrent des régimes en proie à des forces illibérales. Comment doit-on réagir en Français ?
Ces trois situations sont différentes : deux peuples martyrisés par leurs dirigeants, un petit État libre menacé par un géant tyrannique. Chacune d’elles exige une approche spécifique. Au lendemain de la chute de l’empire soviétique, nous, c’est-à-dire les Européens et les Américains, avions conçu l’idée d’un droit d’ingérence, exercé sous le contrôle de l’ONU, dans les États qui se conduisent mal avec leurs populations. En période de fort dissensus comme celle que nous vivons, ce droit d’ingérence se révèle inopérant. Les États-Unis ont échoué, militairement ou politiquement, dans la quasi-totalité de leurs OPEX depuis la guerre de Corée. Nous sommes, quant à nous, en situation d’échec en Afrique de l’Ouest, et nous n’avons guère la main sur les autres théâtres. Nous devons en tout cas gagner la partie qui nous a été imposée en Ukraine. Aron nous inviterait à coup sûr à prendre conscience que le relatif intermède de paix et de progrès que nous avons connu après la Seconde Guerre mondiale, la fin des guerres coloniales et l’effondrement de l’empire soviétique, n’aura été qu’une fugace parenthèse dans une histoire plus que jamais remplie de bruit et de fureur.
Comment concilier intégrité territoriale et liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes ? Est ce qu’il y a une ligne qui se définit chez Aron ? Chez les libéraux ? Ou est-ce que notre comportement doit se définir au gré des circonstances : Donbass, Haut Karabakh…
Pierre Hassner a parfaitement formulé la pensée aronienne dans son analyse critique de la politique extérieure du général de Gaulle. Il soulignait l’ambivalence de la démarche gaullienne exaltant à la fois la nation comme un principe de libération et l’État national comme un instrument inévitable de domination. L’anti-américanisme de de Gaulle, par exemple en Amérique latine, exaltait la libération des peuples par rapport aux empires ce qui ne l’empêchait pas de cultiver un cynisme machiavélien ou bismarckien dans sa conception des relations internationales. Cette contradiction n’est pas facile à surmonter. Au risque de céder à une forme d’idéalisme, Aron estimait qu’une culture commune des valeurs démocratiques et du respect de l’État de droit n’était pas sans incidence sur la nature des relations entre les Etats. C’est pourquoi il a toujours considéré qu’il y avait une différence de nature entre le Pacte de Varsovie, pure expression de l’impérialisme soviétique et l’Alliance atlantique associant librement des Etats indépendants unis pour leur sécurité commune. Il n’était pas cependant assez naïf pour ignorer le caractère asymétrique, voire parfois impérialiste, de la relation que les Etats-Unis entretiennent avec des alliés, qui sont parfois des protégés, voire des vassaux.
Pour lire notre recueil en intégralité, cliquer ICI