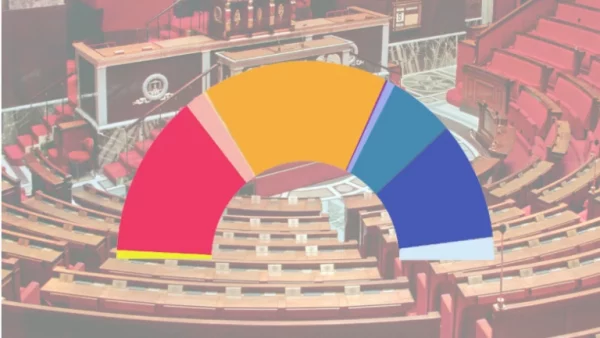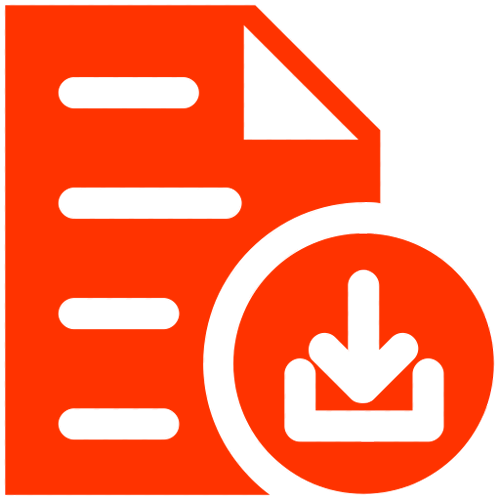Aron et Camus – Le fardeau de l’isolement et les vertus de la solitude

Professeur agrégé, président associé et directeur des études supérieures à l'Université de Georgetown, il est notamment l'auteur de l'ouvrage Liberalism in Dark Times : The Liberal Ethos in the Twentieth Century (2021).
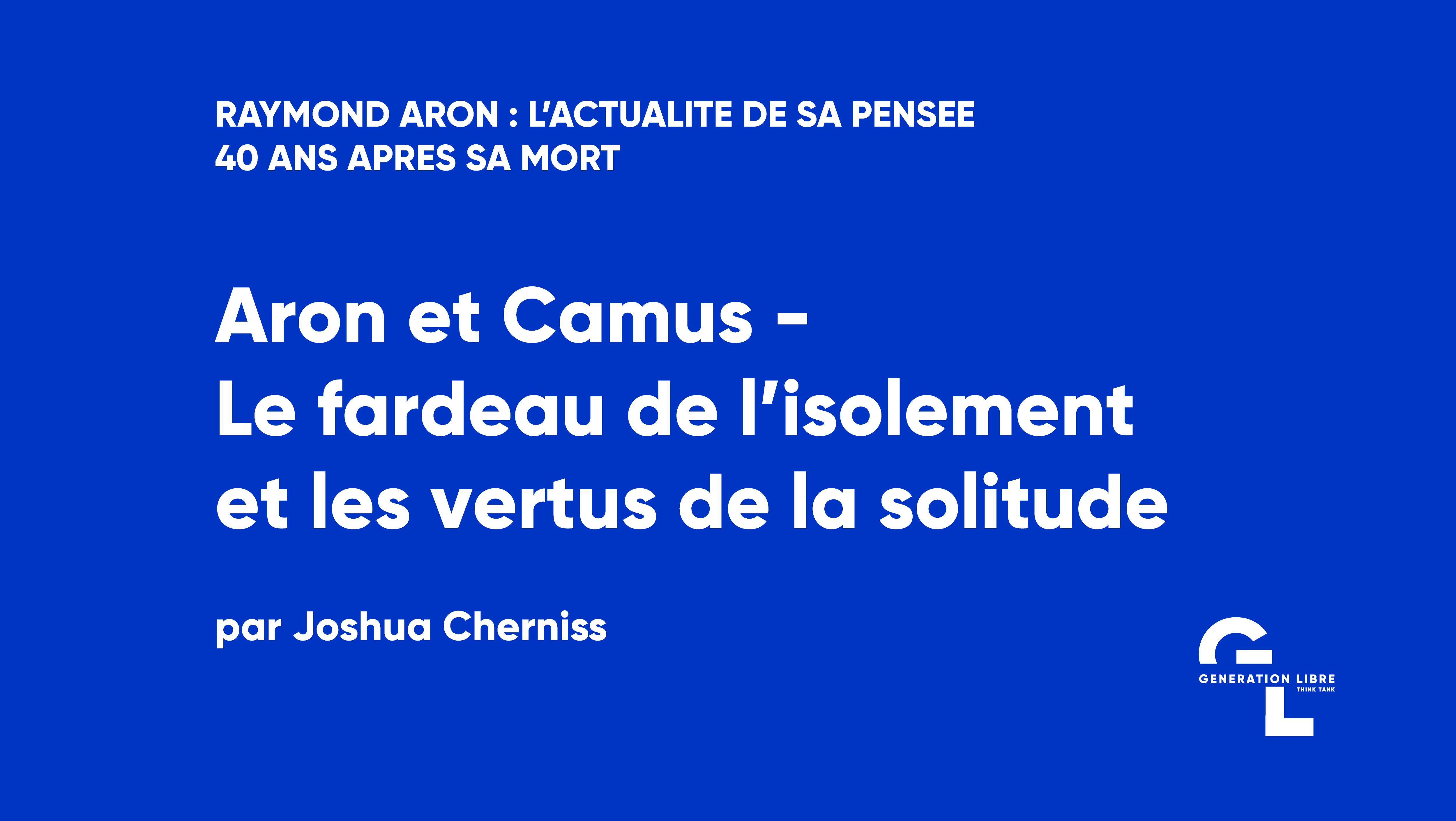
Dans sa contribution à notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Joshua L. Cherniss croise son parcours intellectuel avec celui d’Albert Camus. Il compare leur apprentissage respectif de la solitude et leur indépendance idéologique vis-à-vis des factions politiques. Pour eux, cette solitude constituera un moyen de garantir leur intégrité et leur sincérité.
Dans son livre portant ce titre, le regretté Tony Judt décrivait deux de ses héros politico-intellectuels, Raymond Aron et Albert Camus, comme portant « le fardeau de la responsabilité » (1). Judt les reliait à l’idée de Max Weber d’une « éthique de la responsabilité », une éthique qui devrait idéalement guider les dirigeants politiques, disciplinant leurs passions, leurs espoirs, leurs haines et leurs peurs, en les protégeant de la naïveté comme du fanatisme. Ce serait toutefois une vision erronée d’Aron, et surtout, de Camus (ainsi que de Weber également), que de considérer chacun d’eux comme ne se consacrerait qu’à une éthique de la responsabilité, sans effort de leur part dans l’étude d’une éthique complémentaire (et parfois conflictuelle) dite de l’intégrité. La responsabilité et l’intégrité peuvent toutes deux imposer certains fardeaux en même temps qu’elles apportent inspiration, orientation et parfois réconfort. Mais le fait d’assumer des responsabilités en même temps que d’essayer de maintenir son intégrité implique souvent une charge supplémentaire : la solitude. Ce fut en effet la crainte et finalement le destin d’Aron et de Camus ; était-ce aussi, peut-être, lié à leur force et à leurs vertus ?
La préoccupation et l’expérience de la solitude font d’Aron et de Camus des enfants de leur temps. L’expérience du déracinement, du sans-abrisme, de l’abandon et de l’aliénation était une condition fondamentale pour beaucoup au XXe siècle, un siècle de déracinement dû à la guerre, aux transformations géopolitiques et aux migrations qui en ont résulté, ainsi qu’aux changements technologiques et sociaux. En même temps, les deux hommes étaient particulièrement sensibles à la solitude en raison de leur situation personnelle. Tous deux sont nés, dans une certaine mesure, dans un état de solitude, ou du moins de distance par rapport à la plupart de leurs pairs intellectuels. Aron se distinguait par sa judéité ; Camus était quant à lui un pied noir, né et élevé dans la pauvreté, éduqué dans la lointaine Algérie. Les deux hommes, qui ont cherché et, dans une certaine mesure, atteint l’acceptation et l’estime de l’élite intellectuelle et culturelle française, ont finalement choisi la voie de la solitude intellectuelle et idéologique, de l’aliénation et du mépris de leurs anciens camarades et amis pour leurs choix politiques, même s’ils ont continué à être influents et admirés (souvent plus à l’étranger que dans leur propre pays). Au cours de leurs années de plus grande influence, ils ont été à la fois des initiés et des exclus, des participants et des observateurs, des sages et des étrangers. La soif d’amour et d’acceptation semble avoir motivé Camus, l’empêchant de se satisfaire ou de se reposer. Si Aron a ressenti les tourments de la solitude personnelle, il n’a pas donné libre cours à l’expression de sa souffrance – fidèle à sa réticence et même son horreur pour l’exhibitionnisme émotionnel.
La façon dont Aron et Camus en sont venus à occuper la position d’une solitude visible et influente, façonnée à la fois par leurs circonstances et leurs idéaux, et la manière avec laquelle ils ont cherché à vivre cette condition, est une longue histoire. J’évoquerai ici ses racines dans leurs premières expériences et montrerai comment ils ont réagi à l’exil et la solitude ; je suggérerai également comment l’isolement idéologique qu’ils ont connu pendant la guerre froide reflétait à la fois leurs idéaux politiques et leur conception de la manière dont un intellectuel ou un artiste devrait fonctionner dans la société. Je conclurai en m’appuyant sur les œuvres d’Aron et de Camus pour évoquer une éthique de la solitude connectée – une position à la fois d’attention et d’engagement envers les autres et d’autosuffisance intellectuelle – et ferai quelques suggestions préliminaires très générales sur ce qu’elle pourrait enseigner à ceux d’entre nous qui ont soif de connexion et d’approbation, tout en percevant les dangers de la conformité, de la subordination ou de la cooptation, qui entendent l’appel de l’intégrité et de la responsabilité.
I. Les débuts de la vie : apprentissage de la solitude
Aron et Camus ont fait l’apprentissage de la solitude dès le début de leur vie. La situation de Camus était bien plus difficile. Né dans la pauvreté en Algérie, fils d’un père décédé (tué pendant la Première Guerre mondiale alors que Camus avait moins d’un an) et d’une mère aimante mais (comme son fils la dépeindra) largement silencieuse, il est contraint de quitter le domicile familial lorsqu’il apprend qu’il est atteint de tuberculose à l’âge de dix-sept ans ; le fait de savoir qu’il est porteur d’une maladie mortelle éloigne encore davantage Camus de la vie qui l’entoure. Camus aspirait à un sens du bien commun, de la solidarité et du travail d’équipe, même si son penchant pour la contemplation le poussait à se replier sur lui-même. Il est révélateur que ses passe-temps favoris soient le football et la natation : dans le premier, il trouvait l’union dans la poursuite coopérative et coordonnée d’un seul but commun, dans le second, un parfait isolement. Ses activités artistiques reflètent cette dualité : dramaturge et metteur en scène, il a organisé le Théâtre de l’Équipe, au nom révélateur, et romancier, nouvelliste et essayiste, dont les œuvres explorent la solitude, avec en point d’orgue le roman L’Étranger, qui l’a fait entrer dans l’histoire.
« La préoccupation et l’expérience de la solitude font d’Aron et de Camus des enfants de leur temps. »
C’est peut-être un hasard, ou peut-être le destin d’un personnage, qui fait que Camus est pris sous l’aile de Jean Grenier, un philosophe qui se tient à l’écart des mouvements de son temps, cultivant l’indépendance et l’intériorité. Mais contrairement à Grenier, le jeune Camus est attiré par la politique, poussé à s’engager dans les luttes idéologiques de son temps. Cette attitude reflétait une haine de l’injustice nourrie par la connaissance de la pauvreté et de l’oppression coloniale, ainsi qu’un désir de camaraderie vertueuse. Camus a donc rejoint (contre l’avis de son mentor) le Parti communiste algérien. Pourtant, malgré son aspiration à la solidarité et à la camaraderie, voire à la discipline, il était aussi un individualiste qui refusait de « s’abandonner aveuglément » à l’orthodoxie ou de « mettre un volume de Das Kapital entre la vie et l’humanité » (2). Son exclusion du parti en 1937 représentait un choix d’isolement né d’un engagement de loyauté – la qualité que, dit-il, « j’ai toujours aimée et respectée le plus en ce monde » (3). Camus a en effet tenu à respecter les obligations qu’il avait contractées à l’égard des membres du Parti populaire algérien (PPA), qu’il avait recrutés à la demande du Parti communiste et qui étaient devenus ses amis. Lorsque les communistes ont fait volte-face, soutenant la dissolution du PPA et l’emprisonnement de ses dirigeants, Camus a préféré ses amis et ses principes à l’appartenance à un mouvement (4). Camus était également opposé à l’oppression de la population algérienne par les autorités françaises et a été contraint de partir pour la France en 1940 lorsque le journal pour lequel il écrivait fut interdit. S’il retourne brièvement en Algérie après la chute de la France, il passe la majeure partie des années de guerre en France, luttant contre les maux de la tuberculose et de l’occupation.
Pour le jeune Camus, la solitude n’est pas seulement un effet de l’exil géographique ou de l’isolement politique. Elle était aussi le produit d’une crise métaphysique et de ce qu’il a fini par considérer comme une réponse pathologique à cette crise. Les premières œuvres de Camus – le roman L’Étranger, l’essai philosophique Le Mythe de Sisyphe et la pièce de théâtre Caligula – explorent toutes l’expérience de l’absurde : la perception d’un univers dépourvu de sens moral intrinsèque et d’une condition de mortalité et de finitude qui contredit nos désirs. Parmi ces œuvres, Caligula est la moins connue, pourtant très éclairante, reflétant une condensation d’idées sous une forme tragique. Caligula prend conscience de l’absurdité de l’existence – l’horreur que « les hommes meurent et ne sont pas heureux » – à travers la perte d’un être cher. « Obsédé par l’impossible et empoisonné par le mépris et l’horreur », Caligula cherche à atteindre la liberté « par le meurtre et la perversion systématique de toutes les valeurs » – y compris l’amitié, l’amour et la solidarité (5). Il décide orgueilleusement d’élever la « fidélité à soi-même » au rang de valeur singulière et suprême, tombant ainsi dans une monomanie égocentrique : il « ne voit rien d’autre que sa propre idée » et « compte pour rien l’humanité et le monde que nous connaissons » (6). Il s’isole, s’empoisonne, rend l’amour et la fraternité impossibles. Ce n’est que trop tard qu’il se rend compte que c’est « un mauvais chemin, un chemin qui ne mène à rien. Ma liberté n’est pas la bonne » (7). La solitude de Caligula est en partie existentielle, en partie politique (reflétant son statut unique d’empereur), mais c’est avant tout une « erreur » éthique qu’il s’est imposé, au cœur de laquelle se trouve sa décision délibérée de nier « ce qui le lie à l’humanité ». Comme il l’apprend, « on ne peut être libre aux dépens des autres » (8). Si certaines formes de solitude peuvent être nobles, celles qui naissent du refus de reconnaître l’humanité commune avec les autres – ou l’existence de réalités au-delà de nos propres idées – sont pathologiques, ou pitoyables. Camus commence ainsi à anticiper l’affirmation de la solidarité et de la camaraderie qui marquera plus tard des œuvres telles que La Peste et L’Homme révolté.
Les premiers travaux philosophiques d’Aron abordent également la crise de la perte de sens transcendant, mais il est moins tourmenté par la menace de la solitude. Il était à l’aise avec ses racines juives, bourgeoises, patriotiquement françaises, d’une manière que ni Camus ni leur ami commun devenu antagoniste, Jean-Paul Sartre, n’ont jamais été. Les vérités de sa jeunesse ont été perturbées par la Première Guerre mondiale, qu’il avait ardemment soutenue à l’époque ; en devenant jeune adulte, Aron en est venu à abhorrer la ferveur patriotique belliqueuse dans laquelle il avait été emporté. Le héros intellectuel de ses débuts est Alain (nom de plume Emile-Auguste Chartier), un fier radical provincial, un ardent individualiste qui met l’accent sur l’impératif de dire « non » à tout pouvoir et à toute autorité extérieure. L’influence d’Alain sera éclipsée par celle de Max Weber, en qui Aron identifie une « affinité élective » avec son propre désir d’unir l’objectivité scientifique à l’action politique, et le scepticisme réaliste à l’engagement envers les valeurs (9). Aron s’est peut-être aussi reconnu une affinité avec le mélange d’individualité obstinée et d’ambivalence de Weber ; comme il l’a écrit plus tard, « Max Weber n’a jamais conseillé aucun prince … sa fureur n’a épargné ni Wilhelm II ni les révolutionnaires de 1918. Il est donc resté jusqu’à la fin le Machiavel de Heidelberg, disponible et solitaire » (10).
Aron a découvert l’œuvre de Weber pendant la période qu’il a passée en Allemagne au début des années 1930. Témoin de la montée en puissance du nazisme, il y découvre « la politique dans son essence diabolique ». Cela a obligé Aron, dit-il, à « argumenter contre moi-même, contre mes préférences intimes ; cela m’a inspiré une sorte de révolte contre l’enseignement que j’avais reçu à l’université », ce qui l’a distingué de ses professeurs et de beaucoup de ses pairs (11). En même temps, Aron n’entrait pas facilement dans un camp idéologique. Écrivant depuis l’Allemagne pour un public français, il précise qu’il n’est « ni de gauche, ni de droite, ni communiste, ni nationaliste, pas plus radical que socialiste. Je ne sais pas si je trouverai des âmes sœurs » (12). Ce ne sera pas la dernière fois qu’il se trouvera en homme isolé, qui insiste sur l’indépendance et le scepticisme : « Sans vision d’ensemble, dans le tumulte des événements, incapable d’adhérer à une faction, j’ai essayé de vivre en toute lucidité la condition historique de l’homme » (13). Ces propos reflètent le sérieux de l’individualisme moral du jeune Aron à l’égard de la politique, qu’il considérait comme une « affaire de conscience », exigeant un sérieux examen de soi et un engagement décisif (14). L’attaque d’Aron contre l’« idéalisme » était étonnamment idéaliste. Pour lui, la « politique réaliste » ne se définit pas par le culte du pouvoir ou le consentement au statu quo, mais par une « volonté spirituelle » et une « discipline » éthique marquées par la « lucidité », le courage et le « scrupule de la vérité », et aussi par une aspiration : « pour ramener les gens à la raison, nous devons d’abord leur dire la vérité, leur montrer les torts respectifs, les incertitudes des responsabilités » (15).
Le sentiment croissant d’Aron d’être à l’écart de ses pairs reflète non seulement des engagements intellectuels et politiques, mais aussi une conscience croissante de sa judéité. Depuis qu’il a été confronté à « l’antisémitisme extrême » du nazisme, Aron « s’est toujours présenté d’abord comme Juif ». En même temps, il craignait que sa judéité ne fasse apparaître ses analyses du nazisme comme partiales ; ce n’est qu’avec des amis qu’il pouvait dire ce qu’il pensait « sans être soupçonné d’avoir été emporté par mes émotions juives ». La réponse d’Aron à cette situation difficile fut à la fois de reconnaître ouvertement sa judéité et de cultiver avec acharnement une attitude de sérénité, se démarquant ainsi à la fois de ses collègues non juifs et de ceux qui étaient plus émotivement antifascistes. Ces deux aspects de sa réaction étaient une question de fierté de principe, ou de respect de soi et d’engagement envers des valeurs. Il déclara ainsi : « À partir du moment où l’on risque d’être persécuté en tant que Juif ou insulté en tant que Juif, il faut toujours dire que l’on est Juif, autant que possible sans agressivité, sans ostentation » (16). Sa judéité, combinée à ses opinions politiques largement (bien qu’hétérodoxes) de gauche et à son patriotisme, a poussé Aron à fuir la France pour Londres après la défaite de la France.
« Le sentiment croissant d’Aron d’être à l’écart de ses pairs reflète non seulement des engagements intellectuels et politiques, mais aussi une conscience croissante de sa judéité. »
Pour Camus comme pour Aron, la condition de résistance était un curieux mélange de solitude et de solidarité. Parfois, cette dernière était même renforcée par la première : ceux qui s’engageaient dans une lutte commune pouvaient trouver du réconfort dans le sentiment d’être liés à leurs camarades, même si ces derniers étaient invisibles ou en fuite. En dirigeant Combat, Camus a acquis le sentiment de parler au nom d’un mouvement d’idéalistes politiques aux vues similaires, auquel il avait aspiré, mais qu’il aurait rarement pu atteindre aussi pleinement à un autre moment de sa vie. Pourtant, la réflexion la plus artistiquement vivante de son expérience de l’occupation et de la résistance met l’accent sur la manière dont la solidarité et l’amitié ont constamment lutté contre l’isolement et la solitude. La Peste dépeint la terrible solitude de ceux qui sont séparés de leurs proches. La vie sous la peste est une vie d’isolement, de silence et de solitude, de conversations imaginées avec des êtres chers absents, de « monologues stériles et répétés … de colloques avec des murs blancs » dans lesquels les mots sont vidés de leur sens parce qu’ils ne suscitent aucune réponse, d’une « extrême solitude » dans laquelle « personne ne pouvait compter sur l’aide de son voisin » ; « les cœurs s’étaient endurcis ; les gens vivaient à côté de ces gémissements ou passaient à côté d’eux comme s’ils étaient devenus le discours normal des hommes » (17). Ces descriptions reflètent l’expérience de Camus pendant la guerre, au cours de laquelle les combattants et les non-combattants ont connu une « terrible solitude » et un « désespoir humilié ». Camus a noté « la haine et la violence que l’on sent déjà monter chez les gens. Il n’y a plus rien de pur en eux. Rien d’unique » (18). La condition de lutte et l’expérience de la perte imposent également un engourdissement nécessaire des sentiments. Ressentir de la pitié, percevoir pleinement la souffrance qui nous entoure, serait paralysant. Le monde de la peste et de l’occupation est aussi un monde de méfiance, puisque le voisin peut nous infecter ou nous trahir. Se craignant les uns les autres et nécessairement tournés vers leur propre survie, les victimes de la peste se replient sur elles-mêmes.
Mais la peste crée aussi un « sentiment de camaraderie » fondé sur la prise de conscience que la lutte contre la peste est « l’affaire de tous ». Rambert, journaliste français venu à Oran et piégé par la peste, coupé de la femme qu’il aime, ne pense d’abord qu’à sa propre situation. Il finit par rejoindre les brigades sanitaires organisées pour lutter contre la peste : il a compris que s’il n’y a pas de honte à vouloir être heureux, « il peut être honteux d’être heureux tout seul » (19). Face à la peste, les hommes doivent « retrouver leur solidarité pour faire la guerre à leur destin révoltant » (20). De cette solidarité dans la souffrance naît le sens de la fraternité : l’amour de l’amitié, de ceux qui se soutiennent loyalement dans leurs luttes communes – et dans les luttes individuelles qui, par la solidarité, deviennent des luttes communes.
L’idée qu’une condition de souffrance partagée puisse servir de base à une communauté de camaraderie vivante et libre est devenue l’idéal qui éclaire les ténèbres de l’absurde et de l’horreur dans la pensée d’après-guerre de Camus. Le « sentiment d’étrangeté » – d’éloignement ou d’aliénation – éprouvé face à une existence absurde n’est pas quelque chose d’unique, mais une souffrance partagée par tous, de sorte que le malheur individuel n’est qu’un petit fragment du malheur collectif. En se sentant seul, nous ne sommes pas seuls (21). La solidarité est née de « la souffrance nue, commune à tous », dont le seul antidote était « la communauté des hommes qui la combattent » (22). Mais cette solidarité, qui pouvait être si forte et si pure, était aussi fragile. Elle est menacée non seulement par l’égoïsme, mais aussi par une tendance à l’abstraction qui peut pervertir le sentiment de solidarité lui-même.
Aron n’a pas eu à subir les angoisses du travail clandestin dans la France occupée. En même temps, il subit une douloureuse coupure avec sa patrie. Personnellement, il a souffert de la mort de sa mère au milieu de la défaite militaire de la France ; il a été séparé de sa femme et de ses filles, restées dans la France occupée, jusqu’à ce qu’elles puissent s’échapper et le rejoindre à Londres en 1943. (Malgré cela, ses relations personnelles sont restées importantes pour Aron : privé de ses biens et de ses lieux familiers, ce sont ses liens avec sa famille et ses amis qui lui ont permis de « rester moi-même » (23)). Il est en outre un traître à la France aux yeux du gouvernement de Vichy et de ses partisans qui, en juillet 1940, sont nombreux. Malgré ces tribulations, Aron conserve un certain équilibre intellectuel : les analyses du régime de Vichy qu’il publie dans La France Libre, journal d’obédience gaulliste, se distinguent par leur calme et leur objectivité (ce qui ne lui vaut pas toujours les faveurs du Général et de son entourage). Aron aurait pu bénéficier de plus de réconfort et de camaraderie s’il avait embrassé totalement la cause gaulliste (ou communiste). Mais sa perception lucide de l’incertitude et de la complexité de la situation dans laquelle se trouve la France l’en empêche. Il savait qu’au lendemain de la défaite, des personnes de bonne volonté et de bon jugement aient pu décider que Vichy était le seul moyen de sauver ce qui restait de la France – ou qu’il s’agissait d’une concession, fatale par la suite pour la France. Il savait également que la résistance – que ce soit à l’aide d’un char d’assaut ou de sa plume – était la seule voie qu’il pouvait emprunter.
« L’idée qu’une condition de souffrance partagée puisse servir de base à une communauté de camaraderie vivante et libre est devenue l’idéal qui éclaire les ténèbres de l’absurde et de l’horreur. »
La voie d’Aron exigeait à la fois de la résolution et la capacité à supporter le doute. Comme il l’a fait remarquer plus tard, si quelqu’un veut « éviter la torture des doutes persistants, tout ce qu’il peut faire est de se construire un système de valeurs et d’y adhérer. S’il décide, une fois pour toutes, de s’attacher aux destinées d’un parti politique déterminé, il n’aura plus de doutes, mais il devra faire face aux conséquences de sa décision ». Contre les partisans dogmatiques et les opportunistes qui attendent que les événements leur indiquent la voie à suivre, Aron a suivi la voie de ceux « qui sont assez sages pour ne pas se soumettre à l’histoire ni aux principes comme seul guide » – même s’il savait que cela l’exposerait à des accusations de trahison des principes ou de non-reconnaissance de la « loi de l’histoire » (24). Cette combinaison d’indépendance vis-à-vis des partis, d’insistance à reconnaître avec tolérance la validité de différentes lignes de conduite face à l’incertitude, et d’adhésion ferme à des principes qui rejetaient la tyrannie, anticipait la solitude ultérieure d’Aron à l’ère de la polarisation idéologique.
II. Après la victoire : intégrité intellectuelle et isolement idéologique
Après la libération de la France et la victoire sur le nazisme qui s’ensuivit, Aron et Camus se retrouvèrent tous deux membres du même cercle d’intellectuels engagés et démocratiques. Aron rejoint Camus à Combat ; tous deux font partie du collectif éditorial des Temps Modernes de leur ami commun Sartre. Cette unité n’a pas duré longtemps ; tous deux se sont éloignés de la revue et du cercle de Sartre – et de Sartre lui-même. Le départ d’Aron s’est produit plus tôt et a été moins douloureux, parce qu’il avait déjà acquis une plus grande indépendance intellectuelle et une plus grande confiance en soi, ainsi qu’une plus grande distance politique et, selon toute vraisemblance, émotionnelle par rapport au groupe des Temps Modernes. La rupture de Camus avec le cercle de Sartre, lorsqu’elle eut lieu, fut fameusement publique et amère.
La cause, dans les deux cas, fut la politique durant la guerre froide. Sartre, un « acommuniste », tout en critiquant (de manière sélective) l’Union soviétique, était encore plus critique à l’égard de l’Amérique, de l’anticommunisme (« tout anticommuniste est un chien » (25), déclarait-il) et du libéralisme bourgeois. Aron n’était pas gêné d’affirmer ses principes libéraux et ses affiliations bourgeoises ; il était prêt à défendre l’Amérique et ses alliés comme représentant, non pas le bien contre le mal, mais le « préférable » contre le « détestable », c’est-à-dire la tyrannie soviétique (26). Cela le relie à un réseau d’intellectuels à travers l’Occident, mais fait de lui une figure solitaire dans la vie intellectuelle parisienne. Camus, pour sa part, a gardé ses distances avec les deux camps de la guerre froide, condamnant l’inhumanité partout où il la trouvait. Cela signifie que, comme le jeune Aron, il n’était ni tout à fait d’un « côté » ni tout à fait de l’autre. Il s’est aliéné les champions de l’Occident en condamnant les armes nucléaires et le soutien des démocraties à des tyrannies telles que l’Espagne franquiste avec la même passion morale qu’il s’attaquait à l’impérialisme et à la répression soviétiques. Mais l’hypocrisie, ou l’aveuglement sélectif, des défenseurs occidentaux du communisme lui valait des reproches particulièrement sévères. Aron et Camus s’en prenaient tous deux à l’inhumanité ou à l’aveuglement qu’ils trouvaient le plus proche d’eux, dans la vie intellectuelle française (L’opium des intellectuels d’Aron, devenu un classique de l’anticommunisme de la guerre froide, s’intéressait bien plus aux principaux « mythes » de la gauche parisienne qu’à la politique soviétique ou à la théorie marxiste en tant que telle). Tous deux, par conséquent, se sont sentis très seuls dans leur propre jardin, même s’ils ont été célébrés à l’étranger.
L’acte qui a le plus immédiatement précipité l’expulsion de Camus de la gauche parisienne – le laissant isolé et blessé – était, ironiquement, une affirmation de solidarité : son essai L’Homme révolté, publié en 1951. Comme ses œuvres précédentes, il s’agit d’une réponse au problème d’un nihilisme qui affirme la « solitude » dans un univers dépourvu de sens et de justice (27). Cependant, Camus se préoccupe également du problème des « crimes logiques », des massacres et des tortures perpétrés au nom de la justice selon la conception des idéologies. Le monde de la guerre idéologique est un monde de silence terrible et d’aliénation entre les partis, les nations et les individus ; un monde non seulement de « menace » mais de « solitude », né de l’inimitié, de la peur et de l’absence de communication (28). L’un des principaux objectifs de l’ouvrage était d’analyser comment la pulsion de « rébellion » contre l’injustice de l’existence avait conduit à un tel état de fait.
Pour Camus, l’acte de rébellion est en soi unificateur : il « sort l’individu de sa solitude », lui fournissant un terrain d’entente, la base d’un sentiment de camaraderie : « Je me révolte, donc nous existons » (29). Contre la solitude de l’aliénation du monde, la rébellion affirme une humanité commune, quelque chose en tous les êtres humains qui attribue à chacun une valeur intrinsèque. De plus, la rébellion est souvent provoquée non pas par sa propre souffrance, mais par le fait d’être témoin de la souffrance des autres, ce qui crée « un sentiment d’identification avec la victime » – et, plus encore, un sentiment de solidarité (30). Le mouvement de rébellion est « couronné » par le cri d’Ivan Karamazov : « si tous ne sont pas sauvés, à quoi sert le salut d’un seul ? » (31). Bien comprise, cette exigence impose des limites nécessaires à la rébellion : la rébellion doit respecter la liberté des autres – elle ne doit pas devenir despotique ou meurtrière. Le rebelle « n’humilie personne. La liberté qu’il revendique, il la revendique pour tous ; la liberté qu’il refuse, il en interdit la jouissance à tous. Il n’est pas seulement l’esclave contre le maître, mais aussi l’homme contre le monde des maîtres et des esclaves ». La liberté doit donc être relative et non absolue, et en relation avec d’autres personnes également libres (32).
L’Homme révolté est, d’une certaine manière, une œuvre profondément individualiste, affirmant la valeur et les droits de chaque individu. Mais il affirme également l’interdépendance et l’enracinement profonds des individus, ainsi que l’impératif d’affirmation mutuelle. Les « esprits » individuels, déclare Camus, ne commencent à exister que lorsqu’ils se rencontrent ; nier l’existence ou le droit à l’existence des autres, chercher à les nier, c’est mettre en péril sa propre identité morale. La solitude est moralement dangereuse. S’habituer à vivre sans les autres, sans avoir à les reconnaître, à leur répondre ou à les respecter, favorise une éthique qui valorise le pouvoir et la domination – la capacité d’une seule volonté à s’exercer sur les autres (33). La rébellion est trahie ou pervertie lorsqu’elle devient obsédée par la conquête du pouvoir ou par la recherche de la cohérence et de l’unité, qui sont incompatibles avec l’existence des autres qui introduisent des complications et des contradictions (34). Vivre avec les autres, c’est embrasser le dialogue, et avec lui, la contradiction et l’ouverture ; le contrôle total, l’unanimité totale, exigent l’établissement d’un monologue – ou d’un silence.
« La rébellion doit respecter la liberté des autres – elle ne doit pas devenir despotique ou meurtrière. »
De même que L’Homme révolté rejette la volonté de soumettre les autres à notre volonté, il rejette la dépendance servile à l’égard de l’opinion d’autrui. Il suggère en effet que ces tendances à la domination et à la dépendance peuvent aller de pair. Chercher à atteindre sa propre individualité ou sa propre liberté aux dépens des autres, c’est en même temps devenir dépendant des autres, perdre son pouvoir. L’archi-individualiste, le dandy, ne peut exister que par la défiance et compte sur l’attention des autres pour s’affirmer ; il est en fin de compte à la fois dépendant et solitaire ; et pour lui, « être seul, c’est ne pas exister » (35). (On peut penser qu’il en va de même pour les divers provocateurs et exhibitionnistes qui peuplent aujourd’hui une grande partie de la scène publique et de la vie politique).
Camus lui-même a clairement ressenti le besoin d’une certaine forme d’affirmation à l’égard d’autrui, ainsi qu’un sentiment de solidarité avec eux. L’Homme révolté – et son prédécesseur immédiat, la pièce Les Justes (1949) – reflètent à la fois l’aspiration à une solidarité née de l’indignation, de l’amour et de l’honneur partagés, et le désespoir face à l’échec de cette solidarité, à la perversion de la camaraderie en conformisme et en coercition, et finalement aux purges qui exigent la trahison des autres, ou l’aveu de la trahison, comme seul signe adéquat de loyauté. La camaraderie révolutionnaire des « assassins justes » ou des « meurtriers scrupuleux » est « solitaire ». Coupés de la société, leur fraternité disposait d’une intensité et d’un caractère sacré qui n’avaient rien à voir avec les relations humaines ordinaires – l’ensemble les soutenait (36). Pourtant, leur amour était abstrait et meurtrier – un amour « absolu » qui apportait une « joie pure et solitaire », mais aucun lien humain véritable, un amour qui est « une voix solitaire, un monologue » (37). Ces rebelles se sont engagés sur une voie qui allait conduire, chez leurs successeurs plus froidement fanatiques, à une « révolution calculée » qui préférait « un concept abstrait de l’homme à un homme de chair et de sang » (38). Une grande partie de l’œuvre de Camus est une bataille contre la tendance à l’abstraction. Comme il le déplorait, « ce sont les idées générales qui font le plus mal », parce qu’elles coupent le lien entre les fins ou les objectifs de la lutte politique et les êtres humains réels qui en bénéficient ou en souffrent (39).
Contre l’abstraction qui nous rend aveugles à la réalité des êtres humains vivants et contre l’impitoyabilité qui subordonne ces individus à une cause plus vaste et impersonnelle, Camus a souligné l’importance de l’amour pour les individus. Comme il l’a avoué, « je ne peux aimer l’humanité entière que d’un amour vaste et quelque peu abstrait. Mais j’aime quelques hommes, vivants ou morts, avec une telle force et une telle admiration que je suis toujours désireux de préserver chez les autres ce qui les fera peut-être un jour ressembler à ceux que j’aime » (40). Sa déclaration tristement célèbre (et souvent mal citée) selon laquelle, entre la justice – ou plutôt une conception de la justice qui justifiait le meurtre d’innocents – et sa mère, il préférait cette dernière atteste, non pas d’un manque de souci de la justice, mais de la conviction que ce souci doit s’enraciner dans la reconnaissance et l’attachement à des personnes réelles (41).
Les réactions de Camus à la guerre sanglante pour l’indépendance de son pays natal, l’Algérie, ont provoqué chez lui une solitude plus grande encore que sa rupture avec Sartre. Camus se sentait, pensait et parlait comme un Algérien français dont l’engagement en faveur de la justice et l’opposition à l’humiliation et à la misère « des Algériens de souche » avaient offensé d’autres pieds-noirs et la droite française, mais dont l’aspiration à préserver une Algérie plus égalitaire au sein d’une confédération française et l’opposition au terrorisme libérateur l’avaient éloigné des « Algériens de souche » et de la gauche. Alors que les forces du centre en Algérie disparaissent rapidement, entraînées vers l’un ou l’autre extrême ou massacrées par les deux camps, Camus se retrouve politiquement isolé. Pire encore, il s’est retrouvé à imaginer et à ressentir les souffrances de l’Algérie, alors que ceux qui l’entouraient traitaient ce pays comme une cause ou un moyen au service d’une contre-stratégie. Peu de choses permettent d’expérimenter autant la solitude que d’éprouver des sentiments que personne autour de soi ne semble partager. Camus a cherché à combler le fossé entre les individus et les communautés, à favoriser le dialogue. Lorsqu’il est devenu évident qu’il n’était plus possible, il a cessé de faire des déclarations publiques (tout en continuant à faire pression en privé sur le gouvernement français pour qu’il accorde sa clémence aux résistants algériens). Ce silence public était un acte moral, un refus de fournir des excuses à l’inhumanité, ou d’embellir sa propre image d’autorité morale en émettant des déclarations nobles qui ne pouvaient servir à rien, et une protestation contre la surdité volontaire des deux parties, une démonstration de la mort du dialogue.
Aron était beaucoup moins investi émotionnellement dans ce qu’il appelait « la tragédie algérienne » ; ceci, ainsi que son penchant naturel et sa culture délibérée de la froideur analytique lui ont permis de lancer des appels d’une lucidité frappante en faveur du retrait de la France, qui ont provoqué la fureur de la droite nationaliste, mais qui étaient influents de la part d’un homme qui était loin d’être un moraliste de gauche. Aron, devenu chroniqueur au Figaro était, comme Camus, prêt à prendre des positions politiques qui l’isolaient. Mais il était plus à l’aise avec le destin que cela lui imposait. La déclaration souvent citée « mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron » ne semble pas lui avoir causé une grande détresse (bien que les attaques les plus vives de mai 1968 – y compris la suggestion de son vieil ami Sartre de faire défiler Aron nu dans la Sorbonne devant une foule d’étudiants en raillerie, et l’humiliation ou l’abaissement de la part de ses collègues universitaires – semblent avoir temporairement perturbé son sang-froid réputé) (42).
Il ne faut pas en conclure qu’Aron n’avait pas conscience de la douleur ou du danger de la solitude. Il reconnaissait le sentiment de solitude comme une blessure dont beaucoup de ses contemporains souffraient et cherchaient à s’échapper – avec des résultats désastreux : il observait ainsi que des existentialistes tels que Sartre et Merleau-Ponty, « obsédés par la solitude humaine », cherchaient la réconciliation dans la vision communiste de la « communauté mythique » (43). Il était également beaucoup moins critique à l’égard de la partisanerie politique que Camus. Alors que Camus rêvait d’une politique sans partis, Aron admettait que l’intérêt collectif et le tribalisme partisan étaient des caractéristiques de la politique qui ne pouvaient être éradiquées dans les sociétés modernes. Malgré tous leurs défauts, les partis ont permis une compétition pacifique pour le pouvoir, ont rendu possible la participation réelle ou potentielle de tous les citoyens et ont servi de canaux de débat, ne constituant pas un obstacle à la délibération, mais au contraire un véhicule pour celle-ci (44). Cependant, il subsiste une tension entre « la discipline et la doctrine du parti » et l’intégrité intellectuelle. Aucun universitaire qui se respecte n’acceptera le programme d’un parti politique dans son intégralité. Et au cours de la lutte politique, chaque parti déploiera des « arguments injustes ou trompeurs » contre ses adversaires ; chaque parti imposera une idéologie, déformera la vérité et exigera donc un compromis en matière d’intégrité et d’honnêteté intellectuelles (45).
Ce n’est pas un compromis qu’Aron lui-même pouvait faire. Tout comme Camus, il conservait une indépendance fière et fondée sur des principes vis-à-vis des factions politiques. Comme il l’a avoué, « la fidélité à un parti n’a jamais été une décision d’une importance fondamentale… Selon les circonstances, je suis en accord ou en désaccord avec l’action de tel ou tel mouvement ou de tel ou tel parti ». Aron ajoute : « Une telle attitude est peut-être contraire à la moralité (ou à l’immoralité) de l’action politique ; elle n’est pas contraire aux obligations de l’écrivain » (46). Il reconnaîtra plus tard qu’en termes d’habitudes de vote, « je suis un intellectuel de droite, mais d’une race un peu particulière, c’est-à-dire indiscipliné et rarement d’accord avec la personne pour laquelle il a voté. Je critique l’homme pour lequel j’ai voté aussi librement que je critiquerais l’autre candidat s’il avait été élu » (47). Le président Georges Pompidou a ainsi déclaré : « On ne peut jamais compter sur Raymond Aron », preuve d’un manque de fiabilité idéologique et partisane dont Aron était manifestement fier. Son « ambition ou intention intellectuelle » était d’« avoir mon propre point de vue sur tous les sujets, quelles que soient les opinions des gouvernants », ce qu’il considérait comme « la seule posture honorable » pour un commentateur (48). En même temps, Aron était résigné au fait qu’il ne pouvait pas servir de « conseiller, même à un prince dont j’acceptais les préférences fondamentales », en raison de ses scrupules moraux : s’il pouvait comprendre, et même accepter, la nécessité d’avoir (selon l’expression de son vieil ami et adversaire Sartre) « les mains sales » en politique. « Mon tempérament n’est pas tout à fait compatible avec mes opinions » : il ne pouvait pas conseiller aux dirigeants de commettre des trahisons ou des atrocités, et dormir la nuit (49).
Aron a reconnu que, compte tenu de l’humeur de l’époque, sa position le conduirait à l’isolement. Dans une époque de polarisation, les écrivains sont « réduits à la solitude ou au sectarisme » (50). Il choisit sans hésiter le premier sort, tout en reconnaissant que, « sans parti », ses opinions « heurteront tour à tour tout le monde, d’autant plus insupportable qu’il se veut excessivement modéré, et qu’il cache ses passions sous des arguments » (51).
« Tout comme Camus, [Raymond Aron] conservait une indépendance fière et fondée sur des principes vis-à-vis des factions politiques. »
Ainsi, Aron a souvent été perçu comme froidement dépassionné. Pourtant, son maintien de l’indépendance reflétait en fait des convictions et des loyautés passionnées. Les valeurs auxquelles Aron se déclare le plus attaché sont « la vérité et la liberté… L’amour de la vérité et l’horreur du mensonge – je pense que c’est ce qu’il y a de plus profond dans ma façon de vivre et de penser. Et pour pouvoir exprimer la vérité, il faut nécessairement être libre. Il ne doit pas y avoir de pouvoir extérieur qui nous restreigne » (52). L’engagement en faveur de la vérité a pris une forme particulière : non pas l’affirmation d’un dogme ou la résolution d’un désaccord, mais la préservation d’une société qui accepte le dialogue. Pour Aron, le choix politique fondamental de son époque se situait entre les sociétés qui acceptent et protègent le dialogue et celles qui le suppriment ; il se rangeait passionnément du côté des premières (53). Alors que son indépendance vis-à-vis des partis pouvait suggérer une neutralité idéologique, son incapacité à s’attacher à un mouvement ou à un gouvernement reflétait sa propre affiliation idéologique : vers la fin de sa vie, il déclarait : « Je me retrouve une fois de plus isolé et opposant, le destin habituel d’un authentique libéral » (54).
III. Honneur, intégrité, doute : la vocation et l’éthique de la solitude
Pour Aron comme pour Camus, la solitude est le prix à payer pour se consacrer à l’intégrité et à la sincérité. L’intégrité les empêchait d’embrasser des causes ou des actions qui allaient à l’encontre de leurs croyances ou de leur jugement ; l’engagement à la vérité les poussait à défendre et à critiquer même si cela les rendait impopulaires, les excluait ou les isolait. Comme nous l’avons vu, cette attitude pouvait être coûteuse. Mais cela n’était pas sans avantages. Camus, après tout, a remporté le prix Nobel et est resté un héros pour de nombreux jeunes radicaux (et leurs aînés) à l’étranger, même si sa réputation a subi une éclipse dans les cercles intellectuels français. Aron a exercé une influence sur les dirigeants politiques, tant en France qu’à l’étranger, dont peu d’autres journalistes français, et peu d’autres intellectuels du vingtième siècle, peuvent se targuer d’avoir joui. Pourtant, tous deux étaient prêts à renoncer aux promotions et à la popularité s’il s’avérait que c’était le prix à payer pour l’honnêteté et l’engagement envers les principes.
Qu’est-ce qui a rendu Aron et Camus si indigestes pour les camps et les mouvements de leur époque ? Certainement leur intégrité et leur honnêteté, mais surtout les formes particulières que ces vertus ont prises : une combinaison d’indépendance, de modération, de scepticisme, de fierté, de modestie, de tolérance et d’humanité, qui a empêché Aron et Camus de se sentir à l’aise eux-mêmes, ou d’être à l’aise pour les autres, au sein d’une orthodoxie ou d’un mouvement. Comme indiqué plus haut, Aron insistait sur son indépendance intellectuelle, sur le fait qu’il devait se faire sa propre opinion, plutôt que de suivre une ligne de parti ou un dogme théorique. Camus, lui aussi, a cherché à voir par lui-même et sans les lunettes ou les œillères fournies par d’autres – depuis son refus, dans sa jeunesse, de placer un volume de Marx entre lui et la réalité, et son enquête sur les conditions causant la famine en Algérie, jusqu’à sa condamnation des procès-spectacles communistes, et ses enquêtes sur des cas individuels de terroristes accusés, et son lobbying auprès du gouvernement pour un traitement juste basé sur les détails de ces cas, au cours du conflit algérien ultérieur.
Maintenir son indépendance sous la pression, face à l’hostilité et au doute, exige un certain degré de confiance en soi, voire de fierté. Pour Aron comme pour Camus, l’orgueil est une impulsion équivoque mais importante, à la fois précieuse et dangereuse ; c’est une source de résistance et d’intégrité, mais aussi d’orgueil démesuré, de fureur et de fanatisme. Pour Camus, c’était la clé de la rébellion – il parlait du récit présenté dans L’Homme révolté comme de « l’histoire de l’orgueil européen » (55). Camus espérait que « l’orgueil inépuisable » de la rébellion lui permettrait de résister aux terreurs de la dictature révolutionnaire et à la tyrannie de la logique historique (56). Mais l’orgueil n’est pas – et est même parfois contraire à la sagesse ; détaché de la solidarité, de la modération et de la compassion, il contribue à la perversion de la rébellion en nihilisme et en meurtre (tout comme Camus l’avait dépeint dans Caligula) (57).
Aron, lui aussi, reliait les régimes totalitaires – et les « religions séculières » qui les inspiraient et qu’ils imposaient comme dogmes – à un orgueil excessif, dix ans avant que Camus n’écrive son « histoire de l’orgueil européen ». Aron l’a devancé en invoquant Ivan Karamazov pour illustrer à la fois l’« orgueil titanesque » auquel l’humanité moderne est tentée, et ses résultats d’anéantissements (58). L’orgueil serait inspiré par la richesse matérielle et la puissance nationale et encouragerait leur diffusion, générant ainsi l’impérialisme ; il donnerait naissance au mythe hubristique de pouvoir contrôler l’histoire, conduisant à des efforts prométhéens et à des crimes titanesques (59). L’orgueil a également incité les intellectuels visés par la critique d’Aron à embrasser l’idéologie, qui leur a procuré un sentiment de certitude et de puissance (60). Cependant, pour Aron, le « réaliste » froid, tout comme pour Camus, l’idéaliste ardent, l’orgueil avait également une valeur positive en inspirant le défi au poids écrasant de la nécessité historique. Aron se souvient de la fierté salvatrice exprimée par les Français libres à Londres, après la chute de la France en juin 1940 ; le premier ordre du jour, lu aux volontaires, était les mots attribués à Guillaume le Silencieux, « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour essayer, ni de réussir pour persévérer ». Se souvenant de ces mots trois ans plus tard, Aron a vu dans cette phrase provocatrice « le mot d’ordre de la révolte, toujours vaincue et toujours victorieuse – la révolte de la conscience » (61).
Le sens de l’honneur, auquel Aron et surtout Camus font appel, est une forme de fierté non infaillible, mais plus fiable parce que plus éthique et plus retenue. L’honneur est un sentiment de respect de soi profondément enraciné, gagné par un engagement acharné à vivre à la lumière des valeurs auxquelles on croit. Cela signifie que l’honneur exige de maintenir l’indépendance morale, en agissant conformément à ses principes. La personne honorable refusera de faire certaines choses – ou de les faire faire en son nom ou pour son compte – parce qu’elles vont à l’encontre de l’essence morale de son être (62). Pour Aron comme pour Camus, la défense de l’honneur représentait un défi urgent aux courants de leur époque. Ils reconnaissaient que la notion d’honneur semblait désuète, démodée. Dans Les Assassins Justes, le proto-bolchevique Stepan ricane que l’honneur est « un luxe réservé aux gens qui ont des carrosses et des paires », ce à quoi le révolutionnaire Kaliayev, plus idéaliste, répond que « c’est la seule richesse laissée à l’homme pauvre » (63). Kaliayev se fait ici le porte-parole de son créateur, qui déplore le mépris de ses contemporains pour l’honneur, qu’il considère comme une relique aristocratique, une « vertu des injustes ». À ce mépris, il rétorque qu’il a besoin de l’honneur « parce que je ne suis pas assez grand pour m’en passer ! » (64). Lorsque la justice est impuissante, que l’intérêt personnel conseille la capitulation, que la raison pointe vers le désespoir et que la logique est devenue meurtrière, la « vertu déraisonnable » de l’honneur est nécessaire pour motiver la persévérance et la décence (65). Pour Aron, la « sinistre originalité des tyrannies du XXe siècle » est qu’elles « détruisent l’honneur de leurs opposants. Elles veulent créer un homme nouveau qui vénère ses maîtres et considère leur décision comme un dogme irrévocable ». Un tel assaut contre la dernière citadelle de la dignité humaine exige la résistance. Dans un tel monde, la trahison elle-même – l’acte ultime de se mettre à l’écart – ne serait plus « la plus basse de toutes les fautes humaines ». Au contraire, elle deviendra rare et sublime, le dernier refuge de la liberté (66).
L’honneur et l’intégrité exigent de maintenir une indépendance provocante dans ses engagements. Mais qu’est-ce qui distingue alors une personne intègre d’un fanatique ? En partie, selon Aron, c’est précisément ce refus de subordonner ses perceptions ou ses valeurs aux exigences d’un dogme ou d’une force plus vaste. Le « non-fanatique » intègre « refusera toujours de se soumettre entièrement à la fatalité de l’histoire ou à la valeur absolue de ses principes. Il arrivera toujours un moment où il devra dire au fanatique des principes : « Cela, je ne pourrai jamais l’accepter » (67).
L’intégrité se distingue également du dogmatisme en ce qu’elle permet une certaine souplesse face au changement et à la nuance, à condition que cette souplesse soit réfléchie et volontaire, et non le reflet de la lâcheté ou de la vénalité. Dans des circonstances différentes, des actions différentes seront nécessaires pour promouvoir les mêmes idéaux. Comme l’affirme Aron, « j’ai essayé de servir les mêmes valeurs dans des circonstances différentes et par des actions différentes. Je crois que j’ai été fidèle à moi-même, fidèle à mes idées, à mes valeurs et à ma philosophie. Avoir des opinions politiques, ce n’est pas avoir une idéologie une fois pour toutes, c’est prendre les bonnes décisions dans des circonstances changeantes ». Ce qui ne veut pas dire, s’empresse-t-il d’ajouter, qu’il ne s’est pas « trompé assez souvent ». Mais, affirme-t-il, « je n’ai pas trahi les valeurs et les aspirations de ma jeunesse » (68). L’attitude mature d’Aron était, en effet, cohérente avec l’appel qu’il lançait à ses lecteurs en 1938 pour qu’ils évitent à la fois l’inconstance et la constance dogmatique, et qu’ils cultivent la « sincérité » en s’engageant à atteindre des objectifs qui restaient ouverts à la révision. Cette « solution », reconnaissait Aron, semblait « insuffisante et vague, puisqu’elle se limite […] à signaler les contradictions de la vie ». Mais face à ces contradictions, communes à tous, chacun se retrouve seul, et chacun élabore sa solution. (69).
« Le sens de l’honneur, auquel Aron et surtout Camus font appel, est une forme de fierté non infaillible, mais plus fiable parce que plus éthique et plus retenue. »
La grande différence entre l’intégrité qui a permis à Aron et Camus de rester isolés et honorables, et l’intégrité des fanatiques auxquels ils s’opposaient, était leur attachement à la modération. La modération est une vertu fréquemment invoquée (dont la vertu est remise en question aussi souvent qu’elle est affirmée) ; elle a été au cœur de nombreuses éthiques, dont les disparités se reflètent dans des compréhensions très différentes de ce que signifie la modération (70). La modération pratiquée et louée par Aron et Camus n’était pas simplement, ou principalement, une position politique centriste, à mi-chemin entre la gauche et la droite (Camus, en effet, était indéniablement un homme de gauche). Elle avait une dimension politique ou idéologique : elle rejetait les attitudes et les pratiques de loyauté et d’hostilité sectaires, reconnaissant que son propre camp ou sa propre cause pouvait être profondément défectueux, tandis que ses adversaires pouvaient avoir à la fois des idées valables et de bonnes intentions. Mais la modération reflétait également une attitude et une réponse plus larges sur le monde, qui s’exprimait le mieux, selon Camus, à travers le genre et l’esprit de la tragédie. La tragédie, écrit Camus, est « ambiguë » ; elle présente des forces opposées qui sont « à la fois bonnes et mauvaises », « également légitimes, également justifiées », mais condamnées à s’affronter. C’est pourquoi le chœur des tragédies classiques « conseille généralement la prudence. Car le chœur sait que, jusqu’à une certaine limite, tout le monde a raison et que celui qui, par aveuglement ou par passion, dépasse cette limite court à la catastrophe s’il persiste à vouloir faire valoir un droit qu’il croit être le seul à posséder » (71). Cette modération tragique était bien loin de la recherche (implicitement optimiste) d’un consensus anodin fréquemment (et souvent – mais pas toujours – injustement) associée aux modérés politiques.
La modération était donc étroitement liée à la modestie et à l’autocritique, mais aussi à la critique des autres pour leurs excès dangereux, leurs exagérations déformantes, leurs vertus imparfaites et leur prétendue perfection. La modération consistait à insister sur la nécessité de voir tous les aspects d’une question et les défauts de son propre cas, au lieu d’embrasser un cas ou une cause avec une dévotion aveugle. L’absence de modération, avec son cortège d’hésitations et de scrupules, est un mauvais signe. Comme l’a écrit Camus, nous devrions nous méfier « des juges qui n’ont jamais de doutes et des héros qui n’ont jamais de tremblements » (72).
Adopter une éthique de la modération, comme le savaient Aron et Camus, ce n’était pas prendre le chemin de la moindre résistance. Au contraire, comme le remarquait Camus, dans un monde idéologiquement polarisé et enfiévré, « l’excès est toujours un confort, et parfois une carrière ». La modération, quant à elle, n’est que « pure tension », causée par la volonté de rendre justice à toutes les parties, de rester en contact avec les pôles opposés de la réalité et de l’idéalisme. C’est la fatigue de cette tension qui a conduit de nombreuses personnes à s’abandonner à l’un ou l’autre extrême (73). Bien sûr, la modération peut elle-même être lucrative – il y a ceux qui ont de l’argent ou des titres à distribuer qui se considèrent comme modérés et qui sont heureux de promouvoir les défenses de la modération par d’autres. Mais une modération véritablement sceptique et fondée sur des principes – une modération qui ne craint pas d’être accusée d’extrémisme lorsqu’elle doit protester contre une orthodoxie centriste confuse ou un conformisme carriériste au nom de ce que Camus reconnaissait comme la véritable modération de la révolte fondée sur des principes – est beaucoup moins confortable, ou conformable. En période de polarisation et de choix politiques à forts enjeux, le modéré de principe, comme le funambule, devra faire preuve d’un courage considérable, ainsi que d’une grande habileté et d’un grand jugement, pour maintenir un équilibre décent (74).
Camus et Aron ont cherché à la fois à conserver la modestie et à l’encourager chez les autres. Pour ce faire, ils ont souvent dû lancer des défis et des reproches qui ont perturbé à la fois leurs adversaires et leurs alliés. Comme Camus se l’est écrit un jour, « la seule vocation que je me sens, c’est de dire aux consciences qu’elles ne sont pas sans tache et aux raisons qu’il leur manque quelque chose » (75). Cela signifiait aussi parfois refuser d’offrir le confort de déclarations décisives. Aron imaginait un interlocuteur frustré le réprimander : « Tout le monde veut une solution et vous n’offrez que des problèmes » (76).
« Aron et Camus ont rejeté […] toute théorie ou idéologie qui considère la politique comme le sommet ou la facette la plus essentielle de la vie. »
Aron et Camus étaient, il est clair, des sceptiques, mais pas des cyniques ; chacun a lutté tout au long de sa vie pour trouver le juste équilibre entre le doute et l’engagement, une reconnaissance modeste des limites de notre connaissance et de notre vertu, et une insistance ferme sur un certain niveau de vérité, de lucidité et de décence. Ils étaient sceptiques parce qu’ils reconnaissaient que les prétentions humaines à la certitude n’étaient pas seulement infondées, mais qu’elles pouvaient souvent devenir meurtrières. Comme le déplorait Camus, « nous avons été témoins de tromperies, d’humiliations, d’exécutions, de déportations et de tortures et, à chaque fois, il a été impossible de persuader ceux qui faisaient ces choses de ne pas les faire, parce qu’ils étaient sûrs d’eux-mêmes… Nous étouffons parmi les gens qui croient qu’ils ont absolument raison » (77). Même s’ils désavouent la violence, ceux qui sont totalement convaincus de leur droiture absolue deviennent sourds aux autres voix, aveugles aux vérités qui ne correspondent pas à leur vision préconçue. Cette attitude est fatale à l’apprentissage et à la croissance ; elle inflige sa propre solitude – soit une solitude de silence, soit une solitude de voix constamment élevées au milieu desquelles il n’est pas possible d’entendre.
Nous devrions tous nous en souvenir, nous qui sommes tentés d’imiter l’intolérance des adversaires qui nous attaquent ou nous excluent pour cause d’hérésie, d’apostasie ou de vice. Parfois, dans les moments de crise et de péril existentiel, il faut prendre des décisions et se battre. Mais dans la plupart des cas, il vaut mieux se rappeler que nos opinions sont incertaines, nos connaissances probables ; qu’« il n’y a pas d’humanité possible sans tolérance, et que la possession de la vérité totale n’est accordée à personne » (78). Même lorsque nous sommes déterminés, nous devons éviter la haine. Comme le disait Aron, qui a connu sa part de vitriol de la part de ceux avec qui il n’était pas d’accord, il faut savoir reconnaître l’incertitude d’une situation donnée :
Reconnaître l’incertitude d’une situation donnée, le nombre de décisions différentes possibles, de perspectives envisageables sur un avenir inconnu, ce n’est pas pardonner l’impardonnable ou éviter les engagements inévitables, mais les assumer sans haine, sans nier l’honneur de l’adversaire (79).
Ce n’est pas une recette de « bipartisme » ou de « centrisme ». Cela n’implique pas non plus un rejet de la politique – bien que cela rejette la conception de Carl Schmitt selon laquelle le « politique » est défini par l’inimitié mortelle. Aron a insisté sur la possibilité, malgré les conflits d’opinion et d’intérêt, d’une amitié en politique, allant même jusqu’à affirmer, en opposition à Schmitt, que l’amitié, et non l’inimitié, était le « but de la politique » (80). Dans ses longs dialogues avec deux interlocuteurs souvent critiques, « j’ai gagné deux amis. Je ne les ai pas convaincus, mais je leur ai communiqué l’esprit fertile du doute » (81). Cette tolérance est peut-être le seul moyen d’éviter une solitude qui nous offre le confort de la certitude et de la bien-pensance, mais qui ne fait que nous enfoncer dans l’illusion et la vanité. Même si notre tolérance n’est pas réciproque et que nous finissons par être insultés ou exclus, nous pouvons au moins éviter de tomber dans le même désert que nos adversaires – un désert dans lequel aucune idée nouvelle ou vraie ne peut croître, parce qu’elle ne reçoit jamais l’esprit fertile du doute ou le rafraîchissement d’expériences et de points de vue différents.
Aron et Camus ont rejeté non seulement une politique schmittienne d’inimitié, mais aussi toute théorie ou idéologie qui considère la politique comme le sommet ou la facette la plus essentielle de la vie. Leur éthique de l’indépendance impliquait un équilibre entre fierté et modestie, entre engagement et détachement. Tous deux étaient profondément engagés et visibles publiquement, mais ils ressentaient aussi le besoin de garder quelque chose en arrière, de préserver un sanctuaire intérieur à l’abri des débats du forum. La pratique de Camus, en tant qu’homme et artiste, impliquait un mouvement constant entre l’engagement et la distance, entre l’affiliation et l’indépendance – et entre la certitude qui découle de l’adhésion à un « camp » et l’ambivalence de la critique autonome et en quête d’elle-même. Il considérait cela comme essentiel à sa tâche d’artiste et de citoyen : pour « comprendre ce monde, il faut parfois s’en détourner ; pour mieux servir les hommes, il faut brièvement les tenir à distance » (82). Aron, quant à lui, a gardé sa vie privée et ses émotions sous contrôle, méprisant l’exhibitionnisme émotionnel. À une époque où nous sommes tous fréquemment amenés à passer tout notre temps et à dépenser toute notre énergie et nos émotions dans le cycle de l’information d’heure en heure (ou de minute en minute) et dans les réactions instantanées sur les médias sociaux, où chacun doit avoir une opinion instantanée, choisir un camp et ne pas reconnaître la faillibilité ou le doute, une telle retenue, associée à une modeste insistance sur l’incertitude et la délibération, peut constituer une précieuse source d’énergie. Il ne s’agit pas de prôner le retrait de la vie publique, mais plutôt de se préparer avec plus de soin à l’engagement. Nous serons en mesure de contribuer davantage et mieux si nous prenons le temps de cultiver une plus grande compréhension, une plus grande connaissance, une plus grande profondeur de pensée – et même, peut-être, une plus grande sagesse.
Aron et Camus ont reconnu la nécessité d’un équilibre délicat entre l’engagement et la distance, l’intransigeance et l’ouverture au doute et à la correction. Tous deux ont appelé à la résistance à la certitude et à la reconnaissance du doute – et ont souligné le courage lucide que cela exigeait. Tous deux ont également éprouvé des difficultés à maintenir l’équilibre qu’ils appelaient de leurs vœux. Mais à leur meilleur, ils offrent des modèles d’individualité authentique. Pour cette même raison, ils peuvent difficilement être imités, mais ils peuvent largement être éprouvés. Et parmi les vertus qu’ils nous montrent, il n’y a pas seulement l’indépendance, l’intégrité ou le courage, mais aussi l’humanité qui, à la fois, alimente et tempère leurs dénonciations et sous-tend leurs analyses. Camus a écrit « tant, et peut-être trop, uniquement parce que je ne peux m’empêcher d’être attiré du côté de ceux, quels qu’ils soient, qui sont humiliés et dégradés » – humiliés et dégradés pour quelque raison que ce soit, avec quelque présomption de justice et de vertu que ce soit de la part de leurs oppresseurs (83). Aron était moins démonstratif, mais il exprimait lui aussi son amour de l’honneur et de la magnanimité, sa haine de la cruauté. Si nous voulons vraiment imiter ces figures, nous devons nous souvenir non seulement de leur indépendance, mais aussi de leur humanité. Comme le rebelle de Camus, nous devrions refuser notre consentement ou notre allégeance lorsque nous pensons qu’elle n’est pas méritée, mais n’humilier personne ; nous devrions nous rappeler que « nous portons tous en nous nos lieux d’exil, nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche n’est pas de les lâcher sur le monde ; elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les autres. » (84).
« Aron et Camus ont reconnu que la quête de la vérité et la défense de la liberté étaient frustrantes, coûteuses et permanentes. »
Je me suis attardé sur Aron et Camus parce qu’ils me semblent des modèles plus admirables, et de meilleure compagnie, que beaucoup de leurs successeurs parmi nos contemporains. Je ne souhaite attaquer personne et encore moins pointer du doigt des individus, qui sont simplement coupables de refléter des tendances plus larges, ou d’adopter le type de comportement qu’ils reconnaissent comme nécessaire pour attirer l’attention, avoir de l’influence ou faire carrière. Se joindre à une polémique à la mode ou se ranger d’un côté ou de l’autre ne semble pas non plus être une façon appropriée d’apprendre ou d’honorer l’intégrité et l’indépendance d’esprit d’Aron et de Camus. Critique à l’égard de beaucoup de choses qui se passent aujourd’hui à gauche et surtout à droite, je reconnais aussi que le centrisme peut être son propre geste facile, sa propre forme de conformisme partisan. Nous devrions, comme Aron, prendre chaque question dans sa complexité comme elle vient ; et avec Camus, être vigilants contre les illusions flatteuses de la vertu, même si nous nous efforçons d’être un peu plus vertueux que nous n’avons été capables de l’être. Nous devrions défendre la justice telle que nous la voyons, mais n’oublions pas que c’est presque toujours une mauvaise chose de se joindre à une foule, virtuelle ou autre. Mais si nous subissons l’opprobre que la non-conformité provoque presque inévitablement, nous ne devons pas trop nous plaindre. Il y a toujours quelque chose à apprendre – au moins sur les illusions et les ressentiments de nos détracteurs, mais souvent sur bien plus que cela. Même les miroirs déformés peuvent refléter, sous une forme exagérée, des défauts en nous-mêmes que nous serions trop heureux d’ignorer.
Résister à la pression qui nous pousse à nous conformer ou à nous soumettre, et au plaisir de la médisance et de la méchanceté qui s’inspirent parfois involontairement de la droiture et d’une plus grande compassion, et qui parfois ne font qu’en porter le masque, est un appel pour tous ceux qui sont assez fiers pour conserver leur indépendance de jugement. Mais elle est vraiment digne d’éloges chez ceux qui sont également assez humbles et humains pour reconnaître la douleur derrière la fureur, et réfléchir à leurs (nos) propres échecs et à leur besoin d’apprendre ; qui conservent un sens de la perspective qui leur permet de faire la distinction entre les revers et les blessures auxquels ils sont confrontés – les insultes d’inconnus en ligne, une critique désagréable, la perte d’un titre prestigieux ou d’un cachet de conférencier rémunérateur – et l’agonie de la prison ou du goulag ; qui s’imposent des normes plus élevées que leurs adversaires ; et qui résistent à la force déformante de l’apitoiement sur soi et au statut immérité (lorsqu’il est immérité) du martyre. Aron et Camus ont reconnu que la quête de la vérité et la défense de la liberté étaient frustrantes, coûteuses et permanentes, et qu’elles n’apportaient souvent pas de plus grande récompense que le respect de quelques amis et la satisfaction tranquille et fugace d’avoir triomphé – l’espace d’un instant, mais pas nécessairement dans les précédents ou les suivants – d’une faiblesse intérieure et d’une pression extérieure. Leur accomplissement est imparfait et nous pouvons leur rendre hommage en cherchant à le poursuivre et en espérant que nous pourrons, nous aussi, inspirer et réconforter les amis que nous trouverons sur un chemin souvent solitaire.
Pour lire notre recueil, cliquer ICI.
Sources :
- (1) Tony JUDT, The Burden of Responsibility: Blum, Camus, Aron, and the French Twentieth Century, Chicago, IL, University of Chicago Press, 2007.
- (2) Albert CAMUS to Jean GRENIER, August 21, 1935, in Albert CAMUS et Jean GRENIER, Correspondence, 1932-1960, U of Nebraska Press, 2003, 11.
- (3) Albert CAMUS, « Justice and Charity, » Combat Jan 11, 1945, in Albert CAMUS, Camus At Combat: Writing 1944-1947, traduit par Arthur GOLDHAMMER, Princeton, Princeton University Press, 2006, 169.
- (4) Albert CAMUS to Jean GRENIER, Sept 18, 1951, in in Albert CAMUS et Jean GRENIER, Correspondence, 1932-1960, U of Nebraska Press, 2003, 152-3.
- (5) Albert CAMUS, Albert CAMUS, Caligula & Three Other Plays: Translated from the French by Stuart Gilbert : with a Preface by the Author, Vintage Books, 1962., v.
- (6) Ibid. 10, 20-21.
- (7) Ibid., 14, 28, 73.
- (8) Ibid., vi
- (9) Raymond ARON, « On the Historical Condition of the Sociologist, » in Politics and History, translated and edited by Miriam BERNHEIM Conant (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002), 65-66; Raymond ARON, The Committed Observer: Conversations with Jean-Louis Missika and Dominique Wolton, translated by James and Marie MCINTOSH (Chicago: Regnery Gateway, 1983), 25, 34.
- (10) Raymond ARON, « On the Historical Condition of the Sociologist, » 68.
- (11) Ibid.
- (12) Raymond ARON, « Lettre ouverte d'un jeune Français à l'Allemagne, » Esprit Février 1933, 735.
- (13) Raymond ARON, « On the Historical Condition of the Sociologist, » 66.
- (14) Raymond ARON to Alfred FABRE-LUCE, May 1, 1938, in « Correspondance entre Raymond Aron et Alfred Fabre-Luce (1935-1981), » Commentaire 127 (Autumn 2009), 593-617, at 596-7.
- (15) Raymond ARON, « Lettre ouverte d'un jeune Français à l'Allemagne, » 740.
- (16) Raymond ARON, The Committed Observer, 29-30, 37.
- (17) Albert CAMUS, The Plague, , translated by Stuart Gilbert (London: Penguin, 1960), 65, 71, 86.
- (18) Albert CAMUS, Notebooks 1935-1942, trans. Philip Thody (New York: Knopf, 1969), 139-42.
- (19) Albert CAMUS, The Plague 199.
- (20) Albert CAMUS, « Letters to a German Friend, » Resistance, Rebellion, and Death, translated Justin O’Brien (New York: Vintage, 1995), 28.
- (21) Ibid, 30.
- (22) Albert CAMUS, « The Wager of our Generation, » Resistance, Rebellion, and Death, 239-40 ; Albert CAMUS, Notebooks 1942-1951, traduit par Justin O’BRIEN, Knopf, 1965., 125-6
- (23) Raymond ARON, Mémoires (Paris: Robert Laffont, 2010), 165.
- (24) Raymond ARON, « On Treason, » Confluence 3:3 (1954), 280-94, 290. 45.
- (25) Jean-Paul SARTRE, Situations, 1st éd., NY, George Braziller, 1965, 287.
- (26) Raymond ARON, The Committed Observer, 246.
- (27) Albert CAMUS, The Rebel, translated by Anthony BOWER (London: Penguin, 1971), 72, 75.
- (28) Ibid.15.
- (29) Ibid. 28.
- (30) Ibid. 22.
- (31) Ibid. 268.
- (32) Ibid., 248.
- (33) Ibid. 27, 32.
- (34) Ibid., 221.
- (35) Ibid., 48.
- (36) Ibid 136, 139.
- (37) Albert CAMUS, Caligula and Three Other Plays, 269.
- (38) Albert CAMUS, The Rebel, 270.
- (39) Albert CAMUS, Notebooks 1935-1942, 27.
- (40) Albert CAMUS, « Homage to an Exile, » Resistance, Rebellion, and Death, 103.
- (41) Albert CAMUS quoted in Le Monde, December 14, 1957, in CAMUS, Algerian Chronicles, edited by Alice KAPLAN, translated by Arthur GOLDHAMMER (Cambridge MA : Harvard University Press, 2013), 216n10.
- (42) Iain STEWART, Raymond Aron and Liberal Thought in the Twentieth Century, Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, Cambridge University Press, 2019, 21 : provides the context for both Sartre’s scabrous suggestion and the famous quip about Sartrean error being preferable to Aronian verity.
- (43) Raymond ARON, The Opium of the Intellectuals, translated Terrence KILMARTIN (New York: W. W. Norton, 1962), 85.
- (44) Raymond ARON, « History and Politics, » Politics and History, 240.
- (45) Raymond ARON, « Max Weber and Modern Social Science, » in History, Truth and Liberty, ed. Franciszek DRAUS (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 352; « History and Politics, » 240-41.
- (46) Raymond ARON, « Fanaticism, Prudence, and Faith, » in History, Truth, Liberty, 126.
- (47) Raymond ARON, The Committed Observer, 261-2.
- (48) Ibid., 227-8, 262.
- (49) Ibid., 265.
- (50) Raymond ARON, The Opium of the Intellectuals, 45.
- (51) Raymond ARON quoted in Nicolas BAVEREZ, Raymond Aron (Paris: Flammarion, 2005), 338.
- (52) Raymond ARON, The Committed Observer 265.
- (53) Ibid., 255-6.
- (54) Ibid., 282.
- (55) Albert CAMUS, The Rebel, 16.
- (56) Ibid., 216.
- (57) See ibid., 99, 246.
- (58) Raymond ARON, « The Future of Secular Religions, » in The Dawn of Universal History Selected Essays from a Witness of the Twentieth Century, edited by Yair REINER, translated by Barbara BRAY (New York: Basic Books, 2002), 177.
- (59) Raymond ARON, The Opium of the Intellectuals, 196, 237, 307.
- (60) Ibid., 318, 323.
- (61) Raymond ARON, « The Future of the Secular Religions, » 201.
- (62) On the concept of honor and its political value see Sharon R. KRAUSE, Liberalism with Honor, Cambridge, Massachusetts London, England, Harvard University Press, 2002 ; Kwame Anthony APPIAH, The Honor Code: How Moral Revolutions Happen, Reprint edition., New York London, W. W. Norton & Company, 2011.
- (63) Albert CAMUS, Caligula and Three Other Plays, 260-61.
- (64) Albert CAMUS, Lyrical and Critical Essays, Vintage, 1970, 14.
- (65) Albert CAMUS, « The Wager of Our Generation, » Resistance, Rebellion, and Death, 240.
- (66) Raymond ARON, « On Treason », 294.
- (67) Ibid., 290
- (68) Raymond ARON, The Committed Observer, 154.
- (69) Raymond ARON, Introduction to the Philosophy of History, translated by George J. IRWIN (Boston: Beacon Press, 1962), 345.
- (70) The concept of moderation has been explored extensively by Aurelian Crăiuțu over a series of works: see Aurelian CRĂIUȚU, A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830, Princeton University Press, 2012 ; Aurelian CRĂIUȚU, Faces of Moderation: The Art of Balance in an Age of Extremes, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2017 ; and Aurelian CRĂIUȚU, Why Not Moderation?: Letters to Young Radicals, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.
- (71) Albert CAMUS, Lyrical and Critical Essays, 302.
- (72) Albert CAMUS, editorial, Combat, October 21, 1944, in Camus at Combat, 82. 59.
- (73) Albert CAMUS, The Rebel, 264.
- (74) The metaphor of the funambulist is from CRĂIUȚU, Why Not Moderation?
- (75) Albert CAMUS, Notebooks 1942-1951, 216.
- (76) Raymond ARON, De Gaulle, Israel, and the Jews, translated by John Sturrock (New Brunswick: Transaction, 2004), 7.
- (77) Albert CAMUS, « Neither Victims Nor Executioners, » Camus at Combat, 258-9.
- (78) Raymond ARON, Introduction to the Philosophy of History, 333.
- (79) Raymond ARON, The Opium of the Intellectuals, 132.
- (80) Raymond ARON to Julien FREUND, quoted in Jan-Werner MULLER, A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought, New Haven, Yale University Press, 2003, 101.
- (81) Raymond ARON, The Committed Observer, 282.
- (82) Albert CAMUS, Lyrical and Critical Essays, 109. 63.
- (83) Albert CAMUS, Essais, edited by Roger QUILLIOT and Louis FAUCON (Paris: Gallimard, 1965), 802-3.
- (84) Albert CAMUS, The Rebel, 265.