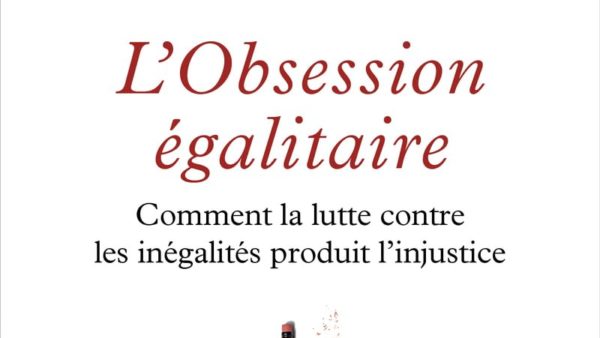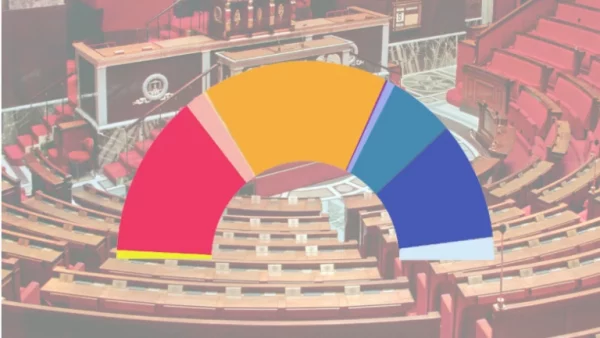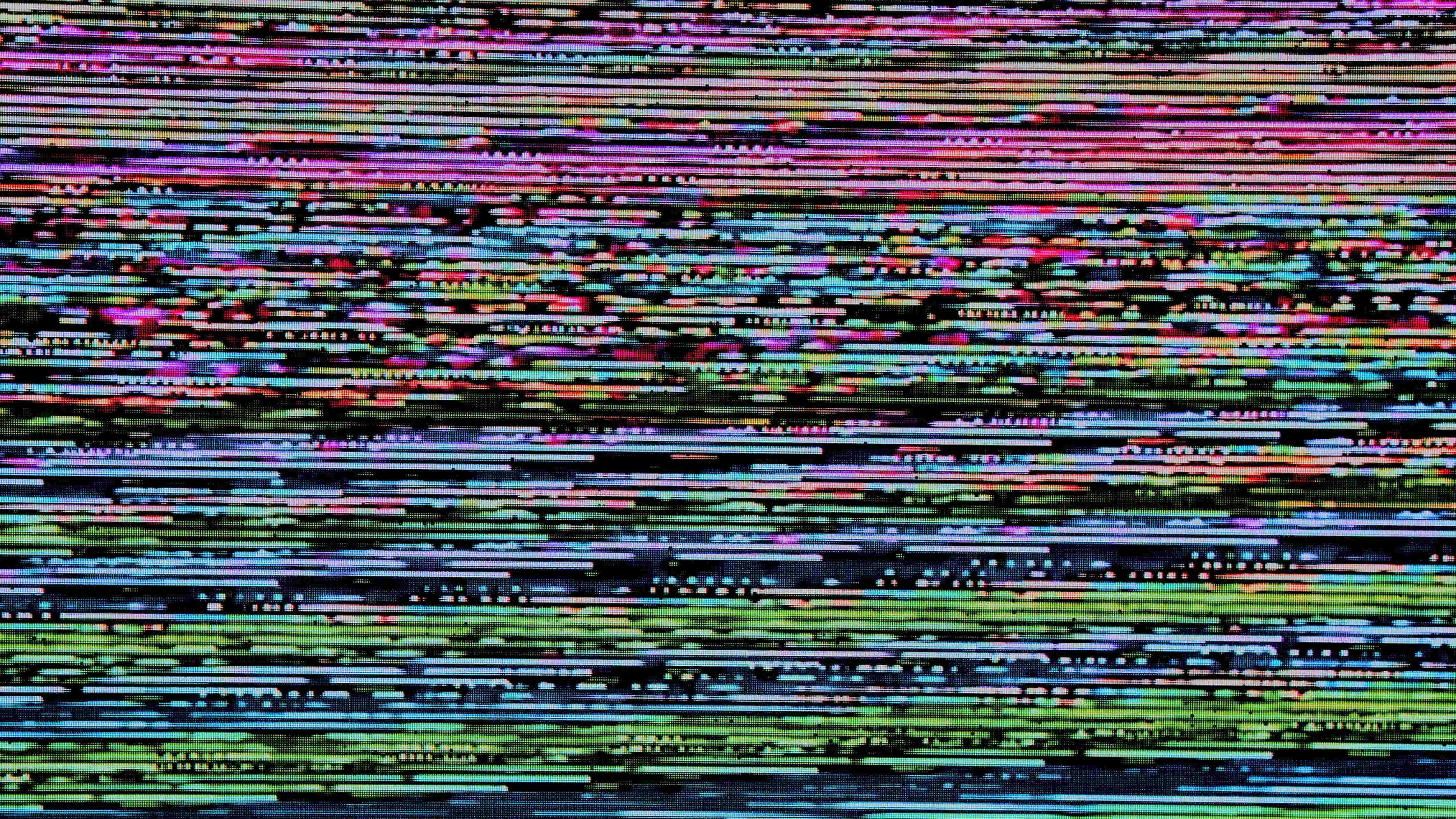
Dans Les Echos, Gaspard Koenig prend l’exemple du licenciement d’un employé de chez Apple pour dénoncer le phénomène de la « cancel culture ».
Selon les dires de certains de ses collègues, plusieurs passages du dernier livre d’Antonio García Martinez contiendraient des propos ouvertement sexistes. D’après Gaspard, l’oeuvre de M. Martinez n’a pas cette vocation et son contenu est parfaitement légal. L’accusé n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de telles accusations dans sa carrière. Pourtant, Apple n’a pas hésité à s’en séparer. Gaspard y voit les dérives de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui, de la lutte contre les discriminations, se transforment en police de la pensée.
« À force de jouer la vertu, les entreprises vont finir par conduire des enquêtes de bonnes moeurs sur les réseaux sociaux pour s’assurer que leurs employés se sont conformés depuis leur plus jeune âge à la féroce morale de notre époque. »
Gaspard déplore le fait qu’une personne puisse être remise en cause de façon définitive pour ce qu’elle est supposée être : une nouvelle Inquisition « woke » à combattre. À l’appui des écrits de Monique Canto-Sperber, il alerte sur une nouvelle menace pour la liberté d’expression au moins aussi dangereuse que les lois liberticides : une nouvelle contrainte de la parole pour satisfaire les personnes indisposées.
« Ces nouvelles pratiques font peser sur la liberté d’expression une menace plus lourde que les lois les plus liberticides, en rendant le moindre propos semi-public susceptible de briser une carrière professionnelle. »
À l’inverse, Gaspard appelle au débat. Pour lui, c’est justement cette censure de l’individu qui doit être sanctionnée. Dans le cas d’Antonio García Martinez, son oeuvre aurait dû faire l’objet d’un débat encadré par l’entreprise plutôt que d’un procès d’intention.
Pour lire la chronique, cliquer ICI.
Pour consulter notre rapport « Ne laissons pas le juge moraliser l’entreprise », cliquer ICI.
Publié le 26/05/2021.