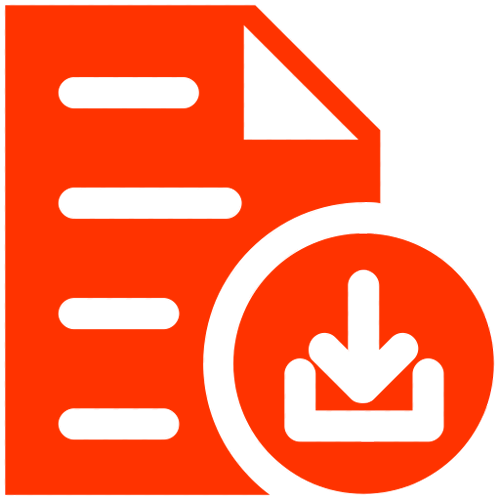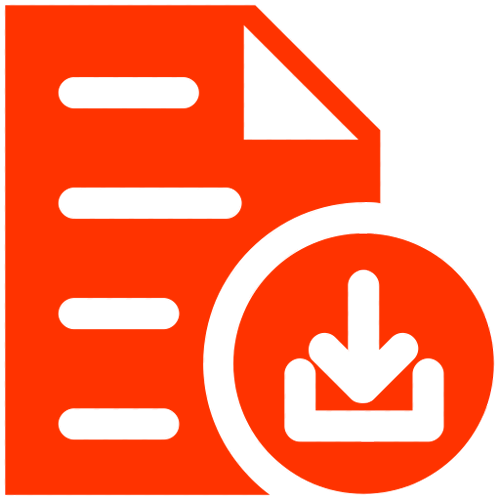
Dans leur contribution à notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Rafaël Amselem et Baptiste Gauthey opposent la conception libérale et constitutionnelle de la démocratie à la souveraineté populaire rousseauiste. A l’aune de la pensée de Raymond Aron, pour qui le compromis est nécessaire à la concurrence pacifique dans une démocratie, ils expliquent en quoi l’hyperprésidentialisation, l’excès de radicalité, et le refus de l’altérité politique sont des obstacles à ce même compromis. Enfin, Baptiste et Rafaël appellent à une rupture avec la logique verticale de nos institutions, la culture du contrôle administratif et la frénésie égalitariste.
Introduction
« Expliquer un régime politique ou l’analyser, c’est toujours le dépoétiser, et c’est pourquoi il y a une grande sagesse dans les régimes qui interdisent qu’on les remette en question »
Raymond ARON, Introduction à la philosophie politique : démocratie et révolution, Paris, Libr. Générale Française, coll.«Le livre de poche références », n ̊ 536, 1997, p. 55.
Que ce soit dans Démocratie et totalitarisme, Introduction à la philosophie politique ou encore Essai sur les libertés, la démocratie chez Aron est minutieusement dépecée, disséquée, morceau par morceau, décortiquant à la fois les institutions de la démocratie, la structure sociale qui les sous-tend, le poids des groupes d’intérêts, les dynamiques historiques qui ont guidé leur évolution, les liens qui régissent encore les rapports entre société civile et parlementaires, parlementaires et gouvernement, gouvernement et syndicats ; et on croirait s’y perdre, les détails – parfois insignifiants en apparence – s’accumulant et les digressions surgissant de toutes parts. C’est sans doute ce mode de discours marqué par le trop-plein-de-descriptif qui valut à Aron la réputation d’une certaine tiédeur, voire d’auteur rébarbatif. S’il y a une grande sagesse à ne pas dépoétiser un régime, alors, définitivement, Aron n’est pas un poète et il s’applique avec méthode et franchise à ne pas l’être.
Pourtant, c’est ce buisson d’informations qui fait la valeur de son œuvre. Le diable se cache dans le détail : Aron l’a bien saisi. S’il n’est pas un poète, c’est que sa démarche entière consiste à saisir le réel dans toute sa complexité. La nuance qui marque son parcours n’est donc pas la traduction d’une mollesse d’esprit ou pire un manque d’audace intellectuelle : sa nuance est le souci permanent de discourir à partir d’éléments vérifiés, partant du déroulé historique, et non fantasmés depuis la tour d’ivoire de l’idéologie.
Alors il faut mettre les mains dans le cambouis. « Le café, c’est la maison ouverte, de plain-pied avec la rue, lieu de la société facile ». Par cette formule, Levinas émettait un reproche à l’adresse de certains de ses contemporains se complaisant dans le commentaire facile de l’actualité, « de plain-pied avec la rue », en infraction avec la mission de l’intellectuel. Assurément, Aron n’était pas de ceux-là.
Cette capacité à surenchérir dans le détail est ce qui permet à Raymond Aron, à la fin d’un long développement, de trancher. En l’occurrence, les démocraties sont des régimes fragiles. Certes, les démocraties ont des mérites irréductibles : elles distillent le souci de l’égalité, elles cadrent le pouvoir, l’assiègent de normes, avec cet autre souci concomitant de prévenir l’arbitraire. Sans doute, les démocraties sont les régimes qui ont le mieux pensé les garanties des citoyens contre les abus du gouvernement : constitutionnalisme, séparation des pouvoirs, recours juridictionnels, État de droit. Mais les démocraties sont empêtrées dans les contradictions. Dans leur essence, déjà, tiraillées entre un versant libéral visant à limiter le pouvoir et garantir les droits de l’opposition, et un versant populaire qui tend à organiser la toute-puissance du peuple ; dans leur organisation, aussi, institutionnalisant le conflit permanent entre groupes et individus, au risque de la dislocation de l’unité nationale ; dans leur évolution, encore, dépréciant à la fois le pouvoir au nom de l’égalité, mais réclamant dans le même temps d’organiser l’égalité sociale au nom du même principe, découlant sur une extension des pouvoirs de l’État. Il n’y a pas de certitude quant à leur évolution historique. Ce qui est certain en revanche, c’est que les démocraties comportent leurs propres facteurs d’instabilité et de corruption. Ce sont ces facteurs que nous tenterons d’étudier dans ce propos.
Faire parler les morts, voilà une tâche audacieuse. Nous ne nous y risquerons pas. Notre propos ne sera pas un exercice de ventriloque. Nous ne savons pas ce que dirait Aron sur les institutions de la Vème République telles que pratiquées aujourd’hui, ni sur l’état de la société française alors que les urgences en tout genre (sanitaire, sécuritaire, écologique) s’accumulent. A fortiori, la pensée de Aron est celle d’un homme de son temps, qui analyse ses contemporains, sans abstraction : ainsi évoque-t-il le PC, les gaullistes, les courants révolutionnaires des années 50. Cette donnée inconnue nous oblige à l’humilité. Mais quelque chose nous reste malgré tout permis. Un exercice qu’on pourrait appeler d’interprétation déductive, formule que nous empruntons à Moshe Halbertal (1). Nous ne dirons pas à la place de Raymond Aron. Nous pouvons en revanche mobiliser ses écrits pour analyser, avec nos mots, les dynamiques qui traversent nos institutions, en 2023. Ce n’est pas Aron qui parlera, mais nous. Ce qui est toutefois à espérer, c’est qu’à travers nos réflexions, nous arriverons, d’une part, à rester fidèle à ses écrits et, d’autre part, à mettre en valeur sa pensée. Voilà ce que nous entendons par interprétation déductive : déduire une analyse à partir des mots de Aron, sans toutefois avoir la prétention de se substituer à l’auteur.
Qu’est-ce que la démocratie ?
Qu’est-ce que la démocratie ? Le fait majoritaire, pardi ! Voilà ce que serait sans doute la réponse d’un passant quelconque qu’on interrogerait, au hasard, dans la rue : la démocratie, c’est d’abord le pouvoir de la majorité, l’expression populaire, la consultation du peuple. C’est contre nos premières évidences que se fonde la leçon de Raymond Aron. Diverses conceptions et esthétiques sont en fait en concurrence pour s’approprier la définition de la démocratie. C’est cette polysémie, qui inclut des tendances contradictoires internes au phénomène démocratique, qu’il nous faut aborder pour commencer notre étude.
« La nécessaire défense des libertés, la lutte contre l’arbitraire, la garantie des droits – nous conduisent à la conclusion politique suivante : il nous faut désormais prôner la rupture. »
Aron oppose deux visions, deux interprétations contradictoires de la démocratie qui, selon lui, traversent les sociétés modernes, et qu’il explore dans des cours rassemblés dans son Introduction à la philosophie politique. À la suite d’Alexis de Tocqueville, Aron considère que les sociétés démocratiques modernes voient se développer en leur sein deux tendances, une libérale et une dite de la souveraineté populaire.
La démocratie de la souveraineté populaire
La démocratie de la souveraineté populaire s’inscrit dans la continuité du Contrat social rousseauiste. Pour Aron, l’idée maîtresse du Contrat social « est que le pouvoir doit être l’expression du peuple, considéré comme un ensemble cohérent » (2). Ainsi pour Rousseau, « la volonté générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de son institution, qui est le bien commun » (3). Cette notion de « bien commun », qui doit être déterminée par le « peuple » lui-même, est centrale puisque c’est en son nom que le pouvoir étatique légitime les contraintes imposées aux individus : « c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée ». C’est encore en ce sens qu’il affirme que « le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c’est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte, comme j’ai dit, le nom de souveraineté » (4).
Si la démocratie rousseauiste qui se dessine dans Du contrat social se donne pour objectif de « trouver une formule d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant » (5), le philosophe dévoile quelques lignes plus tard la véritable nature du régime qu’il appelle de ses vœux : « l’aliénation se faisant sans réserve, l’union est aussi parfaite qu’elle ne peut l’être et nul associé n’a plus rien à réclamer : car s’il restait quelques droits aux particuliers, comme il n’y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge prétendrait bientôt l’être en tous, l’état de nature se subsisterait et l’association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine » (6). Dans cette structure prime une conception holiste du pouvoir, c’est-à-dire l’idée que les injonctions de la collectivité supplantent les volontés individuelles et les droits personnels. Dans un renversement logique plutôt subtil, l’effacement de l’individu n’en est pas un : associé aux autres citoyens dans une entité (le « peuple ») qui partage la recherche d’un « intérêt général » en commun, l’action de collectivité ne peut se faire à l’encontre des intérêts de l’individu.
Comme le critiqueront par la suite les philosophes libéraux, l’intention rousseauiste porte beaucoup plus sur l’identité du titulaire du pouvoir que l’étendue de celui-ci. Là où Rousseau affirme qu’il faut remplacer le monarque par le peuple et que là réside le pouvoir légitime, les libéraux répondent que l’un et l’autre peuvent être despotiques : tout dépend des prérogatives qu’on leur attribue.
Dans cette lignée, Aron rejette cette tendance égalitaire : elle risque de « conduire à la dictature du peuple » (7) puisque « le peuple – ou ceux qui disent qu’ils représentent le peuple – veut avoir tous les pouvoirs » (8) ; Benjamin Constant ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit que le contrat social rousseauiste, « si souvent invoqué en faveur de la liberté », est en fait « le plus terrible auxiliaire de tous les genres de despotisme » puisqu’il accomplit « l’aliénation complète de chaque individu avec tous ses droits et sans réserve à la communauté » (9). Ainsi, il s’empresse d’alerter son lecteur du fait qu’en absence de définition et de délimitation exacte de l’étendue de la souveraineté du peuple, « le triomphe de la théorie pourrait devenir une calamité dans l’application » (10) . Ces citations témoignent d’une crainte partagée quant aux dérives probables de la démocratie de souveraineté populaire : la dictature du peuple ne serait qu’une autre forme de despotisme.
Fidèle à sa marque de fabrique, Aron en critique de surcroît la praticabilité. « Régime impossible », résultant d’une « mystique », il nous rappelle que toute organisation politique est pour l’essentiel une oligarchie (11), c’est-à-dire qui repose sur la mainmise du pouvoir par une minorité. Lorsque le peuple est composé de millions d’âmes, comment imaginer qu’une majorité se mette d’accord sur une conception unique de l’intérêt général ?
La démocratie à tendance libérale et constitutionnelle
La continuité entre la pensée des deux auteurs se poursuit dans le type de régime démocratique auquel ils donnent leur assentiment : la démocratie à tendance libérale et constitutionnelle.
On peut la définir selon les termes de Constant : « la souveraineté du peuple n’est pas illimitée ; elle est circonscrite dans les bornes que lui tracent la justice et les droits des individus. La volonté de tout un peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste […] Tout despotisme est donc illégal […] Car il s’arroge, au nom de la souveraineté du peuple, une puissance qui n’est pas comprise dans cette souveraineté… » (12) Et Aron d’abonder : « la justification qui me paraît la plus forte de la démocratie, ce n’est pas l’efficacité du gouvernement que se donnent les hommes lorsqu’ils se gouvernent eux-mêmes, mais la protection qu’apporte la démocratie contre les excès du gouvernement. » (13) La conclusion qui s’impose chez nos deux auteurs libéraux est donc que le pouvoir ne tire pas sa légitimité de sa seule origine populaire, mais de son caractère constitutionnel, « c’est-à-dire [qu’il] ne soit exercé que selon des règles, dans le respect d’un certain nombre de principes juridiques applicables à tous les citoyens » (14). Contre la souveraineté populaire qui aboutit « à la toute-puissance de la majorité parlementaire » (15), Aron oppose « l’idée de constitutionnalisation des pouvoirs » (16).
« Tout le monde est libre par principe, tout le monde est d’abord innocent, et ce n’est qu’a posteriori, en fonction d’un acte d’incrimination, qu’il y a des criminels à sanctionner. »
La grille de lecture aronienne porte en elle-même une première tension centrale, qui détermine toutes les autres, et qui se situe dans la coexistence, au cœur même des démocraties modernes, de deux visions contradictoires : « Dès l’origine de l’idée démocratique, écrit Aron, il y avait deux tendances, une tendance libérale et une tendance autoritaire, populaire, une tendance à l’autonomie des personnes et une tendance à la puissance de l’État, ou encore une tendance aux libertés individuelles et une tendance à l’égalité » (17). Ces deux façons d’envisager l’idée démocratique se fondent sur deux interprétations opposées des rapports entre individu et collectivité. La tendance égalitaire fait écrire à Rousseau que « mieux l’État est constitué, plus les affaires publiques l’emportent sur les privées dans l’esprit des citoyens » (18), quand la tendance constitutionnelle libérale, sous la plume de Constant, tire la couverture du côté des individus puisqu’il y a « une partie de l’existence humaine qui, de nécessité, reste individuelle et indépendante, et qui est de droit hors de toute compétence sociale » (19).
Résumons. Aron distingue deux tendances contradictoires de la démocratie. Alors que l’idée de souveraineté populaire peut conduire à la dictature du peuple, « l’idée de constitutionnalisation des pouvoirs aboutit à la conclusion que l’essence de ce régime est de respecter l’opposition » (20).
La démocratie libérale-constitutionnelle : la grande fabrique du compromis ?
Nous venons de le voir, la démocratie n’est pas que le pouvoir de la majorité, l’expression populaire et la consultation du peuple. Elle est avant tout concurrence pacifique pour le pouvoir.
« Quand on dit « souveraineté du peuple », on rend possible toutes sortes de jeux idéologiques. En effet, comme on ne sait pas très bien ce que c’est que le peuple et qu’il y a, dans l’idéologie politique, toutes sortes de manipulations de la notion de peuple, il vaut mieux laisser de côté des notions obscures et partir de faits très simples » (21). La concurrence pour le pouvoir est un de ces faits très simples : sur l’agora, chacun en conviendra, il y a des luttes partisanes et personnelles pour acquérir le pouvoir, et la démocratie est un système qui organise la concurrence pacifique de ces batailles, considérant que ceux désignés en fin de processus ne le sont pas par naissance ou privilège quelconque. Des règles encadrent d’emblée cette rivalité, des règles elles-mêmes publiques, issues d’un processus de représentation électorale, et sous-tendues par la nécessité de garantir les libertés politiques et personnelles. Sans elles, le processus de concurrence serait vicié : « pour que la concurrence soit pacifique, il faut que les citoyens ne courent pas un risque excessif d’être mis en prison s’ils expriment certaines opinions » (22). En ce sens, la démocratie est une réalité institutionnelle : une concurrence organisée. Réalité sociale contraire, nous dit Aron, à un autre phénomène social universel : la concurrence pour les faveurs du prince, réalité informelle encadrée par aucune règle, si ce n’est des normes implicites, interpersonnelles et infra-légales, en clair, une concurrence non organisée.
Or, point fondamental, l’institutionnalisation de la concurrence pacifique passe par la fabrication, dit-il, du compromis. Compromis ? La pleine puissance majoritaire pourrait-elle souffrir d’accommodements avec la minorité électorale déchue ? Pour Aron, non seulement cela est souhaitable, mais encore nécessaire : pas de compromis, pas de concurrence pacifique… Notons qu’il est bien question de construction : en bon libéral, le social comme le politique ne sont pas considérés en premier lieu comme des données naturelles, elles sont avant tout une construction, c’est-à-dire le résultat de projections préalables de volontés humaines plus ou moins conscientes sur la société (23) en vue d’une fin déterminée. Les institutions occupent à cet égard une place déterminante en ce qu’elles incitent à l’adoption de certains comportements : qu’un gouvernement dispose ou non du 49.3, il en résulte des rapports de force avec le Parlement et des stratégies législatives bien différenciées. Ainsi, le compromis n’est pas d’emblée. Il n’a rien de spontané. Il résulte avant tout d’une structure étatique déterminée qui incite les acteurs en concurrence à considérer la perspective des autres pour atteindre les siennes.
Si donc le compromis est construit, encore faut-il en comprendre la nécessité. Elle résulte chez Aron de deux perspectives. Une première, historique : concrètement, la démocratie s’est installée par l’inclusion des forces sociales nouvelles dans le spectre politique – la bourgeoisie au moment de la Révolution, le prolétariat par la suite. « En France, l’évolution vers un système comparable s’est accomplie à la suite d’une série de révolutions, parce que, à chaque époque, les groupes privilégiés ont hésité à conclure des compromis avec les représentants des forces sociales nouvelles. En effet, quand un groupe veut participer au pouvoir et que les anciens privilégiés l’écartent, il y a une probabilité de révolution. » (24)
De cette perspective historique découle une nécessité politique plus générale : si d’aventure les forces sociales nouvelles se sentent exclues du cadre institutionnel, soit qu’elles n’aient aucune chance d’accéder au pouvoir, soit que ses revendications ne trouvent aucun écho, leur relation au pouvoir ne pourra être qu’un lien de frustration, de marginalisation, voire de retranchement. Se sentir étranger au pouvoir en place, c’est non seulement voir sa liberté politique être froissée (« ils ne me représentent pas ! »), mais c’est encore basculer dans un rapport d’hostilité à celui-ci. Être étranger au pouvoir, voilà le critère déterminant pour acquérir le sentiment intime qu’il est autoritaire.
En un mot, le compromis permet de construire un rapport d’identification entre toutes les forces sociales avec les institutions qui se réclament d’elles. Parce que la concurrence pacifique nécessite l’acceptation d’une alternance politique non-conflictuelle, c’est-à-dire d’être d’accord de voir le pouvoir passer à des mains autres que les siennes, sans que les acteurs ne perdent espoir d’avoir voix au chapitre une fois retranché dans le camp minoritaire, il faut construire le compromis ; sinon, personne n’accepterait les changements politiques mis en oeuvre, voire les règles elles-mêmes, de manière pacifique. Ainsi, le compromis entretient un rapport d’altérité et de reconnaissance réciproque : chacun reconnaît à l’autre sa légitimité à être au pouvoir, d’appliquer des idées qui lui sont opposées, en même temps que les acteurs en marge du pouvoir se sentent reconnus dans leurs convictions dans ce qu’elles ont de représentatives au sein de la société. Le compromis est donc déterminant en tant que vecteur de pacification.
Tensions, contradictions et défis de l’État démocratique moderne
La concurrence pacifique : facteur de désunion ?
Cette idée du compromis ne va pas de soi. Nous la comprenons comme idée générale, comme nécessité abstraite, mais dans la réalité de notre vécu, elle comporte quelque chose de très insatisfaisant pour l’esprit humain, tant du côté du politique que du côté de la société civile.
En considérant qu’une philosophie politique doit être complète pour emporter l’ensemble de ses effets qu’on postule positifs pour la société – sans quoi on n’adhérerait pas à tel ou tel projet politique – le compromis ne peut être que vexatoire. Il oblige en permanence à la retenue, à renoncer à la cohérence systémique, à ce que toute proposition ou presque comporte un astérisque.
« Les institutions sont d’autant plus enclines à la centralisation et à l’omnipotence que les citoyens demandent d’être mis sous tutelle. »
Le en même temps macronien condense assez bien ce phénomène, de même que le « libérer, protéger » promu par ce même camp lors de la campagne de 2017 : schématiquement, à ne libérer que l’économie, on laisse de côté les classes populaires en proie à des dynamiques de domination ; à ne protéger que les salariés, on mésestime ce qui, dans les revendications patronales, revêt de légitime. Alors, on ménage la chèvre et le chou. Mais là réside la réalité non-assumée par les démocraties : tout pouvoir doit ménager la chèvre et le chou, et en cela, la doctrine macronienne n’ajoute rien aux pratiques du passé. On se souvient de cette formule d’« UMPS » régulièrement employée par Marine Le Pen lors de sa première campagne présidentielle (en référence au Parti Socialiste et au parti UMP, devenu depuis Les Républicains). Elle nous semble traduire ce sentiment : les majorités passent, changent de couleur, reviennent, puis repartent, encore et encore, et pourtant rien ne semble fondamentalement distinguer les partis politiques majoritaires une fois au pouvoir.
Assurément, tout ne tient pas à cet argument, et on ne saurait exclure le manque de courage de tel ou tel dirigeant, ou de tous, dans l’absence d’audace politique. Mais la nécessité du compromis participe sans doute à rendre les oppositions moins irréductibles qu’attendues. Réformer le statut de la SNCF et celui des travailleurs ne peut pas aller sans le rachat de la dette par l’État ; autoriser le travail du dimanche ne peut se faire sans offrir de contreparties salariales conséquentes ; allonger l’âge de départ à la retraite ne peut être envisagé sans garantir aux retraités modestes des avantages sociaux ou des mécanismes compensatoires pour les carrières longue durée.
Cela ne signifie pas que toute réforme ne consiste qu’en un jeu d’équilibriste, où il suffirait de mélanger et d’additionner de façon égale l’intégralité des opinions exprimées sur tel ou tel projet de loi pour obtenir l’approbation générale ; dit autrement, la nécessité du compromis n’implique pas l’absence de dominante politique ou de coloration idéologique. Cela ne signifie pas non plus, dans cette logique, que toute réforme ne se voit pas opposer des revendications ou qu’elle ne soulève jamais de confrontation, y compris virulente. Nombreux sont les acteurs publics (syndicats, journalistes, militants, ONG, associations etc.) à se mobiliser tout au long du calendrier législatif, allant même parfois jusqu’à invoquer le registre du scandale ou de la grève.
En revanche, là est le point central, ces oppositions ne vont pas, dans un cadre de compromis, jusqu’à une volonté de renverser le pouvoir en place, bref, de cesser d’exercer son activité politique hors d’un cadre pacifique, point de non-retour.
Lorsque l’équilibre du compromis est rompu, ou en tout cas qu’il apparaît comme tel dans la psychologie collective, émerge alors le risque de contestation violente. La crise des Gilets Jaunes a ainsi trouvé sa résolution dans un signal fort à l’égard des classes populaires de la part du gouvernement, par le déploiement d’un ensemble de dépenses publiques ciblées, visant ainsi à donner à nouveau le sentiment d’une inclusion des classes sociales démunies dans le spectre de la politique publique.
La nécessité du compromis nous conduit dès lors à marquer une nouvelle tension inhérente au régime démocratique : elle rend pénible toute recherche d’efficacité. Exception faite des périodes de violence politique, dont le contexte rend possible la radicalité des réformes, la démocratie est en quelque sorte condamnée à la demi-mesure. Or, Raymond Aron nous rappelle que les peuples démocratiques sont assez peu enclins à supporter la mollesse politique. Cela pour deux raisons.
La première tient à la première tendance démocratique qui tend à l’égalité. Lorsqu’un régime ne cherche que l’égalisation des conditions, il lui faut un État interventionniste, voire technocratique, amené, par le bras armé de son administration et son lot d’experts, à organiser la société de telle sorte qu’elle produise l’égalité sociale (par des mécanismes de redistribution ciblés, une politique éducative d’émancipation, des régulations sectorielles etc.).
« La nécessité du compromis nous conduit à marquer une nouvelle tension inhérente au régime démocratique : elle rend pénible toute recherche d’efficacité. »
Cette nécessité est d’autant plus palpable que, deuxième élément, les sociétés modernes sont marquées, nous dit Raymond Aron, par des ambitions prométhéennes : les diverses révolutions technologiques, le productivisme, la maîtrise de la nature par l’homme, nous conduisent à considérer que l’ensemble des données du monde social (le niveau de richesse, les inégalités, la pauvreté etc.) n’ont rien de naturel, qu’elles peuvent être modifiées pour le mieux, pourvu que nous nous dotions de la bonne infrastructure politique. Derrière donc l’ambition prométhéenne se masque une demande accrue d’efficacité de l’action politique. Sur ce que l’efficacité entretient de conflictuel avec le compromis, nous y reviendrons.
Auparavant, il nous faut étudier la deuxième tension qui émerge entre nécessité du compromis et démocratie et qui touche au risque de désunion nationale.
Parce que les détenteurs du pouvoir ne sont jamais fixés une bonne fois pour toutes, « aucune ambition [n’étant] interdite » (25), la démocratie consacre la bataille permanente entre les revendications, groupes et intérêts opposés au sein de la société. Aron parle ainsi de la démocratie comme « l’organisation du mécontentement ». Il ira même plus loin : « Ce qu’on peut dire, en généralisant, c’est que, à travers le régime de concurrence pacifique s’exerce la lutte de classes. Pratiquement, tout système de compétition se trouve superposé à une société inégalitaire dans laquelle existent des groupes rivaux, et ces groupes rivaux continuent leurs querelles à travers le système de concurrence. » (26).
Nous nous engueulons collectivement : à longueur de plateaux de radio, de télévision, par voie de presse écrite, de tribune parlementaire, de commissions, nous ne faisons pas autre chose que de nous engueuler, passant nos journées à animer nos luttes partisanes, opposant l’écriture inclusive à la menace woke, la lutte contre la précarité à la baisse de la fiscalité, le maintien des services publics au désendettement du pays ; et chacun pourra aisément compléter cette liste. Nous voyons en quoi, chez Aron, la démocratie est bien une conjonction, celle de considérations institutionnelles et sociologiques : nous nous engueulons parce que nous avons théorisé un cadre institutionnel prévu à cet effet, nous nous engueulons également parce que nous avons intégré dans nos mentalités la nécessité d’opposer nos opinions respectives dans l’agora ; et il est désormais difficile de savoir qui des institutions ou de la sociologie, de notre Constitution ou de nos mœurs collectives, de l’œuf ou de la poule, est à l’origine de cette dynamique politique.
En résumé, « cette concurrence suppose une bataille continue entre les individus et les groupes » (27). Dès lors, la démocratie emporte en son sein, pour reprendre l’expression de Raymond Aron, sa propre corruption. La concurrence pacifique comporte les risques de sa dissolution. D’où cette question fondamentale : « quelle est l’intensité des querelles compatibles avec le maintien de la concurrence pacifique ? » (28). En d’autres termes, comment sauvegarder l’unité nationale dans un cadre de concurrence interne permanente ? Question qu’on peut renforcer si on considère l’unité comme une condition préalable et nécessaire à la création de compromis : en effet, le compromis n’est rendu possible que si les parties en présence partagent un projet, un cadre ou un minimum de valeurs en commun.
Raymond Aron aborde un ensemble de conditions qui ne sauraient être exposées dans leur intégralité. Nous nous bornerons à celles qui nous paraissent les plus essentielles pour appréhender notre temps. Ces conditions, encore une fois, tiennent tant à des facteurs institutionnels qu’à des facteurs sociologiques. Nous rappelons systématiquement ce fait, il est d’importance. La conjugaison des deux souligne que, chez Aron, une crise démocratique ne saurait se suffire d’un changement constitutionnel ; voilà qui évacue toute forme de slogan simpliste.
Sur le premier point, nous le citerons directement dans le texte : « Le moyen le meilleur, quand il est possible, c’est de donner à l’ensemble des dirigeants politiques le respect des valeurs communes et un certain sentiment de solidarité. Il faut ce que, en général, on dénonce, à savoir que l’ensemble des parlementaires se sentent plus solidaires les uns des autres qu’ennemis les uns des autres. Cette proposition peut sembler paradoxale : d’ordinaire, on dénonce le fait que les parlementaires, après avoir échangé des injures dans la salle des séances, se retrouvent ensuite à la buvette. Je prétends quant à moi que le régime parlementaire fonctionne d’autant mieux que ce sentiment de solidarité entre les adversaires politiques est plus fort. Ce n’est absolument pas paradoxal. Un régime parlementaire ou un régime démocratique suppose des oppositions sur un certain nombre de questions, mais aussi le respect de valeurs communes. Quand il n’y a plus du tout de valeurs communes – et malheureusement nous constatons le phénomène dans un certain nombre de pays aujourd’hui -, le système de compétition pacifique ne peut plus fonctionner. Encore une fois, ce n’est pas du tout un paradoxe, mais simplement du bon sens : il faut que les différents partis politiques gardent le sens de certaines valeurs communes, au moins le sens de la valeur commune du système de la concurrence pacifique. » (29) Quand l’appétit va, tout va !
En clair, Raymond Aron nous dit qu’il faut que l’animosité politique, donnée irréductible à la sphère politique, ne conduise pas à une animosité personnelle irrémédiable. Il va de soi que la politique est aussi affaire d’incarnation, et les détestations sont monnaie courante dans les couloirs des assemblées ou bureaux politiques. Reformulons : il ne faut pas que les différences d’opinion – le fait que les uns soient libéraux et les autres socialistes, que les uns défendent la retraite à 65 ans et les autres à 60 ans – aboutissent à criminaliser la personne d’autrui. Les différences d’opinion ne doivent pas devenir des crimes, il faut qu’on les admette comme admissibles dans le débat public.
Ce qui paraît être une lapalissade devient de moins en moins courant. La violence politique se normalise, tant en termes de vocabulaire employé que de violence physique. Elle nous semble résulter de trois facteurs différents.
D’une part, il faut dénoncer une certaine forme de radicalité politique. Mais, sur ce point, il nous faut être précis et tendre à l’impartialité. La radicalité, surtout chez Aron, n’est pas seulement possible, elle revêt un caractère quasi-nécessaire. « [Les citoyens] doivent éprouver des passions partisanes pour animer le régime et empêcher le sommeil de l’uniformité » (30). Et d’ajouter : « Je n’oserais dire que le bonheur des citoyens se mesure à l’intensité des troubles politiques ressentis par la cité, mais la qualité d’un régime politique ne se mesure pas non plus à la paix apparente » (31). La chose est dite. Toutefois, l’excès de radicalité peut conduire à l’incapacité à trouver un terrain commun de discussion. La radicalité peut mener à la criminalisation de ses adversaires politiques. On se souvient par exemple de ce député qui, durant la réforme des retraites, a posé son pied sur un ballon de football à l’effigie d’Olivier Dussopt, ministre alors en charge de la réforme. On se souvient encore, dans la même séquence, d’une autre députée ayant traité ses collègues du camp présidentiel de « monstres ». On se souvient, là aussi, toujours dans la continuité de cette séquence, de ce député ayant traité le ministre Dussopt « d’assassin » en plein hémicycle.
« Nous projetons dans la verticalité de nos institutions des vertus pacificatrices qui sont, il faut bien l’admettre, fantasmagoriques. »
Cette surenchère ne traduit pas seulement l’expression d’une opposition frontale, légitime au demeurant. Nous parlions de tendre à l’impartialité : ce qui est en jeu ici n’est pas le fait de défendre la VIème République, la dénonciation du racisme systémique ou de violences policières. Il y a là autre chose. Nous assistons à la confusion consciente entre les personnes et leurs actes, entre les individus et leurs idées, considérant que de mauvaises opinions (chose a priori inexistante du point de vue de l’Etat) traduisent une souillure de soi, voire la manifestation d’une faute. Toute la brutalité de l’expiation, consubstantielle à la réparation d’une faute, ne peut donc passer que par la dépréciation de nos adversaires politiques jusque dans leur intimité personnelle, à en faire des sujets de mépris. Cette culture ne peut engendrer que de la violence et la délégitimation de ses adversaires, y compris lorsqu’ils sont majoritaires. Comment se retrouver en toute cordialité à la buvette après s’être fait traiter d’assassin ? Comment envisager des discussions politiques apaisées lorsqu’un adversaire nous enjoint à « fermer sa gueule » ? (32) Ce genre d’attitudes est incompatible avec un système de concurrence pacifique.
Deuxième facteur, cette fois-ci imputable à la majorité présidentielle : l’emploi ad nauseam de la rhétorique de l’arc républicain. La parole des cadres Renaissance essentialise régulièrement toute alternance politique à la dichotomie suivante : celle des modérés contre les radicaux, des responsables aux populistes – et pourquoi pas encore, celle des raisonnables contre les fous ; discours qu’on peut aisément condenser dans la formule « Moi ou le Déluge ». Les innombrables procès en sécession, en volonté de faire tomber la République, qui volent tant à l’égard du Rassemblement national que de la Nupes, sonnent comme autant de discours qui s’attribuent la rationalité par défaut. Certes, on ne saurait refuser toute hiérarchisation des discours et propositions politiques ; c’est le fondement même de la politique militante. Adhérer à un parti ou un projet politique, c’est considérer la moindre valeur des discours alternatifs. De même, l’absence de fermeté à l’égard de doctrines extrémistes peut être assimilée à du relativisme. Mais l’excès de partisanisme et l’excès de modération partagent en réalité plus qu’ils ne veulent bien le concéder : une forme de vindicte morale, qui fait de l’altérité politique une figure du mal. Le bloc central alimente de cette façon la surenchère en radicalité. Il y a là un autre facteur qui empêche la construction de compromis.
Troisième facteur, qui nous amène à quitter le terrain sociologique pour retourner sur celui institutionnel : la structure de la Vème République qui fait du chef de l’Etat le pivot de la politique nationale ; prédominance institutionnelle qui grippe la mécanique du compromis.
Revenons à des considérations moins d’actualité. Comment se construit le compromis ? Sans doute recouvre-t-il à la fois une dimension spatiale et une autre temporelle : spatiale, au sens qu’il nécessite un ou des espaces de discussion dans le(s)quel(s) seront arbitrés les désaccords ; temporelle, au sens d’une temporalité intrinsèque qui voit le déploiement opérationnel de ces discussions selon des impératifs divers et concurrents (calendrier législatif, médiatique etc.). En clair, construire un compromis, considérer la pluralité des idées, cela demande du temps, de la maturation, et à aller trop vite, on risque surtout de froisser ses interlocuteurs.
Concrètement, on pense ici aux administrations ministérielles, où se rencontrent représentants de l’Etat, techniciens, représentants syndicaux ou sectoriels ; au Parlement qui abrite les discussions de couloirs, les discussions en commissions, les discussions en hémicycle, où les oppositions s’affutent en même temps qu’elles débattent des amendements potentiellement acceptables, des accords législatifs à construire, des propositions de loi ou résolutions à même de faire consensus. Par-delà la diversité des situations évoquées, on retrouve quelques traits communs : une pluralité d’acteurs aux intérêts, opinions et objectifs différenciés, au sein d’une hiérarchie complexe qui voit se déployer des personnages tout à fait distincts (allant du ministre au représentant d’intérêt en passant par le président de telle commission et même des influences externes plus ou moins diffuses – le corps électoral en circonscription), soutenus entre eux par divers rapports de force (le député d’opposition ne saurait avoir le même poids que le rapporteur de telle loi soutenue par le gouvernement). Nous pouvons dire qu’une démocratie en bonne santé construit l’intérêt général – et le compromis – par la confrontation institutionnalisée de l’ensemble de ces perspectives, tout en maintenant la pluralité inhérente à ce processus, tant dans les acteurs investis dans le débat que ceux qui participent in fine à l’arbitrage des discussions.
En fait, on peut dire qu’une démocratie saine assume et préserve le tumulte des discussions, pour la simple et bonne raison que la société civile elle-même est traversée par la richesse de ses divisions. Nous pouvons même dire que le postulat qui fonde toute démocratie représentative réside dans le constat d’une irréductible division de la société civile mue par des opinions parfois radicalement opposées à laquelle il nous faut penser une issue institutionnelle, donc collective et pacifiée. John Locke imagine ainsi l’impossible pérennité de l’état de nature par l’incapacité des individus à se mettre d’accord, sans l’intervention d’un tiers, ne serait-ce que sur la définition du tien et du mien. Le passage de la société de nature à la société politique trouve ainsi son point de bascule dans l’instauration de l’État, compris comme « l’ensemble des procédures permettant à cette société dans lesquels les intérêts à l’œuvre sont contradictoires de les régler par le mécanisme de la démocratie parlementaire » (33). Le fédéralisme américain répond de la même logique : une construction circonscrite dans un héritage historique déterminé, qui tente de résoudre le problème de la division à l’aune d’une crise politique singulière et irréductible, celle qu’ont connu les Américains à partir de la fin du XVIIIème siècle. On est loin de la description abstraite de l’Etat issue de l’empyrée des idées, répondant d’une logique de pure philosophie. Définition ici organique de l’Etat, vidée de toute substance mystique, qui pense l’unité nationale comme une construction lente, tumultueuse, et foncièrement prosaïque, au sens qu’elle cherche les moyens pratiques à cette fin (un Parlement, des ministères, des droits politiques, des entités décentralisées etc.), sans le grandiose d’une esthétique politique ou un salut quelconque. Si esthétique il y a, c’est plutôt celle du mécanicien, les mains dans le cambouis.
Nous autres Français avons fondé l’ensemble de nos régimes politiques depuis au moins la Révolution sur une perspective toute autre. «Rousseau vient présenter une construction qui est antagoniste aux thèses de Montesquieu, de Voltaire et plus tard de Tocqueville, une conception dans laquelle l’unité de la nation va se trouver réalisée par l’assomption d’un Etat tout-puissant procédant mystiquement d’une volonté générale que personne ne peut jamais décrire. Nous attendons une révélation. » (34) Précisément, pensent les libéraux, parce que l’intérêt général n’est jamais une donnée objective et anhistorique, il ne saurait résulter d’une logique de pure verticalité, révélée par l’Etat à la société.
Or, au lieu d’imaginer des institutions qui pansent la division interne à la société dans une dynamique allant de bas en haut, dans une inertie qui va de la société civile à ses représentants, de ses représentants aux ministres, des ministres au chef de l’Etat, nous avons produit le contraire. Nous projetons dans la verticalité de nos institutions des vertus pacificatrices qui sont, il faut bien l’admettre, fantasmagoriques. Le Président de la République est perçu comme le pivot à même d’arbitrer nos contradictions. Bien que n’étant pas un farouche opposant à la Vème République (contexte de crise politique et de crise algérienne obligent, sans doute), Aron condensait cette perspective dans la formule suivante : « La IVe République réduisait l’autorité de l’exécutif au-delà de la raison, la Ve ampute les prérogatives des Assemblées au-delà de tout bon sens », avant de conclure, « tout se passe comme si une mauvaise fée jetait un sort sur chacun des régimes français au berceau et en préparait la mort au jour de sa naissance. » (35) Et Raymond Aron de rappeler, dans son Essai sur les libertés, de quelle manière le Président de la République domine la Vème, plaçant les parlementaires dans un rapport de subordination. « Un homme fait élire les députés qui se réclament de lui bien loin de passer par leur intermédiaire avant de se présenter aux suffrages » (36).
Les députés sont ainsi piégés dans une position de redevabilité, non devant le corps politique, mais devant le président qui les a fait élire ; fait aggravé par l’inversion du calendrier électoral. En conséquence, le gouvernement ne trouve pas dans le Parlement l’incarnation d’un frein à ses ambitions mais, au contraire, une majorité de soldats prêts à combattre pour ses desseins – et une opposition réduite au rôle de témoin. À ce propos, le vice-président de l’Assemblée nationale, Hugues Renson, en motivant il y a quelques temps le non-renouvellement de son mandat, nous livra un précieux témoignage : « L’Assemblée nationale en vient à être considérée – et parfois à se considérer elle-même – comme une chambre d’enregistrement de décisions élaborées ailleurs. » Cette relation de subordination est aggravée par l’incapacité du Parlement à confronter efficacement l’exécutif sur des sujets techniques, ne disposant pas de moyens suffisants et d’un corps administratif dédié à cette tâche.
Cette architecture institutionnelle complique radicalement l’émergence du compromis. Nous avons posé plusieurs conditions à sa réalisation : une dimension spatiale (un ou des espaces de fabrication du compromis), une dimension temporelle (temporalité intrinsèque qui voit le déploiement opérationnel de ces discussions selon des impératifs divers) et le pluralisme des acteurs engagés. L’hyper-présidentialisation est en rupture avec chacune des conditions citées. La multitude des intérêts et idées divergents, et son réseau complexe d’interactions au sein d’une séparation claire des pouvoirs, a été remplacée par la solitude d’un homme face à la foule. Comble de l’affaire, la toute-puissance présidentielle réduit sa capacité d’action. Réputé à la fois chef du gouvernement, leader de la majorité parlementaire, faiseur des prix et des salaires, chevalier en lutte contre le chômage, maître de la politique industrielle, au fond, réceptacle de toutes les interrogations, espoirs, colères, le chef de l’Etat se retrouve comme paralysé, bien incapable de donner satisfaction à l’ensemble des injonctions contradictoires et des regards qui scrutent jusqu’à son modèle de montre.
Pour cause, nos institutions n’ont pas pour objectif de donner pleine satisfaction à tous ces acteurs et enjeux. Les institutions ont en revanche vocation à leur donner un écho et une place dans la détermination des politiques publiques, par la diversité des acteurs les représentant au sein de l’Etat, chose rendue largement inopérante par la concentration du pouvoir autour du Président. Le Parlement est devenu muet, la société civile aussi, réduite à des moyens de contestation bien maigres – allant de la manifestation bruyante à la voie judiciaire. Un homme décide. Le tempo comme le fond des dossiers sont décidés à l’Elysée. Le reste n’a qu’à suivre. Si Raymond Aron marquait sa méfiance pour les régimes de toute-puissance parlementaire, il semble bien que ce soit l’inverse, un régime d’hégémonie présidentielle, qui est en train de se produire.
Les mécaniques du compromis sont grippées, mais ce n’est pas tout. Raymond Aron rappelle que si le compromis nécessite l’unité nationale autour d’un socle de valeurs en commun, et si la démocratie produit d’elle-même ses facteurs de division, il nous faut alors consacrer un espace de neutralité au sein des instances étatiques dans lequel l’unité du corps politique prend forme. Par neutralité, il entend le besoin de soustraire certains organes de l’État de la lutte partisane. Il vise par cette idée l’administration, mais il vise encore le chef de l’Etat qui doit dans cette perspective incarner une stabilité inhérente à la sauvegarde des institutions, dans une position à même de dépasser le conflit des passions. Certes, sous la Vème République, le Président est formellement soustrait aux luttes partisanes pendant la durée de son mandat, il n’en reste pas moins très (trop ?) engagé dans la bataille politique. Il ne s’agit pas seulement de voir de quelle manière une grande partie de sa tactique est d’emblée engagée dans sa réélection, de même que ses opposants qui sont engagés dans la même dynamique (comment pourrait-on leur reprocher d’ailleurs ?). Il s’agit de voir comment la starification de la figure présidentielle conduit à ce que le vecteur de stabilité élémentaire de nos institutions qu’est le chef de l’Etat devienne lui-même l’objet de toutes les animosités. Tout débat tend à départager qui est pour ou contre le Président. Les gadgets du « grand débat », des « conventions citoyennes » jusqu’à la « commission transpartisane » accentuent à contre-emploi la crise politique puisqu’ils concurrencent une institution représentative élue trop affaiblie (l’Assemblée nationale) tout en entretenant le pivot présidentiel de la vie politique. De même, il est aberrant d’observer de quelle manière, un an à peine après l’élection de 2022, toutes les attentions et hypothèses portent sur 2027.
« Les élites comme les citoyens doivent accepter la lenteur du travail parlementaire. Il faut être démocrate avant d’être technicien. »
Excès de radicalité ou de démagogie, excès de modération, centralité de la figure présidentielle : pour le dire grossièrement, tout mène à rendre le compromis insupportable, vécu par tout le monde comme une concession à l’ennemi, si ce n’est une trahison. Cet énoncé peut sembler trop caricatural pour décrire la réalité vécue (des compromis persistent et le pays n’est pas à feu et à sang) : il pointe néanmoins la dynamique à l’œuvre dans la société et qui ne peut qu’augurer d’une fracturation toujours croissante de la société.
Le paradoxe de la démocratie française : un État omnipotent mais inefficace
Cette problématique de l’efficacité anime une troisième tension qui touche à l’essence même des démocraties modernes. Le paradoxe de nos régimes politiques est d’avoir organisé dans le même temps la limitation du pouvoir et son extension indéfinie. L’État, ayant historiquement démontré sa capacité de nuisance par des pratiques arbitraires, devait être limité par des contre-pouvoirs et le système des libertés publiques ; c’est la naissance du libéralisme politique. Mais l’Etat est dans le même temps le tiers nécessaire à la garantie des droits, des droits d’ailleurs toujours croissants au fil de l’histoire. Ainsi avons-nous inclus dans la nomenclature des droits politiques, en plus des droits dits formels propres à la Déclaration de 1789 (liberté d’expression, d’association, de conscience etc.), les droits dits économiques et sociaux de la Déclaration universelle de 1948 (liberté syndicale, droit au logement, droit à la santé etc.).
Les sociétés démocratiques face à l’extension indéfinie de l’aspiration égalitaire
Un développement soutenu d’ailleurs par l’infusion de l’idée démocratique au sein de la société civile. Tocqueville fut en la matière un des observateurs les plus lucides de ce phénomène : à mesure de l’avancement de la démocratie, du travail qu’opérait l’idée d’égalité sur la société elle-même, le corps social ne pouvait plus seulement se contenter de l’égalité des droits, elle devait réaliser l’égalité dite des conditions. À charge donc à l’Etat d’organiser, non plus simplement l’égalité des droits, mais l’égalité sociale, ou réelle, tant dans le domaine de l’économie ou de l’éducation ; faire en sorte que les plus démunis puissent avoir les conditions de leur subsistance, que les inégalités ne soient pas trop marquées, que les moins éduqués puissent recevoir une formation qualifiante etc.
Pour l’auteur de De la démocratie en Amérique, que Raymond Aron appelait dans La Révolution introuvable son maître, cette dynamique de l’égalité sociale distille l’autoritarisme en germes, cela en deux temps. D’une part, elle produit l’individualisme : pourvu que l’Etat distribue le bonheur, il devient gré aux yeux de tous de vivre isolé de ses pairs, tentation d’autant plus pesante à l’heure où la société industrielle produit d’immenses bienfaits matériels. Confortables et repus, les citoyens s’engouffrent dans le matérialisme et, pour reprendre un langage de gauche, participent d’un processus de dépolitisation, car se désinvestissant des affaires publiques. Quel meilleur allié pour le pouvoir, nous dit Tocqueville, que des citoyens qui délaissent la liberté politique ? En clair, qui n’opposent plus de résistance aux velléités du gouvernement ? On le voit d’ailleurs, la liberté des libéraux ne saurait être entendue comme l’égoïsme. De surcroît, l’égalité sociale, non contente de distendre les liens sociaux, attribue un ensemble de prérogatives nouvelles à la faveur de l’administration et du politique, renforçant dès lors son imprimatur. Ainsi, Tocqueville de conclure : « Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté ; livrés à eux-mêmes, ils la cherchent, ils l’aiment, et ils ne voient qu’avec douleur qu’on les en écarte. Mais ils ont pour l’égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible; ils veulent l’égalité dans la liberté, et, s’ils ne peuvent l’obtenir, ils la veulent encore dans l’esclavage. Ils souffriront la pauvreté, l’asservissement, la barbarie, mais ils ne souffriront pas l’aristocratie » (37).
Raymond Aron aura ce privilège de l’histoire sur Tocqueville : deux siècles après ses analyses, il est non seulement témoin de l’hégémonie du productivisme dans la sphère économique, avec un accroissement incomparable du niveau de vie général, mais il assiste également à la prolifération des droits économiques et sociaux à même de reconnaître et d’organiser l’égalité sociale. À noter qu’à la différence de l’auteur normand, Aron adopte une position moins rigide sur l’ampleur du phénomène : dit simplement, il considère que la combinaison des libertés formelles et des libertés réelles, des droits personnels avec les droits économiques et sociaux, constitue la meilleure synthèse historique entre les idéaux libéraux et socialistes. Cette synthèse le conduira toutefois à conclure : « La démocratie politique, dans les sociétés industrielles, semble conduire nécessairement à une forme de socialisme » (38) ; conclusion d’autant plus définitive qu’elle résulte d’un compromis social qui nécessite l’inclusion des classes populaires dans le spectre des institutions. Cette « démocratie des masses », comme il l’appelle, est « une démocratie où l’État remplit des fonctions économiquement et socialement importantes, et d’une importante croissante » (39). La thèse forte d’Aron, c’est que cette quête égalitaire mène inévitablement à une « socialisation » partielle des démocraties libérales.
Ainsi, Aron considère que les démocraties à l’ère de la société industrielle ne peuvent s’accommoder d’un libéralisme économique total. La combinaison de la compétition pacifique et de l’obsession des problèmes économiques qui caractérise son époque rend inévitable une demande citoyenne croissante d’intervention de l’État dans l’économie. Il s’oppose ainsi à Hayek (40) dans un débat bien connu et tire une conclusion que l’Autrichien ne pouvait accepter : le libéralisme politique ne va pas de pair avec le libéralisme économique. « Le système de la compétition en vue de l’exercice du pouvoir, écrit-il, lorsqu’il fonctionne dans une société cristallisée en groupes d’intérêts, tend à rendre difficile le fonctionnement d’un système d’économie libérale, l’essence de l’économie libérale étant de laisser les cruautés du progrès économique s’exercer par la force aveugle du marché […] Lorsque les intéressés n’acceptent plus de souffrir à cause des forces aveugles du marché, comme on dit, ils demandent à l’état pour atténuer les chocs » (41).
Les démocraties libérales des sociétés industrielles sont donc condamnées à un régime d’économie mixte, c’est-à-dire une société de marché s’accommodant d’une direction partielle de l’économie. L’État-providence qui en résulte porte, selon Aron, une instabilité chronique liée à la tentative de conciliation entre sauvegarde des libertés individuelles, développement d’une bureaucratie utilitariste, et délibération politique.
Quarante ans après, la demande égalitaire s’est accentuée
Difficile de ne pas donner raison à Aron. La quasi-intégralité des Etats occidentaux ont multiplié ces dernières décennies des mécanismes sociaux en matière de pauvreté, de santé, de logement ou d’éducation. La France s’illustre par une croissance particulièrement marquée de tels dispositifs. L’immixtion de l’Etat n’est pas seulement fiscale, elle est encore normative et administrative, les gouvernements successifs multipliant plans et numéros verts pour pallier aux défaillances de la société. Dynamique heureuse ? Là-dessus, il nous faut séparer le bon grain de l’ivraie. Dans Pensée sociologique des droits de l’homme, Aron s’oppose là encore aux libéraux classiques, estimant qu’au fond, la distinction entre droits dits personnels et droits économiques et sociaux, entre liberté formelle et liberté réelle, est surfaite. Non qu’il n’existe aucune tension entre ces deux pôles : mettre en œuvre le droit à la santé implique un appareil administratif et un interventionnisme bien plus prégnants que la simple garantie de la liberté d’expression. Mais le droit formel, dès lors qu’il est reconnu par la législation nationale, consacre le droit réel : ce qui permet in concreto de s’exprimer librement, c’est de voir sa liberté d’expression consacrée par le Parlement. La fin reste donc inchangée, tendre à rendre réel les droits formels ; seuls les moyens peuvent différer. Aussi considère-t-il que les droits personnels ne furent qu’une étape, tout à fait historique, dans un processus plus vaste qui consiste, en un mot, dans la défense du propre : contre l’arbitraire royal et la menace qu’il faisait peser sur la dignité personnelle, il nous a fallu inventer l’Etat de droit ; contre les mécaniques iniques de la société industrielle ultérieure, il a fallu créer les droits économiques et sociaux. Là encore, la fin reste invariable : la défense du propre, du sujet, de la dignité.
D’autant que, depuis la mort d’Aron en 1983, le phénomène de l’extension de la demande d’égalité au-delà des terrains politiques et économiques s’est poursuivie. Avec l’effondrement du communisme et le développement des théories post-structuralistes en sciences sociales, la gauche occidentale a connu d’importantes mutations ces dernières décennies. Les dominés ont changé de visage et les rapports de dominations ne sont plus essentiellement économiques. Avec l’intersectionnalité, notion d’abord descriptive et réservée aux thèses de sociologies et de science politique, et maintenant réappropriée par le langage militant de ce que nous appellerons la gauche identitaire (42), les discriminations deviennent multiples, protéiformes, et s’entrecroisent. Pour comprendre plus finement les rapports de dominations qui sont en jeu au sein des sociétés occidentales, la race, la sexualité, le genre, l’âge, la morphologie, la culture, sont autant de caractéristiques qui viennent compléter et s’ajouter à la catégorie classique de « classe sociale ».
Le succès du paradigme post-structuraliste, indépendamment des apports non négligeables que ce dernier a pu apporter aux sciences sociales, s’explique aussi par la continuation logique de l’extension de l’idée égalitaire. Une dynamique d’ailleurs déjà soulignée dans ses balbutiements par Raymond Aron dans Liberté, libérale ou libertaire ?. En résulte là encore des appels incessants à un surcroît d’interventionnisme politique, considérant la pertinence de l’Etat comme appareil de correction des structures sociales perpétuant l’oppression. Dans la continuité de ce débat entre liberté formelle et liberté réelle – ou plutôt ici, égalité formelle et égalité réelle – reste à savoir ce qui relève d’un souci légitime et nécessaire d’analyser les structures empêchant la pleine détermination de l’individu et ce qui dénote de considérations résolument illibérales. C’est une chose de constater les conséquences normatives d’un imaginaire structurellement masculin dans la détermination et la répartition des tâches ménagères ou des professions entre hommes et femmes ; une autre que d’en appeler à l’Etat pour sanctionner des hommes trop enclins à laisser leurs femmes passer l’aspirateur ou faire le repassage ; fin qui impliquerait la naissance d’une structure policière d’ampleur – si seulement celle-ci est possible. On peut rejoindre au moins partiellement l’analyse dans son pan descriptif, mais nullement ses conclusions normatives. Aron adoptait d’ailleurs une attitude semblable à l’égard de Marx : grand lecteur de l’auteur du Capital, appuyant régulièrement sur la finesse de ses constats quant à l’aliénation ou la nécessité de rendre les libertés réelles, Aron s’attaqua régulièrement au coût institutionnel de la dictature du prolétariat, pointant d’emblée les germes autoritaires qui imprègnent cette pensée (43).
L’État-providence français : quand individualisme et paternalisme vont de pair
Cette dynamique qui considère que la liberté sociale constitue bien une partie intégrante du domaine de la liberté s’est mue en France en une allergie pour les libertés personnelles et économiques.
Là où les libéraux doivent rechercher l’équilibre entre les libertés, comme le soulignait régulièrement Raymond Aron, la France a basculé dans une préférence nette pour une croissance indéfinie de la socialisation de l’économie. En démontre l’augmentation massive des dépenses publiques, la part toujours plus large de l’administration, la multiplication des agences gouvernementales et autres organes publics d’intervention dans l’économie, les plans en tout genre, qui concernent tant l’administration locale que l’Etat central ; et même, en élargissant, il ne se trouve pas aujourd’hui un parti politique majeur qui ne défende pas, à quelques exceptions près, d’accroître les dépenses (44), ceux proposant un rationnement somme toute mineur se voyant immédiatement opposer l’accusation en ultra-libéralisme.
L’ambiance générale n’est pas à la liberté, elle est à la tutelle : chacun quémande pour soi des avantages, quelques bienfaits, et des torts pour les autres. Ainsi voit-on régulièrement des groupes d’intérêt réclamer ici ou là des aides économiques – les temps sont toujours difficiles – mais se fiche royalement qu’on conditionne le RSA ou qu’on pointe régulièrement du doigt les familles les plus modestes quant à l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation chômage ; le tout, à la faveur d’une administration toujours plus encline à contrôler. Que des groupes d’intérêt existent, c’est une chose convenue en démocratie – Aron y voyait même le développement normal d’une société atomisée où la voix individuelle perd en influence. Que ces groupes se meuvent en règne des idiosyncrasies où l’intérêt général importe peu tant que l’Etat veille au confort de chacun, voilà qui est beaucoup plus inquiétant et qui confirme le cauchemar tocquevillien tant redouté. Ce ne sont pas seulement les libertés économiques qui en pâtissent, ce sont encore, de façon paradoxale, les libertés sociales qui en font les frais (par l’accroissement toujours plus large du pouvoir de l’Etat), et les libertés politiques, qui ne sauraient survivre au sein d’un appareil d’Etat mu par la verticalité.
La combinaison de l’individualisme auquel se référait Tocqueville et de la croissance du paternalisme étatique dans le cadre de l’État-providence contribue à réduire à peau de chagrin la responsabilité individuelle. Alors qu’ils délèguent de plus en plus de prérogatives à l’État, les citoyens n’abandonnent pas pour autant leur aspiration à la liberté individuelle.
« En clair, Raymond Aron nous dit qu’il faut que l’animosité politique, donnée irréductible à la sphère politique, ne conduise pas à une animosité personnelle irrémédiable. »
Le récent psychodrame des retraites illustre à merveille cet individualisme orphelin de responsabilité individuelle. Malgré la réalité du problème budgétaire et démographique que pose le système par répartition, et refusant par principe de discuter d’un changement de mode de financement (en instaurant, par exemple, une part de capitalisation), les contestations symbolisent ce refus de choisir entre hausse des cotisations des actifs, baisse des pensions des retraités et augmentation de l’âge de départ à la retraite. Ainsi, le citoyen se désintéresse complètement des contraintes réelles que nous venons d’exposer : il exige que l’État apporte une solution rapide et indolore. Qu’on ose soulever l’insoutenabilité du système, il rétorquera avec dédain : « alors, taxons les riches ! ». Cette déresponsabilisation s’observe également sur la question climatique. Alors que tout le monde communie dans la dénonciation de l’inaction du gouvernement et la revendication d’une action forte et volontaire, personne ne semble prêt à consentir au moindre effort. On trouve toujours plus pollueur que soit à qui demander d’assumer la résolution du problème.
Ces deux exemples dévoilent la mécanique perverse du despotisme démocratique se nourrissant de l’affaissement de l’engagement civique : dans une valse incessante, la responsabilité se transfère des uns aux autres, incapable de se fixer sur un hôte susceptible de l’assumer. En attendant, faute d’une réforme réaliste et ambitieuse, le problème persiste. On ne peut donc comprendre la crise de la démocratie française si l’on évacue de l’équation sa dimension culturelle : les institutions sont d’autant plus enclines à la centralisation et à l’omnipotence que les citoyens demandent d’être mis sous tutelle.
La mise sous tutelle des citoyens renforcée par la demande d’efficacité
Mais revenons à la question de l’efficacité. Elle devient pressante quand, comme exposé, vient l’heure de gloire de l’économie mixte. C’est qu’en effet, si l’Etat voit ses prérogatives s’accroître, si sa présence doit se faire plus manifeste, si l’attention se focalise sur ses bienfaits (souhaités, pas toujours réalisés), alors l’Etat doit toujours tendre à l’efficacité. Dès lors se fait à nouveau jour la question des libertés : peut-on concilier respect des libertés politiques, respect des libertés personnelles et efficacité de l’action administrative ? En d’autres termes, dans une ère qui accorde ses faveurs aux experts, techniciens et ingénieurs, peut-on toujours souffrir des lenteurs inhérentes à la délibération démocratique et à la garantie des droits ? « La confiance que nous éprouvons dans la science, la technique, l’organisation s’irrite des lenteurs qu’entraîne la délibération comme de la paralysie que risquent de causer les checks and balances, dans lesquels les auteurs de constitutions voyaient jadis l’art suprême et la garantie de la liberté. Ce qui était hier la fierté des législateurs fait aujourd’hui le désespoir des techniciens. » (45) L’efficacité est d’essence rythmique. Les temps morts sont un mal. Il faut aller vite. Toujours plus vite. « Parce que, vu sous l’angle de l’efficacité des travaux et de leur organisation, ce système de compétition entraîne une déperdition de forces. Il est insupportable pour un homme qui a le goût de l’efficacité d’être obligé de consacrer des heures, des jours, des semaines, des mois à convaincre des gens qui ne savent pas de quoi il s’agit, et il est inévitable que, au fur et à mesure que les sociétés sont davantage dirigées par des meneurs de masses, par des techniciens, par des administrateurs, ceux-ci aient de moins en moins de goût pour les règles, pour le jeu de la compétition électorale. » (46)
La mentalité de l’ingénieur est assez peu compatible avec l’esprit démocratique. Elle l’est d’autant moins qu’elle tente de prospérer sur fond d’un inconfort : « l’évolution du système démocratique conduit à une situation structurellement instable, en obligeant l’Etat à être responsable d’une très grande partie de l’économie, tout en réduisant considérablement son pouvoir de décision. » (47) Nous retrouvons ici la tension primordiale d’un régime démocratique moderne, entre limitation du pouvoir et souveraineté populaire qui tend à élargissement de ses prérogatives : limitation contre l’arbitraire, extension pour l’égalité sociale. « L’évolution du système parlementaire tend à l’affaiblissement du pouvoir, alors que l’évolution économique du système démocratique tend à l’extension des fonctions de l’Etat. » (48) Et Aron de conclure : « Il en résulte donc une nécessité apparente, un État de plus en plus étendu et de plus en plus faible, ou encore un Etat dont le prestige, la capacité d’action et de décision vont en diminuant, et dont les fonctions s’étendent » (49). L’exemple qu’il cite est assez frappant de notre époque. Concernant la politique des prix, les gouvernements cherchent toujours à convaincre les syndicats d’être modérés et, s’adressant au patronat, lui demandent en parallèle de limiter la distribution de dividendes. On peut difficilement s’empêcher de penser ici à un Bruno Le Maire demandant continuellement aux grandes enseignes depuis la crise en Ukraine de limiter leurs marges afin que le coût de l’inflation ne repose pas dans son intégralité sur les consommateurs. Parce qu’il doit organiser l’égalité sociale, l’Etat est perçu comme le garant du pouvoir d’achat (extension de ses prérogatives), ce même Etat incapable d’imposer des mesures trop restrictives comme le blocage des prix ou la limitation des marges, au risque d’affaiblir irrémédiablement la dynamique économique (limitation de son pouvoir).
Dans ce climat, quel avenir pour l’Etat de droit et le parlementarisme ? Il y a un risque clair de dépréciation des institutions où, définitivement, l’ingénieur devient président. Tout dépend in fine de l’état d’esprit ambiant, tant des dirigeants que des citoyens – et même en réalité, bien plus de la « psychologie des chefs ». « Il faut que les dirigeants politiques aient un certain respect de ces règles du jeu et veuillent qu’elles soient respectées. Or, la psychologie des meneurs de masses, la psychologie des économistes dirigistes, la psychologie des ingénieurs qui construisent les barrages, tout cela est extrêmement peu favorable au système de la compétition. » (50) En clair, il ne faut jamais que les impératifs d’efficacité prennent le pas sur l’esprit démocratique. Les élites comme les citoyens doivent accepter la lenteur du travail parlementaire. Il faut être démocrate avant d’être technicien.
Le paradoxe de la modernité se matérialise donc par la tension qui existe entre deux aspirations incompatibles. La première, celle de la liberté, sous-tend une société plurielle, dans laquelle les individus sont appelés à se différencier et à se singulariser, mais implique l’acceptation d’une hiérarchisation et d’inégalités. La seconde, celle de l’égalité, sous-tend une société de l’uniformité et de l’indifférenciation, laissant peu de place aux initiatives individuelles, le citoyen n’existant qu’à travers la collectivité. La première tend au retrait de l’État et à la responsabilisation des individus, la seconde implique un état centralisateur, vertical et technocratique.
Nous partageons avec Aron l’idée selon laquelle les démocraties modernes, à l’ère de la complexité des sociétés industrielles, ne peuvent échapper à ce paradoxe amenant à un régime mixte contenant une part de socialisation. En revanche, Tocqueville avait raison de noter que les démocraties peuvent emprunter deux chemins, celui de la liberté ou celui de la servitude. Car des deux aspirations, l’on peut choisir d’en privilégier une aux dépens de l’autre, de faire pencher la balance du côté des libertés. Montesquieu, Constant, Tocqueville, Aron, tous voient dans la démocratie libérale constitutionnelle le modèle le plus apte pour se prévenir de la route de la servitude.
Quel avenir pour le modèle de la démocratie libérale constitutionnelle en France ?
Nous vivons l’époque de toutes les urgences. Climat, covid, terrorisme, islamisme, insécurité, paupérisation, recul des démocraties libérales, montées en puissance des logiques belliqueuses : sommes-nous à la croisée des chemins ? L’air de la liberté n’est-il pas voué à se raréfier, voire disparaître, au risque d’étouffer ? Tout conspue à la quête irrépressible d’efficacité. Ainsi s’enchaînent les plaidoiries en faveur de l’ordre : face au terrorisme, cessons avec la présomption d’innocence et enfermons préventivement les fichés S ; « nous sommes en guerre », à quoi bon délibérer ? ; la planète se réchauffe, il nous faut d’urgence planifier, restreindre, administrer ; la délinquance prospère, rompons avec cet État de droit auréolé de naïveté ; les Jeux Olympiques approchent, réinstaurons des QR codes et des zones de contrôle. Ce n’est pas seulement l’aisance avec laquelle les doctrines de l’ordre se transmettent, selon un principe d’inertie, des intellectuels aux politiques, des politiques aux parlementaires, des parlementaires aux ministres, des ministres au Président, sans arrêtoir quelconque, qui doit nous inquiéter. C’est encore cette adhésion de façade chez les citoyens au système des libertés qui ne passe jamais l’épreuve du réel. Il est aisé d’être scandalisé par les atteintes aux libertés. Tout le monde est outré de voir de quelle manière, par exemple, les restrictions liées aux Jeux Olympiques vont infiltrer jusqu’aux aspects les plus élémentaires de la vie sociale (comme circuler dans sa rue ou aller à son travail). A l’unisson, il ne se trouve pas une personne – ou presque – qui ne voit pas en horreur la multiplication de tels dispositifs restrictifs. Pourtant, c’est avec une certitude d’expert qu’on peut affirmer que tous les esprits concéderaient à la nécessité de telles mesures si par malheur survenait une attaque terroriste. L’urgence l’exigerait. Personne aujourd’hui ne pourrait ainsi défendre la fin des caméras de surveillance sans passer pour un gauchiste bisounours de la dernière heure.
« Être étranger au pouvoir, voilà le critère déterminant pour acquérir le sentiment intime qu’il est autoritaire. »
Qu’on s’entende bien : la demande en sécurité est fondamentalement légitime. Mais si la question institutionnelle pouvait être résumée à la sécurité et l’efficacité, nul besoin de construire une société politique faite de pouvoirs et contre-pouvoirs, de sujets de droit et de mécanisme de contrôle, nul besoin d’un Parlement, nulle utilité à des élections : il nous suffirait d’accorder l’administration des choses aux experts ou aux fanatiques de la matraque (les deux allants souvent de pair…). Si on légitime le pouvoir sur l’unique critère de la nécessité de la force publique, si l’instauration d’un Léviathan condense la finalité de toute société politique, si, dit autrement, le pouvoir s’auto-légitimait, alors il n’y a substantiellement plus rien qui ne différencie les régimes démocratiques des régimes autoritaires – ces derniers seraient sans doute d’ailleurs considérés comme plus vertueux.
Les régimes libéraux sont fondés sur un rapport inverse : l’Autorité est astreinte par la société civile ; là où la nécessité du pouvoir pense l’inverse. La société civile est créancière à l’encontre du pouvoir d’un ensemble de droits inaliénables. Le pouvoir est au service de la société civile, non l’inverse. À ce titre, il ne saurait jamais être illimité. Dès lors qu’on inverse ce rapport, que le pouvoir cherche à restreindre les libertés et les droits de chacun, motifs pris parfois de considérations très sérieuses et nobles, c’est la nature même de l’Autorité qui change, non plus fondé sur la nécessité du Droit, mais sur l’extension indéfinie du gouvernement. On repense à cette phrase de François Sureau : « On peut dire tant qu’on voudra que la liberté de boire des bocks en terrasse ne se compare pas à celle d’écrire. C’est bien possible, et c’est tout à fait indifférent. Personne d’autre que le citoyen n’a qualité pour juger de l’emploi qu’il fait de sa liberté ».
La quête d’efficacité, en plus d’être irrépressible, est, elle aussi, légitime et nécessaire. Mais la dynamique qui s’installe est toute autre : celle d’une efficacité qui se fait systématiquement au détriment des droits politiques. Nous parlons par exemple d’instaurer la rétention de sûreté – l’idée qu’on puisse prolonger la peine de prison d’un individu sur la base de soupçons conséquents d’un risque de récidive. L’objectif est clair : prévenir la criminalité, empêcher un surcroît d’insécurité, voire de drame. Mais à quel prix ? L’idée fondamentale en société libérale est qu’avant l’incrimination, il n’y a rien. Un rien éloquent, un rien qui énonce, un rien normatif. Ce postulat renferme toute la structure de la société du Droit : la liberté est. Sans astérisque, sans condition, sans devoir parallèle. Tout le monde est libre par principe, tout le monde est d’abord innocent, et ce n’est qu’a posteriori, en fonction d’un acte d’incrimination, qu’il y a des criminels à sanctionner. « Dès lors qu’il n’y a que des coupables potentiels et que la répression est mise en œuvre par l’Etat ou susceptible de l’être, il n’y a plus de citoyens libres ; il n’y a qu’une masse de personnes susceptibles tôt ou tard de voir peser sur eux la férule de l’Etat ». Cette formule de Sureau condense merveilleusement la bascule qui s’opère à travers les logiques sécuritaires : on passe de la liberté à la suspicion généralisée, de l’innocence à la culpabilité présumée, du sujet de droits, digne, singulier, à la masse, indifférenciée, magmatique, qui, tôt ou tard, pourra faire l’objet de la répression. C’est en ce sens que nous parlons d’une efficacité qui se fait au détriment des droits : on ne saurait enfermer un individu sur la base de rien (ce qu’est la rétention de sûreté), sauf à être en infraction avec nos propres principes ; et si la suspicion suffit, au fond, nous n’avons rien à envier au crédit social à la chinoise. Pourquoi la pensée se dirige-t-elle immédiatement vers la dépréciation des droits et non vers des hypothèses plus prosaïques, certes moins idéologiques, qui concernent les moyens et les missions de l’administration et des services de renseignement, les moyens concrets mis en oeuvre à la réinsertion, le nombre d’agents et les outils mis à disposition ? Considérations sans doute plus techniques, peu à même de nourrir les passions vivaces qui traversent notre société…
Dira-t-on que cette logique, angélique à souhait, aboutira à la libération d’individus qui, inévitablement, recommenceront leurs méfaits. C’est bien possible. Mais, à bien y réfléchir, rien n’empêchera la réalisation de ce risque. Là réside le poison des logiques sécuritaires : se targuant d’un risque perpétuel, elles distillent l’idée d’un ordre illimité, légitimant de façon aussi perpétuelle la mise en œuvre de mesures de contrôle toujours croissantes. C’est une logique d’auto-justification et nous voyons bien d’ailleurs de quelle manière après chaque attentat se rassemble le bal des apôtres du tout sécuritaire, réclamant toujours plus de restrictions, tout en promettant à chaque fois qu’elles suffiront à endiguer la menace. Ne permettant aucun surcroît d’efficacité, ces discours ne font en réalité que restreindre les libertés, rien de plus.
Voilà l’idée matricielle qui irrigue les Etats libéraux : un rapport au pouvoir fondé sur la liberté préalable des individus. « Car enfin, pour qu’il puisse être réputé avoir choisi ses gouvernements en toute liberté, ce qui détermine une part essentielle de légitimité d’un système politique, le citoyen doit conserver en toute circonstance sa souveraineté intellectuelle et morale. […] Le parlement n’est fondé à décider que dans les limites du respect de ces droits qui renferment la légitimité politique. » (51) Ce que nous voyons à l’œuvre sous les diverses urgences qui pressurisent la société, c’est la transformation lente, progressive, éparse, mais certaine, du citoyen en sujet, à la disposition du pouvoir en place.
Nous touchons dès lors à un point névralgique des démocraties, et nous en revenons à Aron. La vertu des régimes démocratiques ne réside pas dans l’efficacité. Aron considère d’ailleurs qu’elle dépend sans doute assez peu du régime politique ; du moins, il ne saurait jamais être un facteur exclusif. Dans l’absolu, un régime démocratique n’a pas vocation à être efficace ; ou plutôt, là n’est pas fondée sa supériorité. La supériorité des démocraties trouve sa réalisation dans la garantie des droits. « Si l’on part de l’idée des pessimistes que tout pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument, on conclura que, le pouvoir démocratique étant le plus faible et le plus limité, c’est celui qui corrompt le moins et qui commet le moins d’excès. Cette justification paraîtra bien pessimiste, mais rien n’empêche de traduire la même idée en termes optimistes, et cela consiste à dire : la démocratie est, jusqu’à présent, le régime qui, de beaucoup, a introduit le système de pouvoir le plus constitutionnel, c’est-à-dire qui a le plus réduit le côté arbitraire du gouvernement. C’est celui qui, de beaucoup, a donné aux individus et aux citoyens le plus de garanties par rapport à l’État, ce qui fait que, si on considère les régimes par rapport aux individus, je n’hésiterai pas un seul instant à dire que, des régimes connus ou, en tout cas, connus à notre époque, la démocratie est de loin le meilleur. » (52)
Conclusion
Nous parlions en introduction de notre propos de deux tendances concurrentes de la démocratie : l’une qui tend à la maximisation du pouvoir, l’autre qui tend à sa limitation. Cette simple conclusion, que le gouvernement doit être limitée en raison de ses excès toujours à venir, nous amène à radicalement choisir la deuxième dite libérale de la démocratie, seule à même de garantir les fondements de l’ordre social : les libertés personnelles et politiques.
Cette idée n’a plus rien d’évident. Car cette proposition emporte son lot d’inconvénients : elle renonce à la perfection. « Que les régimes démocratiques soient des régimes instables, cela me paraît incontestable. Qu’ils soient faibles, c’est souvent le cas, quoiqu’il ne faille pas généraliser: tout dépend des pays. Mais, si l’on veut chercher les mérites, ils sont immenses. Les mérites sont immenses à une condition – et c’est là que le machiavélisme intervient -, à condition que l’on ne cherche pas un régime parfait. » (53) Or, si nous vivons l’époque de toutes les urgences, nous vivons pour l’essentiel le refus du mal irréductible. Acculés d’urgences toujours croissantes, nous ne supportons plus l’existence de la violence, des attentats, de la pauvreté, des émeutes, bref, de tout un tas de phénomènes sociaux qui, il faut le dire, ont toujours existé, et sans doute de façon irrémédiablement plus meurtrière par le passé – nul jugement moralisateur ici, simple analyse descriptive. Hystérisation à bas bruit des esprits, qui s’imaginent toujours vivre en régime de libertés, alors que notre rapport au pouvoir a basculé depuis belle lurette. À vrai dire, nos institutions ont toujours traduit notre préférence pour le césarisme, la verticalité, le jacobinisme, en clair tout ce qui permet au pouvoir de se draper dans une position de domination, que celle-ci se traduise par des tendances autoritaires, bureaucratiques ou technocratiques.
« Raymond Aron nous rappelle que les peuples démocratiques sont assez peu enclins à supporter la mollesse politique. »
Nous expérimentons une irritabilité extrême face au mal, et nous consentons à tout pour nous en prémunir. Le seul bénéficiaire ici, c’est le tiers étatique, qui dispose de toujours plus de prétextes et de moyens pour étendre le contrôle administratif. La crise écologique en est encore une illustration : face au péril climatique, beaucoup en appellent à la planification et au besoin d’adhérer à une logique de guerre. France Stratégie d’écrire : « Les besoins de l’économie de guerre et les pénuries de la sortie de guerre sont à l’origine de démarches de planification, destinées à atteindre la meilleure allocation des ressources disponibles dans un contexte imposant « une gestion normative sous contrainte ». Ce sont aujourd’hui les limites planétaires qui en fournissent le cadrage. » (54) C’est oublier que le plan implique le commandement hiérarchique. Il substitue au citoyen libre le tiers étatique et son armée administrative. Et toujours cette nécessité, au nom de laquelle il est devenu si aisé de restreindre les libertés. Arbitrer entre l’essentiel et le superflu, tel que prôné par beaucoup de tenants de l’écologie politique, renverse le rapport entre l’individu et l’administration : si la démocratie libérale postule l’impossibilité pour le pouvoir de trier entre boire des bocks en terrasse et écrire des livres, le plan implique l’inverse. C’est la tutelle qui rôde, ainsi que la conditionnalité et la surveillance ; un triptyque redoutable pour les libertés publiques. Une telle hiérarchisation, par la diversité des critères de jugement, des fins en concurrence, des préférences individuelles, ne peut s’opérer qu’à travers le règne d’une techno-administration omnipotente.
L’acceptation de l’imperfection évoquée par Aron n’est pas un renoncement. Il ne s’agit jamais de dire : les attentats ont toujours existé, il faut se résigner. Jamais les libéraux, encore moins Aron, prônent la passivité politique. Aron a immédiatement choisi Londres en 40, a défendu l’indépendance de l’Algérie, a dénoncé les crimes staliniens et tous les totalitarismes. L’enjeu ici porte sur une autre question bien plus fondamentale : quel coût institutionnel sommes-nous prêts à consentir en vue de la réduction du mal ? Ce que répondent les libéraux, c’est qu’à moins de considérer que la fin justifie les moyens, on ne saurait accepter un coût exorbitant sans que la garantie des droits ne disparaisse par la même.
L’ensemble de ces considérations – la nécessaire défense des libertés, la lutte contre l’arbitraire, la garantie des droits – nous conduisent à la conclusion politique suivante : il nous faut désormais prôner la rupture.
La rupture avec notre logique institutionnelle, faisant la part belle au gouvernement, à l’administration, à l’esthétique napoléonienne, à la quête de puissance ; la rupture avec la verticalité, l’isolement de la figure présidentielle, le contrôle administratif ; la rupture avec notre culture politique, notre individualisme, notre égalitarisme forcené. Cette rupture ne trouvera pas d’issue par le biais d’une modalité politique exclusive. Nous l’avons rappelé : chez Aron, la démocratie est autant un fait institutionnel qu’un fait sociologique. Changer la constitution ne suffira pas, changer nos mentalités ne suffira pas, écrire des livres ne suffira pas, inventer une nouvelle esthétique ne suffira pas : il faudra un peu de tout cela pour oser espérer aboutir à un changement conséquent ; étant avertis que les circonstances jouent pour beaucoup dans ce genre de processus, souvent à la défaveur de toutes sortes de plans et projections. Le temps déjoue le plus souvent nos attentes. Le vacarme de la vie est ainsi fait : la surprise est là, tapis dans la seconde qui vient, dans le cliquetis de la montre sur le point de sonner. Le vacarme de la vie est ainsi fait, mais après tout, voilà sans doute le principe sur lequel repose l’action humaine.
Pour lire notre recueil en intégralité, cliquer ICI
Dans sa contribution à notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Alexis Carré rappelle le lien indéfectible que Raymond Aron tissait entre Etat-Nation et régimes des libertés. Alexis Carré considère la nation comme un réceptacle de la délibération et un moyen d’élargir l’horizon politique.
Une première version de ce texte fut prononcée à la journée d’étude Raymond Aron du 22 juin 2023.
« Les nations européennes sont-elles vouées à la décadence si elles demeurent des nations (1) ? »
Avec un ton anodin, qui conviendrait davantage à la formulation d’un sujet de dissertation, Aron formule pourtant là ce qui fut, de son propre aveu, la question obsédante de son temps. Constatons d’emblée que, depuis sa mort, l’emprise de ladite question n’a fait qu’étendre et épaissir l’ombre qu’elle fait peser sur notre vie pratique. Si sa présence se manifeste par des signes évidents, il est, j’en conviens, un tant soit peu inexact de dire qu’elle nous pèse. C’est en effet chez nous, en Europe, là où le déclin des nations a subi sa plus forte accélération ces dernières décennies, que ce processus a suscité le plus d’espoir et été accueilli avec la plus franche alacrité. Le désaccord de l’opinion reçue avec Aron ne porte donc pas sur la question de savoir s’il y a ou non un déclin des nations, mais sur la manière dont il convient de l’apprécier. Et c’est ce désaccord qui pousse Aron à poser cette question, non pas dans des termes généraux, mais aux européens en particulier. La dissolution des nations est-elle une étape et peut-être même un passage obligé dans le grand mouvement de l’histoire européenne vers plus de progrès ou le triste symbole de notre décadence morale et politique ? Ce n’est pas en effet par fatalisme que beaucoup d’entre nous acceptent aujourd’hui la réalité de ce déclin, comme quelque chose de regrettable, certes, mais d’inévitable. Les européens accompagnèrent ce processus avec un enthousiasme que méritait selon eux de susciter cet élargissement qui leur semblait évident et bienvenu de notre horizon politique. Pour qui adopte ce dernier point de vue, l’obsession d’Aron paraît facilement être celle d’un homme inapte à se détacher d’un monde, le sien, commençant de disparaître, et encore incapable, par manque de preuves ou par excès de préjugés, d’apprécier à leur juste valeur les mérites de celui qui était alors encore en train de naître. Aron doutait de ses promesses tandis que nous vivons sa réalité. Son obsession, compréhensible alors, pour qui veut être charitable, n’aurait aujourd’hui tout simplement plus lieu d’être. Cette ligne d’argumentation, qu’on voit aussi à l’œuvre dans une certaine lecture de la réaction d’Aron aux événements de mai 68, voudrait faire de lui un penseur, certes respectable, mais finalement dépassé par les événements, et enfermé dans des conceptions que périmèrent la fin de la lutte contre le nazisme puis celle de la Guerre Froide. L’attachement d’Aron à la nation n’a pourtant rien de sentimental. Pour comprendre la question qui donne son titre à ce texte il nous faut donc, pour un temps du moins, lutter contre l’empire de l’opinion reçue et tâcher de saisir ce qu’Aron craignit de nous voir perdre en perdant la nation.
Nation et régime représentatif
L’attachement d’Aron à la nation n’est pas, comme nous le disions, de nature sentimentale — il n’est pas non plus essentiellement esthétique. S’il faut craindre le déclin des nations c’est précisément pour lui parce que l’existence de cette forme moderne de l’amitié civique fut indissociable de l’émergence des régimes libres et demeure indispensable à leur maintien. Ce qui semble être en jeu dans la nation pour Aron, c’est moins une particularité de style, une culture ou un folklore, qu’une certaine qualité de l’agir et du langage humain, qui par les rapports qu’elle établit entre certains hommes permet à ces derniers de se gouverner eux-mêmes. Constatable par la raison naturelle, elle est non seulement un élément essentiel à la compréhension de notre régime mais également une réalité politique sans laquelle le fonctionnement de nos institutions serait en réalité menacé :
« Les régimes démocratiques n’ont pas pour fonction de créer les États ou l’unité des nations ; ce qui est possible, c’est que l’unité des États et des nations résiste à la compétition permanente des hommes et des idées. On n’a jamais créé une nation en disant aux hommes : allez et disputez-vous. Parfois, l’Occident semble conseiller aux pays libérés de faire sortir le pouvoir de leurs divisions. » (2).
Une science politique qui choisit d’ignorer cette réalité aggrave ainsi les difficultés qu’elle prétend résoudre. En se contentant de penser l’État comme l’institutionnalisation des divergences d’intérêts et d’opinions présents dans la société, elle accentue les conflits qui en découlent, mais empêche aussi ladite société de se constituer en pouvoir, en une capacité d’agir collective. Il dit ailleurs :
« Pour dire les choses autrement, un système de compétition pacifique suppose l’existence de l’État, l’existence d’une nation. Un des signes les plus étonnants aujourd’hui de l’inculture politique est l’idée, extrêmement répandue que, quand il n’existe pas encore d’État, on peut le créer et qu’on peut le créer par des procédés démocratiques. » (3).
En effet, nous tendons promptement à attribuer beaucoup des mérites de notre mode de gouvernement au pluralisme des sociétés libérales, et c’est en son nom que l’on se réjouit du dépassement de la nation et, à travers elle, de l’intolérance et de l’exclusion dont elle serait la source. Or, pour Aron, le pluralisme libéral ne saurait produire les effets bénéfiques que l’on attend de lui, la compétition pacifique, à moins d’agir sur une communauté d’hommes qui ne veulent pas être séparés et pour lesquels existent des principes de commandement légitimes. C’est parce que ces hommes veulent vivre et partager un même commun que leurs désaccords suscitent en eux, non pas le désir de se séparer, de se soumettre ou de se détruire les uns les autres, mais celui de se convaincre en vue d’agir ensemble, c’est-à-dire de donner à l’autre des raisons susceptibles de gagner son approbation, son concours et même sa libre obéissance.
Sans présupposer cette force contraire qu’est l’amitié civique, et l’existence d’une hiérarchie d’agents et de fins, les mêmes différences d’opinions et d’intérêts que nous avons coutume de célébrer engendraient au contraire une défiance et une hostilité qui rendraient impossible le fonctionnement de notre régime. La « disparition légale des rangs et des conditions » à laquelle Aron associe l’émergence de la démocratie libérale ne signifie donc pas pour lui l’abandon de tout principe hiérarchique ou de toute notion de bien commun. Elle permet au contraire de dissocier dans une certaine mesure la minorité qui dans tout régime concentre les fonctions de commandement de celle qui dans toutes société concentre les ressources et les moyens d’influence. Cette classe politique et dirigeante peut se libérer de l’étreinte des « socialement puissants » et asseoir son autorité parce qu’elle se soumet à la nécessité livrer publiquement des raisons d’agir en commun et ne le peut humainement et sans trop de risque que parce qu’existe cette amitié entre celui qui commande et celui qui obéit, unité supérieure sans laquelle la division des élites risquerait d’entraîner l’exploitation ou la guerre civile.
Le libéralisme et ses ennemis
Aron rejette donc l’idée qu’il suffise que l’homme soit libre et sans attaches, les institutions neutres et la société diverse pour que l’existence du régime libéral soit garantie. Ceci ne fut pas, comme on le dit parfois, une inflexion tardive, républicaine ou pessimiste, dans la pensée d’Aron. Dès 1939, dans un discours prononcé à l’aube de la guerre devant la Société Française de philosophie, il déclare en effet :
« L’optimisme politique et historique du XIXe siècle est mort dans tous les pays. Il n’est pas question aujourd’hui de sauver les illusions bourgeoises, humanitaires ou pacifistes. Les excès de l’irrationalisme ne disqualifient pas, bien au contraire, l’effort nécessaire pour remettre en question le progressisme, le moralisme abstrait ou les idées de 1789. Le conservatisme démocratique, comme le rationalisme, n’est susceptible de se sauver qu’en se renouvelant » (4).
Loin de fournir une justification à la philosophie du progrès, les excès du pessimisme anthropologique et de sa concrétisation politique dans l’Allemagne hitlérienne confirmèrent dès les années 30 pour Aron la nécessité d’en penser la critique, non pas certes afin de remettre en question le régime libéral qui s’en réclamait mais au contraire en vue de le renouveler.
Ce qu’Aron réalise lors de son séjour en Allemagne et à l’approche de la guerre, c’est qu’il est vain de penser notre régime à partir d’une conception vide ou négative de la liberté qui évacue la perspective de l’agent lui-même. Penser la politique à partir de cette idée de liberté c’est en effet abandonner tout possibilité pour les motifs que poursuivent les hommes quand ils agissent de constituer le fondement d’un commandement — c’est-à-dire d’une obligation ou d’un devoir (si le motif est bon, il doit valoir pour les autres) et d’une autorité chargée d’en demander et d’en obtenir le respect et l’accomplissement (il me revient ou à quelqu’un d’autre de m’assurer qu’on le poursuive). Dans le cadre de cette philosophie du progrès la justification des contraintes devient alors purement extérieure. Il ne s’agit plus de rapports concrets, du commandement de certains hommes sur certains autres et des raisons qu’ils partagent ou ne partagent pas, mais d’institutions dont la structure et l’étendue se fondent désormais, non pas sur les questions que je me pose quand j’agis (puisqu’aucun de mes motifs ne m’autorise à l’imposer aux autres hommes), mais sur le comportement des hommes en général, sur la façon dont ils usent de leur liberté. L’anthropologie, la question de savoir si l’homme en général est bon ou mauvais, détermine dorénavant la nature du régime souhaitable (libéral et paisible dans le premier cas, autoritaire et violent dans le second). Les tenants de la première hypothèse, parce qu’ils la pensent naïvement portée par le courant de l’histoire, rendent les choix pratiques et moraux indifférents : les hommes en apprenant à user de leur liberté sans empiéter sur celle des autres peuvent vivre en paix. Ceux de la seconde, parce qu’ils ne voient qu’une histoire pleine de bruit et de fureur abolissent la possibilité de tout jugement pratique ou moral au profit d’une métaphysique irrationaliste de la volonté qui justifie selon eux l’assujétissement d’un homme naturellement mauvais, ou dangereux, c’est-à-dire sans loi, à un pouvoir sans limite. Or Aron, le perçoit bien, les partisans de l’optimisme anthropologique sont incapables de comprendre la guerre qui vient et de justifier les sacrifices que rendra bientôt nécessaire l’hostilité des nihilistes qui rejettent et condamnent l’idéal de civilisation.
Nation, devoirs et rationalisme politique
Et c’est dans l’idée de nation qu’il trouve la possibilité d’une réaffirmation de la primauté des devoirs qui ne soit pas incompatible mais au contraire favorable à l’existence d’un régime libre (5). Dans ce régime, fondé sur la primauté des droits, le type d’amitié qui lie les membres d’une même nation devient le véhicule indispensable et effectif de nos obligations et de notre rationalité pratique. Indispensable parce que, sans cette force, le régime des droits se dissout sous l’effet de ses propres forces centrifuges, et effective, car c’est du fait du bien que constitue cette amitié que notre société, par le seul spectacle de son fonctionnement, suscite en nous le désir d’y participer, non du fait des intérêts dont la protection l’exige, bien que ces raisons existent, mais parce que la participation à la vie nationale en elle-même nous apparaît comme un bien d’un type particulier dont nous souhaitons jouir et dont nous ne pouvons jouir que par cette existence commune. C’est, non en vue de droits abstraits, mais de ce bien dont la conservation et la poursuite définissent pour les membres d’une nation une vie digne d’être vécue, que l’on peut rendre compte de leur détermination à la sacrifier plutôt que d’en être privés. Et c’est en l’absence de ce bien que nos passions, réduites à celles qui occupent nos vies d’individus, cessent de fournir son ressort à la résistance que toute collectivité oppose à ceux qui cherchent à la soumettre :
« La morale du citoyen, c’est de mettre au-dessus de tout la survie, la sécurité de la collectivité. Mais si la morale des Occidentaux est maintenant la morale du plaisir, du bonheur des individus et non pas la vertu du citoyen, alors la survie est en question. S’il ne reste plus rien du devoir du citoyen, si les Européens n’ont plus le sentiment qu’il faut être capable de se battre pour conserver ces chances de plaisir et de bonheur, alors en effet nous sommes à la fois brillants et décadents » (6).
En admettant ceci, nous aurions à la rigueur établi que le déclin des nations équivaut à toutes fins utiles à un changement de la nature de notre régime, mais nous n’aurions pas exclu la possibilité que ce changement convienne à l’air du temps. La pacification des relations entre États ne rendrait-elle pas superflus, avec la menace de la domination, le souci de l’indépendance et la nécessité de se battre pour la conserver ? Ce changement de la nature de notre régime ne serait-il pas aussi rendu nécessaire en vertu d’une contradiction interne à la démocratie libérale qui tendrait à la faire sortir de la forme politique qui l’a vue naître ? C’est ce que semble penser celui que l’Europe nouvelle est le plus près de s’être donnée pour penseur. Loin de nier les liens qu’établit Aron entre la nation et la préservation d’un commandement politique moralement exigeant, Jürgen Habermas souscrit à cette connexion pour immédiatement la condamner :
« Il existe une discordance remarquable entre les traits quelque peu archaïques des “obligations potentielles”, assumées par ceux qui partagent un destin commun et sont prêts à faire des sacrifices les uns pour les autres, et la conception normative qu’ont d’eux-mêmes les sujets de droit librement associés dans l’État constitutionnel moderne. […] Or, une telle image s’accorde mal avec la culture des Lumières, dont le cœur normatif consiste à abolir toute morale en vertu de laquelle un quelconque sacrifice serait publiquement exigé. […] À la différence de ce qui prévaut en morale, en droit positif les obligations sont secondaires. […] Sous de telles prémisses, il est de toute façon impossible de justifier le service militaire obligatoire ou la peine de mort » (7).
On le voit ici, c’est bien le sentiment d’obligation, que le désir d’unité de ses membres rend la nation capable de produire chez ces derniers, que l’on vise à épuiser au travers du dépassement de cette dernière, et ceci, non en vue de quelque dessein volontairement pernicieux, mais afin de réaliser pleinement la possibilité, contenue dans les droits de l’homme, d’une existence individuelle parfaitement autonome. La tentative de dépasser la nation en Europe ne fut donc pas seulement une conséquence malheureuse et inattendue de la politique des droits de l’homme, mais envisagée consciemment comme une condition de sa réalisation pratique. Cette tentative ne pouvait néanmoins réussir que si ce dépassement aboutissait à une progressive pacification des relations entre États aboutissant à une forme plus ou moins achevée de société globale où, la menace de la domination ayant laissé place à la coopération pacifique, disparaissait avec elle le souci de l’indépendance.
Comme les plus myopes esprits le constatent aujourd’hui, la régulation des relations entre États a peut-être diminué certaines incertitudes, surtout économiques, mais elle n’a pas fondamentalement changé la nature des menaces et des risques politiques propres à l’ordre international. L’entêtement avec lequel les Européens entretiennent leur ignorance collective de cette réalité ne saurait s’expliquer que par notre désir de réaliser le projet dont elle excluait pourtant la possibilité. Aron touche néanmoins aux raisons qui donnèrent à cet espoir un ascendant pour ainsi dire irrépressible sur notre vie morale et politique.
Épuisées et dégoutées d’elles-mêmes par deux guerres mondiales, les nations d’Europe entrèrent dans la Guerre Froide avec le sentiment aigu et nouveau de leur faiblesse. Ce continent qui, réalisant la prédiction de Kant, avait jusqu’alors donné ses lois au monde se retrouvait soudain composé d’États-nations, dépouillés de leur empire, et incapables de concurrencer les deux Grands. Le rêve d’un monde sans guerre et d’une vie sans obligation s’empara des nations d’Europe parce qu’il adoucissait et répondait exactement à la perspective de leur impuissance.
Mais si le déclin matériel des « nations de petits espaces » est indéniable, rien n’indique selon Aron que leur décadence politique et morale s’ensuive mécaniquement de cette première constatation. En premier lieu parce que la supériorité de ce qu’il appelle les « peuples de grands espaces » (il dénombre à cette époque États-Unis, Union Soviétique, Chine et Inde) est inégale, faillible et contestable. Et les 60 années qui suivirent la rédaction de Paix et guerre ne confirment-elles pas que ces grands États perdirent souvent leurs moyens, aussi supérieurs fussent-ils, contre des adversaires incomparablement plus faibles ? Parce que l’histoire ne suit pas des lois mécaniques qui les condamnerait à l’avance et pour le simple fait que le dépassement des nations fut en Europe le produit d’une décision consciente, et non d’une fatalité imposée de l’extérieur, il ne saurait nous apparaître comme inévitable.
En fournissant son ressort passionnel à l’échange public des raisons, la nation et l’amitié politique qu’elle rend possible entre les hommes, sont ce qui transfigure la compétition permanente des hommes et des idées, le désir de commandement et les désaccords sur le juste et l’injuste, de cause de violence en source de vie civique, de guerre des dieux en espoir de réconciliation et d’unité. Parce qu’elles mobilisent le désir qu’ont naturellement les hommes de vivre en commun, les nations permettent à leurs membres de délibérer à propos de plus de choses concernant lesquelles ils sont en désaccords, plus de choses dont ils ont besoin de se convaincre les uns les autres et, pour cela, de fournir leurs raisons. Elles élargissent plus qu’elles ne rétrécissent l’horizon politique des buts que nous pouvons collectivement poursuivre. En cela, elles sont une source de force et d’action en dépit même d’une faiblesse matérielle dont Aron nous rappelle que nous aurions tort de nous désespérer. Le monde qui s’annonce a de toute façon peu de chance de nous laisser le luxe de nous en priver, fût-ce pour cultiver notre jardin.
Pour lire notre recueil en intégralité, cliquer ICI
Dans un entretien pour notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Bernard Cazeneuve salue le goût de l’intellectuel pour la recherche de la vérité. L’ancien Premier ministre met notamment en lumière la rupture de Raymond Aron avec la gauche française en choisissant de dénoncer les crimes staliniens et les dérives totalitaires du communisme soviétique.
En acceptant d’écrire un article sur les relations de Raymond Aron à la gauche française, à l’invitation du think tank GenerationLibre, je savais qu’il me faudrait penser aux tragédies du siècle passé et les confronter aux idéologies qui les avaient engendrées. De la pensée de l’auteur de L’Opium des Intellectuels, j’avais surtout retenu sa filiation, qui de Montesquieu à Tocqueville, en passant par Benjamin Constant, situait Raymond Aron dans la mouvance libérale. Parmi ceux qui vénéraient Sartre et se méfiaient de Camus – dont l’esprit de nuance le rendait suspect aux yeux de certains –rares étaient ceux qui admiraient Raymond Aron. Pourtant, par sa pensée, il dominait déjà de la tête et des épaules les débats de son temps. Comme François Mauriac, il s’évertuait à plonger une torche dans les ténèbres d’une période encore fracturée par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale et la division du monde en deux blocs antagonistes. La publication de ses Mémoires et du Spectateur engagé, au début des années quatre-vingt, avait été pour ma génération la révélation d’une implacable exigence intellectuelle. À l’opposé de certains de ses congénères, ses analyses et ses choix l’avaient préservé des aveuglements d’une époque dominée par les idéologies. Dans les émissions audiovisuelles, où on l’interrogeait sur ses positions politiques ou sur les controverses qui l’avaient opposé aux intellectuels dominants, il racontait le processus d’excommunication dont il avait été l’objet face à ceux, qui trop longtemps, avaient exonéré le stalinisme de ses crimes et avec lesquels il avait fini par rompre.
Dans sa jeunesse studieuse à l’École normale supérieure, où de Sartre à Canguilhem, en passant par Nizan, il avait côtoyé les plus brillants esprits, Aron avait été socialiste. Mais de la montée du nazisme, observée lors de son séjour en Allemagne, entre 1930 et 1933, il avait surtout retenu la dimension possiblement tragique de l’Histoire, lorsque les passions humaines s’emparent d’elle et que la raison s’en éloigne. Loin de se détourner de la politique, il avait conçu pour le débat d’idées un intérêt qui devait le mobiliser sa vie durant. Peu à peu, on l’avait vu prendre ses distances avec le positivisme, l’idéalisme et le pacifisme de sa jeunesse, dont les conversations avec Alain l’avaient, un temps, convaincu de la pertinence. À la faveur d’une promenade sur les berges du Rhin, alors que la République de Weimar agonisait, il avait pris pour lui-même l’engagement « de connaître son époque aussi honnêtement que possible, sans jamais perdre conscience des limites de son savoir ». Sans céder aux facilités de la posture du spectateur, il cherchait à débusquer, en toutes circonstances, les solutions les plus praticables et jamais il ne réagissait aux choix de ceux dont il observait les agissements, sans se poser la question de ce qu’il aurait pu faire lui-même. Plus tard, interrogé sur les raisons profondes de sa prise de distance avec la gauche, il avait répondu que les intellectuels qui avaient refusé la rupture fondamentale avec le soviétisme, le communisme et le stalinisme – autrement dit avec l’autre grand totalitarisme du siècle – s’étaient éloignés des idéaux initiaux, auxquels lui, avait continué de croire. Il avait par ailleurs puisé aux sources de l’économie politique nombre d’interrogations qui le faisaient douter de la pertinence de choix qu’il jugeait peu judicieux, moins pour des raisons morales, qu’en vertu de la conception qu’il pouvait avoir de l’efficacité des politiques à mettre en œuvre.
« Amoureux de la liberté pour les autres, il la pratiquait surtout pour lui-même, en la conjuguant au courage. »
Raymond Aron était donc avant tout un anticonformiste, dont il était difficile de figer la pensée, et hasardeux de chercher à se ménager les faveurs, car tout ce qu’il exprimait, était dicté par une rigueur intellectuelle qui le singularisait. Aucun gouvernant n’était d’ailleurs parvenu à le circonvenir, pas même le général de Gaulle, auprès duquel il s’était tenu à Londres, mais dont il critiquait la politique ombrageuse d’indépendance à l’égard des États-Unis, au motif qu’elle prenait insuffisamment en compte les menaces pesant sur le monde libre. Dans un contexte où dominait la guerre froide et où l’Union soviétique imposait au continent européen un ordre totalitaire, la priorité devait aller, selon lui, à la défense absolue de la liberté et à la dénonciation d’un système qui la rendait impossible. Par la conviction que chacun devait en toute circonstance préserver son libre arbitre, il invitait au courage, sans jamais chercher à acquérir ce statut de « professeur d’hygiène intellectuelle », auquel Claude Lévi-Strauss l’avait pourtant élevé. Sa dénonciation inlassable des crimes du stalinisme, l’avait très vite opposé à Sartre et aux intellectuels qui évoluaient dans son sillage, sans que l’antitotalitarisme parvienne alors à conquérir la gauche. Il lui faudra attendre 1974 et la publication de L’Archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne, pour sortir enfin de cet isolement qui l’avait fait tant souffrir, sans que jamais toutefois, il n’exprimât le regret de ses choix.
Au moment où Raymond Aron exerçait son magistère intellectuel et moral, on jugeait sa parole, non en fonction de ce qu’il disait, mais en raison des lieux à partir desquels il s’exprimait. Le sectarisme se nourrissait déjà de ces facilités. Plus généralement, comme il avait eu le courage, par des positions tranchées, de se distinguer de la cohorte de ceux qui s’inscrivaient dans le courant de l’idéologie dominante, il arrivait qu’il dût subir la vindicte des meutes constituées ou de leur relais dans les milieux médiatiques et universitaires. Or, la lecture de l’œuvre de Raymond Aron constituait un éloge éloquent de l’esprit de nuance, si bien que ses congénères, engagés jusqu’à l’aveuglement dans la défense du communisme et de ses régimes totalitaires, s’affrontaient à lui sans le ménager.
Sans doute Aron était-il avant tout un enfant du siècle des Lumières. La rationalité de ses démonstrations, qu’il s’intéressât à la politique ou à la sociologie, qu’il analysât la pensée de Marx, ou plus tard celle d’Émile Durkheim ou de Max Weber, puisait aux sources des philosophes qui avaient pensé les droits fondamentaux de la personne humaine et consacré l’amour irrépressible de la liberté. Face à l’absolutisme et à ses dérives, il campait du côté de la raison. Son attachement profond à l’universalisme des droits, que les penseurs marxistes considéraient comme formels, ne l’avait pas pour autant dissuadé de considérer positivement l’apport de la pensée de Karl Marx à la compréhension de l’ordre social et des rapports de domination, qui pouvaient rendre impossible la mise en œuvre effective de la liberté et de l’égalité. L’avènement du totalitarisme avait cependant contribué à conforter Aron dans l’idée que Montesquieu avait raison, lorsqu’il préconisait qu’en toute circonstance et par la disposition des choses, le pouvoir devait arrêter le pouvoir, et qu’en l’absence de séparation des pouvoirs, les libertés fondamentales ne pouvaient en aucun cas être garanties. Dans une conférence prononcée en 1969, à l’occasion des Rencontres internationales de Genève, et dont la revue La Liberté et l’ordre social a reproduit le contenu, Raymond Aron précisait sa pensée en ces termes : « les droits civiques, enjeu d’une bataille intellectuellement mais non socialement gagnée, découlent de la liberté des Révolutionnaires du XVIIIe siècle, de la philosophie des Lumières. Ils enlèvent des libertés particulières, des privilèges à certains, pour garantir à tous les libertés qu’exige l’égalité devant la loi. Du même coup, nous découvrons à quel point les libertés dites formelles sont réelles, en ce sens qu’elles assurent à tous des garanties et des possibilités effectives. Montesquieu voyait dans la sûreté la forme première et pour ainsi dire minimale de la liberté. Or, la sûreté de l’individu exige que la liberté à la fois des personnes privées et des personnes publiques soit limitée par des règles… ». En s’inscrivant ainsi dans la filiation des philosophes des Lumières, dont la pensée avait fécondé l’universalisme des révolutionnaires français, Raymond Aron marquait son attachement à une histoire, hautement revendiquée par une partie de la gauche française, au moment de l’instauration sous la IIIe République, des libertés fondamentales.
À l’occasion de la même conférence, l’intellectuel libéral s’employait à tracer les limites des libertés dites formelles, pour épouser l’analyse critique que le courant socialiste avait pu en faire, en s’inspirant de certains des aspects de la pensée marxiste : « il ne suffit pas pour que le citoyen soit effectivement libre de faire quelque chose, que la loi interdise aux autres et à l’État de la lui interdire, sous menace de sanction, il faut encore qu’il en possède les moyens matériels ». Dans l’esprit de Raymond Aron la liberté, garantie par la loi, pouvait exiger, dans certaines circonstances, l’intervention de l’État, pour que la plupart des individus soient en situation de l’exercer vraiment. On passait ainsi imperceptiblement de la liberté négative (non-empêchement sous la menace de sanctions) à la liberté positive, se traduisant par la capacité de faire. Rien ne s’opposait donc, a priori, pour les tenants de la démocratie libérale, à ce que les individus soient dotés des moyens effectifs d’exercice de leurs libertés formelles, au terme de la reconnaissance par l’État de leurs droits économiques et sociaux. Sans doute fallait-il voir dans ce cheminement intellectuel de Raymond Aron, les raisons profondes de son adhésion de jeunesse à la pensée socialiste et l’explication du jugement positivement critique qu’il porta sur l’expérience du Front populaire.
« Sans doute Aron était-il avant tout un enfant du siècle des Lumières. »
En revanche, c’est bien l’expérience communiste, conduite notamment en Union soviétique, qui fut à l’origine de la rupture de Raymond Aron avec une partie de la gauche, c’est-à-dire l’avènement d’un État partisan, adossé à un parti unique, se fondant sur une vérité d’État. Face à cette idéologie, Raymond Aron porta plus loin le fer, avec cette clarté tranchante qui le singularisait de ceux qui refusaient de qualifier ces régimes incontestablement totalitaires pour ce qu’ils étaient : « aucun n’aurait imaginé que le socialisme se confondrait un jour, dans la théorie officiellement proclamée, avec le rôle dominant du parti, autrement dit avec l’interdiction du droit d’opposition et d’association publique. » écrivait-il.
Ainsi, l’histoire du XXe siècle avait démontré que la disparition du multipartisme et des assemblées parlementaires démocratiquement élues rendait possible le totalitarisme, sous ses multiples formes. Mais elle administrait également la preuve que la démocratie représentative, sans garantir toutes les libertés individuelles, constituait le plus solide moyen de leur préservation.
Il aura fallu le courage d’Alexandre Soljenitsyne, la mobilisation de certains intellectuels français et l’exode des boat people, au milieu des années soixante-dix, pour que Raymond Aron sorte peu à peu de son isolement et serre à nouveau la main de Jean-Paul Sartre, en juin 1979, après qu’ils eurent demandé ensemble, au président Valéry Giscard d’Estaing, d’ouvrir la possibilité de l’asile à des centaines de milliers de Vietnamiens et de Cambodgiens, fuyant le communisme. Avec l’humilité qui avait si souvent présidé à ses engagements, Raymond Aron n’entendait pas savourer sa revanche. Son tempérament et la tragédie vécue par des êtres perdus lui interdisaient d’y songer. Quant à son vieil ami Poulou (Jean-Paul Sartre) pour lequel il avait gardé estime et admiration, il expliquait sa démarche en ne reniant rien de ses combats passés, tout en donnant le sentiment de céder à une obligation morale : « Personnellement, j’ai pris parti pour des hommes qui n’étaient sans doute pas mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté. Mais ça n’a pas d’importance, parce que ce qui compte ici, c’est que ce sont des hommes, des hommes en danger de mort… ».
« Raymond Aron était avant tout un anticonformiste, dont il était difficile de figer la pensée, et hasardeux de chercher à se ménager les faveurs. »
Il y eut donc chez Aron – comme une irrépressible exigence – la recherche permanente de la vérité. Il en paya le prix, sans ne jamais rien abandonner de ce qui lui paraissait essentiel. Le travail inlassable auquel il s’était consacré, au sortir de l’École normale supérieure, en portant sur la politique le regard du spectateur engagé, avait endurci ses convictions, sans le rendre sectaire. Alors que ses détracteurs le présentaient volontiers comme le penseur conservateur, parfois incapable de pénétrer les grands mouvements de son temps, il se trompa infiniment moins que ceux qui, à droite ou à gauche, prétendaient tout comprendre de leur époque, en s’érigeant en détenteurs de la vérité. Contre la colonisation, il prit des positions courageuses qui le firent menacer par l’extrême droite. Face à l’université, dont il percevait l’urgence de la réformer, il se montra visionnaire, sans pour autant cautionner les évènements de mai 1968, dont il ne comprit pas spontanément le sens profond. Devant le général de Gaulle, dont il soutint la plupart des choix, il garda son indépendance d’esprit en suscitant parfois jusqu’à l’exaspération du héros de la France libre. Amoureux de la liberté pour les autres, il la pratiquait surtout pour lui-même, en la conjuguant au courage. Ses relations à une gauche française, alors pétrie de certitudes, ne pouvaient qu’en être affectées, comme cela est souvent le cas des compagnons de route rigoureux et déçus, qui préfèrent la solitude au risque de devoir renoncer à eux-mêmes.
Pour lire notre recueil en intégralité, cliquer ICI
Dans un entretien pour notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), David Lisnard considère l’intellectuel comme le représentant d’une droite humaniste et responsable. A la lumière de sa pensée, il appelle à mettre en oeuvre une subsidiarité ascendente et horizontale, à débureaucratiser et à penser l’intelligence artificielle et l’environnement selon une approche libérale.
Raymond Aron n’aimait pas les facilités. Il parvenait à pourfendre le conformisme, qui alimente le « révolutionarisme », et tout autant la démagogie. En cela, il œuvrait comme nul autre pour la démocratie, forcément exigeante. Car la liberté est un combat. Rendre hommage à Raymond Aron, en évoquant les grandes lignes d’une œuvre de vie si profuse, est une entreprise de justice, salutaire, à l’endroit de l’un des plus grands penseurs français du siècle dernier qui, longtemps, trop longtemps, souffrit d’une mise à l’index causée par l’idéologie marxiste alors dominante dans les milieux universitaires et intellectuels. De tous ceux de la « génération de 1905 », étudiée par l’historien Jean-François Sirinelli, Raymond Aron est assurément un spécimen bien à part. « Bon élève type », comme il se décrit lui-même, il fut major à l’agrégation de philosophie à seulement vingt-trois ans tandis que son condisciple normalien, Jean-Paul Sartre, y échouait avant de l’obtenir, lui aussi en première place, l’année suivante. Je n’entends pas faire de la rivalité Aron-Sartre le cœur de mon propos, mais il convient, malgré tout, de rappeler le magistère intellectuel tout-puissant exercé par le second à une époque où les idées du premier, imprégnées de liberté, d’ordre et de responsabilité, étaient reléguées en dernière zone.
Tandis que Sartre se complaisait, les années passant, dans une rancœur et un sectarisme dangereux pour tous ceux qui pensaient différemment, Aron prenait sa part dans le cortège des idées, écrivait, s’interrogeait sur la marche du monde et en fournissait, toujours avec modestie, quelques clés de lecture, quitte, s’il le fallait, à se remettre en cause. N’oublions pas que l’époux de Simone de Beauvoir, dont le positionnement politique a insidieusement varié au gré des évènements et de son opportunisme patenté, s’est toutefois montré constant dans sa défense aveugle du communisme et des régimes totalitaires qui en découlaient, à tel point qu’il déclara, pétri de tolérance, que « tout anticommuniste est un chien ».
Raymond Aron, qui ne pouvait que se sentir visé par une assertion d’une telle violence, demeura pourtant, et jusqu’à son dernier souffle, d’une inaltérable élégance envers son camarade d’antan. Préférant le débat et la confrontation des points de vue aux incantations moralisatrices, l’auteur de L’Opium des intellectuels, qui poussait un peu plus loin le constat de la « trahison des clercs » (Julien Benda) et de la « littérature à l’estomac » (Julien Gracq), se caractérisa, en toutes circonstances, par son respect de la différence, soulignant que l’intellectuel doit s’efforcer de « n’oublier jamais ni les arguments de ses adversaires, ni l’incertitude de l’avenir, ni les torts de ses amis, ni la fraternité secrète des combattants ». La messe est dite. De ce filon dénué de la moindre ambigüité, Aron fit son sextant par vent calme comme tempétueux, son impératif catégorique et n’en dévia pas de toute son existence.
« Raymond Aron fut l’incarnation d’une droite humaniste, raisonnée, responsable et donc respectable. »
Partant, j’aimerais, aujourd’hui, renverser le paradigme qui a trop longtemps prévalu dans les esprits d’une intelligentsia omnipotente. De l’après-guerre au début des années 1980, on scandait, ici et là, avec une fierté déconcertante, qu’il valait « mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ». Par cette formule qu’aucun individu sensé ne doit pouvoir légitimer (et pourtant…), Raymond Aron a bel et bien été mis au ban de tout un pan de la société, qui avait choisi son camp, résolument opposé au sien, celui de la Raison. A défaut de chercher à avoir raison avec Aron – car ce ne me semble pas le défi à relever –, tâchons en tout cas de tirer le meilleur de son legs et ainsi dire combien son apport mérite non seulement sa place dans le monde contemporain, mais doit être connu et enseigné à une génération qui en ignore le principal, à l’exception bien sûr des quelques spécialistes avertis. Vilipendé naguère par une bonne partie de la gauche française (à l’instar d’un Raymond Boudon ignoré ou dénigré en France pour lui préférer, dans le monde des sciences humaines, Pierre Bourdieu et son habitus néo-marxiste), Raymond Aron ne sut jamais vraiment, en ce qui le concerne, où fut sa propre droite. Ou plutôt, il s’offrait la liberté, égale à aucune autre, de ne pas se laisser enfermer par quelque catéchisme que ce soit.
Admiratif du Général de Gaulle (qu’il cite à maintes reprises dans ses passionnants Mémoires, un modèle du genre), il soutint sans réserve le chef de la France Libre (« je crois que le plus grand événement d’art oratoire radiophonique de notre époque, ce sont les discours du Général De Gaulle »), l’homme de la Constitution de 1958 ou encore celui qui réforma l’économie française à la suite d’une IVe République essoufflée. Mais loin de se muer en panégyriste inconditionnel, tel un François Mauriac dans ces mêmes années, Raymond Aron n’hésita pas à marquer fermement ses divergences de vue. Ce fut le cas, en l’espèce, sur les relations franco-américaines, le philosophe reprochant à l’homme de Colombey son antiaméricanisme, comme sur la question d’Israël, sans doute plus déchirante pour le « spectateur engagé », qui ne cautionnait pas les déclarations du Président de la République lors de sa conférence de presse en novembre 1967.
« Se remémorer Aron, […] c’est prendre le parti de l’élégance face à l’intolérance et au dogmatisme. »
Raymond Aron, c’était cela partout, tout le temps, quelles que soient les circonstances : rien, hormis sa propre exigence d’une pensée respectueuse des faits et de la rigueur argumentaire, ne pouvait altérer sa liberté d’agir, de s’exprimer, d’être tout simplement, quitte à casser quelques idées reçues sur sa prétendue inféodation à une personne ou à un système de pensée. Il est peu connu du grand public, par exemple, qu’il s’est attaqué en bonne et due forme à « l’achèvement de la puissance bureaucratique » dans notre pays, dénonçant « l’extension de cette rationalisation autoritaire à l’homme lui-même, à des activités humaines qui semblaient, par essence, comporter la liberté, la spontanéité ». En économie, il usait de la même liberté d’approche et de ton pour éviter tout enfermement idéologique. Ainsi, reprochant sa vision dogmatique à Friedrich Hayek, Aron prône la confiance en la démocratie comme finalité du libéralisme, et affirme que « l’authentique morale des démocraties est une morale de l’héroïsme, non de la jouissance ». Il précise, dans Le grand schisme, sa position : « Mais, en Europe occidentale, la planification intégrale est inconcevable, sinon comme un sous-produit de l’invasion soviétique, et un libéralisme intégral exclu, aussi bien par les circonstances économiques que par la psychologie des hommes. La tâche est de rendre viable le régime mixte qui, jusqu’à présent, ne l’est pas ». Aussi, tout en plaidant pour la « sauvegarde des valeurs essentielles de la démocratie politique », il défend la nécessité d’adopter « certaines méthodes de direction économique ». Plus surprenant, Raymond Aron ira même, au mitan des années 1950, jusqu’à reconnaître qu’il se sent proche de certaines idées de John Maynard Keynes, tout en sachant, en authentique libéral qu’il est, qu’elles sont difficilement compatibles, dans les faits, avec une politique économique qui laisse leur nécessaire latitude aux forces du marché. Inclassable, vous dis-je.
Dans son magnifique Essai sur les libertés, comme pour mieux affirmer encore son libéralisme, Aron s’inscrit clairement, et pour notre plus grand plaisir, dans la lignée de Montesquieu et Tocqueville, ce dernier ayant une place de tout premier choix dans sa matrice intellectuelle. Il y rappelle la distinction opérée par Marx (dont Aron connaissait bien l’œuvre) entre libertés formelles et libertés réelles, défendant le postulat que les secondes ne sont rien sans être subordonnées aux premières (et déplorant, chez Hayek, son « marxisme inversé »). C’est bien cela qui fonde le socle de toute démocratie libérale. Il ne faut jamais perdre de vue, lorsque l’on s’arrête sur le cheminement de Raymond Aron, qu’il a traversé un siècle mutilé par deux guerres mondiales, auxquelles a succédé une « guerre froide » établissant de nouveaux rapports de force géopolitiques, stratégiques, économiques et diplomatiques. Ce faisant, sa théorisation des relations internationales est intimement liée à son souci de comprendre l’action humaine et son incidence sur les décisions politiques comme sur la vie des citoyens. De son premier article, De l’objection de conscience (janvier 1934) où l’on sent l’influence d’Alain, à son magistral ouvrage Penser la guerre. Clausewitz (1976), Aron s’est affirmé par un réalisme singulier (se démarquant en cela de Morgenthau), où les considérations morales entrent en ligne de compte, qualifié par d’aucuns de néoclassique, et la devenue célèbre doctrine du soldat et du diplomate. Certes, la planète a considérablement évolué depuis, et les conclusions tirées du monde bipolaire d’alors n’ont plus lieu d’être. Quoique…Comment ne pas relire avec un intérêt lucide sur notre propre époque toutes les considérations de ce journaliste-philosophe (et inversement) sur les années 30 et le choc de l’Histoire qui en résulta. Au moment de la soutenance de sa thèse de philosophie, en 1938, dans laquelle il tranche avec le courant positiviste ambiant, Aron n’a en effet pas oublié son passage à Cologne puis à Berlin, de 1930 à 1933, lors duquel il assista à la montée du nazisme.
Il revint aussi particulièrement imprégné par deux figures intellectuelles allemandes que sont Heinrich Rickert et Max Weber. Le jeune philosophe devient dès lors penseur politique et vigie sur les affaires du monde. Toujours, il gardera cette curiosité insatiable et cette bonhomie qui le démarquaient sensiblement de nombre de ses contempteurs. En fait, témoigner, aujourd’hui, de notre gratitude intellectuelle et morale à Raymond Aron, c’est redire l’importance de ce qu’il a apporté au corpus du libéralisme, sans naïveté ni extrémisme. C’est souligner que, malgré l’ostracisme intellectuel dont il fut victime, il n’en demeura pas moins un remarquable éditorialiste, philosophe, mais aussi sociologue, économiste, historien, reconnu de par le monde, et qui rejoignit, comme une reconnaissance de son immense travail, le Collège de France en 1970 pour y professer au sein de la chaire de Sociologie de la civilisation moderne. Elève de Brunschvicg, ami de Canguilhem, il a inspiré tant d’intellectuels qui ont su assurer la digne relève de leur maître : Claude Lefort, François Furet, Pierre Hassner, Jean-Claude Casanova (avec qui il créa l’excellente revue Commentaire en 1978) ou encore Pierre Manent pour n’en citer que quelques-uns.
Se remémorer Aron, s’arrêter pour mieux s’approprier son cheminement idéologique, en de si multiples domaines, c’est choisir un antidote puissant face aux maux – du déconstructionnisme au wokisme qui menacent en maccarthysme inversé et tyrannique notre société, de l’aigreur ou de la peur qui mènent à tous les populismes, de la paresse et du cynisme qui alimentent toutes les démagogies – qui entendent déstabiliser notre monde, où le bavardage insipide remplace trop souvent l’effort de compréhension de l’autre et de l’ailleurs. C’est également prendre le parti de l’élégance face à l’intolérance et au dogmatisme.
« Raymond Aron ne sut jamais vraiment, en ce qui le concerne, où fut sa propre droite. Ou plutôt, il s’offrait la liberté, égale à aucune autre, de ne pas se laisser enfermer par quelque catéchisme que ce soit. »
C’est enfin se doter de quelques pistes pour penser le monde de demain, avec ses incertitudes et ses doutes. Aron en fut gorgé jusqu’au bout, et c’est en cela qu’il demeure une figure bien à part. Aux accents révolutionnaires, il préférait la réforme. A la bien-pensance et au conformisme, il préférait l’interrogation et la rigueur imaginative, le surmoi plutôt que le ça, le refoulement des bas instincts et des pulsions primitives qui n’amènent jamais rien d’heureux et surtout de constructif. Laissons vivre et prospérer les initiatives créatrices.
Sachons tirer de l’œuvre de Raymond Aron comme de sa sagesse un tout régénérateur mêlant conciliation, efficacité et liberté. Face aux nombreux défis du 21e siècle, que sont notamment l’intelligence artificielle et l’environnement, son libéralisme est la voie la plus pertinente, aussi bien en termes éthiques pour une certaine idée de l’homme, que d’efficacité. Le politique doit y puiser pour aérer la société française, instaurer partout une véritable subsidiarité, horizontale et ascendante, et recentrer l’action publique nationale sur sa raison d’être, c’est à dire la justice et tout ce que cela implique dans le régalien et le champ social. Que l’Etat cesse de se mêler de ce qui ne le regarde pas, de vouloir tout régenter, d’entraver a priori l’usage parce qu’il ne parvient pas à réprimer a posteriori l’abus. Etre fort avec les faibles et faible avec les forts ne peut mener qu’à la sédition.
L’infantilisation permanente couplée à la bureaucratisation galopante constitue un mélange destructeur. Sur l’incontournable question climatique, par exemple, une approche libérale consisterait à sanctionner les pollueurs et à promouvoir une économie écologique de marché, qui mobiliserait la dynamique entrepreneuriale et la force du capitalisme pour changer les modes de production de biens et de services, en contraste avec les mesures inefficaces et liberticides de la décroissance comme de l’écologie sur-administrée, dont le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE, après les ZFE et le ZAN…) est une des dernières expressions. Le moralisme écologique non seulement devient chaque jour plus pénalisant pour les habitants et nos entreprises, mais aussi s’avère sans efficacité sur ses finalités environnementales en comparaison de la puissance d’une politique de « décarbonation » de l’activité reposant sur le Droit international pour lutter contre les distorsions écologiques de concurrence, la science, l’innovation, l’investissement massif dans les solutions énergétiques et de tout ce qui peut préserver et dépolluer la planète. Sur tous les sujets, il s’agit de faire gagner la Raison critique et de régénérer l’esprit civique. Raymond Aron fut l’incarnation d’une droite humaniste, raisonnée, responsable et donc respectable. C’est cette droite qu’il faut rétablir. Dans l’intérêt de la démocratie et pour l’avenir de notre pays.
Pour lire notre recueil en intégralité, cliquer ICI
Dans la Revue de philosophie économique, Benoît Walraevens publie une belle recension de notre ouvrage « Esquisse d’un libéralisme soutenable » signé Claude Gamel, troisième ouvrage de la collection de notre think tank aux Puf sorti en 2021.
À l’aune des travaux d’Hayek et de Rawls, Claude Gamel nous livre dans cet ouvrage une utopie libérale à la française adaptée à nos enjeux socio-économiques, ainsi que des propositions de politique publique ambitieuses et efficaces. Loin d’être une simple conception utopique non réalisable, il s’agit plutôt d’un « modèle de société alternatif et idéal » selon la définition de Benoît Walraevens.
« Le but avoué de Gamel est d’identifier les principes libéraux qui, « correctement appliqués », permettent « d’amplifier les avantages du capitalisme et de voir ses inconvénients au mieux neutralisés », afin d’imaginer et de dessiner un libéralisme socialement et écologiquement « soutenable ». »
Benoît Walraevens explique que dans son ouvrage, Claude Gamel juge l’approche libérale de Hayek trop rigoureuse et « peu désirable pour les individus », tandis que celle de Rawls lui apparaît « supportable » et permettant de « réconcilier libéralisme et égalitarisme ». Aux yeux de l’auteur de la recension, la vision de Rawls semble donc se rapprocher de la devise de la République française, ce que Claude Gamel tente aussi de faire en préservant la notion de justice dans sa proposition libérale. Pour ce faire, Claude Gamel nous partage sa vision d’un « libéralisme soutenable » et détaille dans cet ouvrage des propositions que GL défend ardemment : le revenu universel ainsi que la tarification carbone.
Pour commencer sa recension, Benoît Walraevens explique que Claude Gamel prône une démocratie de propriétaires qui vise à une « dispersion maximale du pouvoir économique » pour éviter les dérives oligarchiques. Ce dernier appelle à plus de fluidité dans le marché du travail, qu’il juge trop « rigide et protecteur ». C’est pourquoi il propose un ensemble de solutions nouvelles et radicales (se rapprochant des idées de Piketty) : suppression du CDI, mise en place d’un contrat de travail unique, partage du profit entre l’entreprise et ses salariés, forme de cogestion pour plus de représentativité des salariés…
« Toujours est-il que ce genre de mesures permet de dessiner le cadre institutionnel possible d’une démocratie de propriétaires et s’inscrit bien dans la lignée du libéralisme égalitaire, visant à atténuer certains effets délétères du libéralisme économique. »
Aussi, Benoît Walraevens revient sur le « financement alternatif de la protection sociale » que Claude Gamel défend, notamment par la suppression des cotisations sociales (financée par la seule CSG). Cette idée, portée de longue date par GL, implique la mise en place d’un revenu universel inconditionnel, qui inclurait les risques famille et pauvreté et s’inscrit dans sa théorie de justice sociale. Ce système « à l’anglaise » permettrait d’assurer à chacun un minimum essentiel et d’être libre de se protéger, ou non, face à certains risques sociaux.
« La mise en place de ce crédit d’impôt universel nécessite, en parallèle, une réforme profonde à la fois de la protection sociale et de la fiscalité, en commençant par la première. Ainsi, l’allocation universelle viendrait remplacer les divers minimas sociaux (…). »
Benoît Walraevens met ensuite en exergue les « politiques d’enrichissement des capacités » défendues par Claude Gamel, c’est-à-dire sa volonté de réformer des institutions et secteurs particuliers afin d’offrir plus de choix de vie individuels (formations, démocratisation qualitative de l’enseignement supérieur, accès à la culture, traitement de la pauvreté et du handicap…). Claude Gamel y cible trois axes : le développement de la capacité du jeune mineur, la capacité du jeune adulte et aussi la possibilité de changer de voie au cours de sa vie.
Dans la dernière partie du livre, Claude Gamel s’attarde sur la mise en place d’un revenu universel qu’il considère comme « l’instrument d’une liberté réelle ». Benoît Walraevens émet cependant certaines réserves quant à la forme et surtout au montant de ce revenu, qu’il juge relativement faible (500 euros par mois). Comme le préconisent notre fondateur Gaspard Koenig et notre expert Marc de Basquiat, ce « socle de protection sociale » serait financé par un impôt sur le revenu à taux unique de 25%. Claude Gamel reste pragmatique quant à la mise en place d’une telle réforme, qui doit être instaurée de manière progressive avec un réel consensus autour d’un nouveau contrat social.
« Gamel reconnaît que le montant de son revenu de base serait inférieur à celui des différents transferts sociaux ciblés auxquels il se substituerait, mais que cette perte économique serait compensée, « au moins en partie », par les « avantages en nature » que celui-ci génèrerait comme un pouvoir (de négociation) accru et une plus grande dignité. »
Dans la conclusion de cet ouvrage, Claude Gamel évalue la viabilité de son libéralisme soutenable à long terme. Une des problématiques soulevées étant celle de l’urgence climatique, Claude Gamel y répond par l’éventuelle instauration d’une taxe carbone et d’un marché de droits à polluer. Concernant l’instauration d’une taxe carbone, il se base sur l’estimation faite par Christian Gollier du prix de la tonne de CO2 (soit 50 euros) avec un taux d’actualisation de 4% par an. Néanmoins, Claude Gamel relève lui-même deux limites majeures à cette taxe carbone. Tout d’abord, l’acceptabilité sociale qu’il solutionne par la mise en place d’un dividende carbone, c’est-à-dire en redistribuant les recettes sous la forme d’un montant identique pour tous. Puis, « les fuites de carbone », similaires aux évasion fiscales, qu’on pourrait éventuellement éviter grâce à la généralisation de cette taxe carbone au niveau mondial (trop compliquée à mettre en place).
« Cette question [écologique] est centrale aujourd’hui pour toute théorie de la justice sociale, et en particulier pour une théorie de la justice se revendiquant du libéralisme comme ici, car il n’est pas simple a priori de lutter efficacement contre le réchauffement climatique tout en accordant une prééminence aux libertés individuelles. »
Benoît Walraevens se penche sur la seconde solution proposée par Claude Gamel : celle d’un « marché mondial, unique, de droits à polluer » instauré de manière progressive. Il suggère la mise en place une « carte carbone mondiale », c’est-à-dire l’instauration d’un quota de CO2 attribué à chacun de manière individuelle. Cependant, Benoît Walraevens y voit une forme de contrôle social et donc, une menace au respect des libertés individuelles.
« Il défend l’instauration d’une carte carbone mondiale, c’est-à-dire d’un quota d’émissions égal octroyé à tous les habitants de la planète, conforme à l’idéal d’égalité en termes de justice climatique, soit une forme de « crédit universel de droits à polluer » en sus du crédit universel d’impôt que constitue le revenu de base. »
Même si l’auteur de cette recension soulève dans son argumentaire certaines limites, il rappelle que cet ouvrage ne représente finalement qu’une simple « esquisse » d’un libéralisme soutenable, ambitieuse bien que perfectible. Bien entendu, l’objectif n’est pas de modeler une société parfaite, mais plutôt de proposer des réformes radicales de notre modèle actuel afin d’atteindre un mode de fonctionnement viable, soutenable et efficace, tout en restant fidèles à nos valeurs.
« Il incombe maintenant à ses lecteurs de s’en emparer et de compléter ainsi ce nouvel horizon (libéral) des possibles que dessine l’ouvrage de Gamel. »
Pour lire la recension de l’ouvrage, cliquer ICI.
Pour (re)découvrir l’ouvrage « Esquisse d’un libéralisme soutenable », cliquer ICI.
Publié le 20/09/2023.
Dans une tribune pour La Gazette des Communes, nos experts Raul Magni-Berton, l’un des co-auteurs de notre rapport « Le pouvoir aux communes », et Ismaël Benslimane plaident pour notre « subsidiarité ascendante » afin de laisser plus de pouvoir à l’échelle locale.
Depuis les années 1980, quatre grandes réformes territoriales se sont succédé. Désormais, un cinquième chapitre de la décentralisation semble vouloir être porté par le président de la République. Mais comme l’expliquent nos experts, les réformes territoriales de nos gouvernements successifs prennent la forme de multiples propositions superfétatoires manifestant l’obsession technocratique du pouvoir par le haut.
« La prolifération ad nauseam des réformes territoriales, au point d’être devenu une forme de rite de passage pour tout gouvernement fraîchement élu, semble plutôt la marque de leur échec. »
Plus d’autonomie aux plus petits échelons : c’est ce que défend notre think tank dans sa volonté la plus profonde de décentralisation. Nous sommes convaincus que les collectivités territoriales sont les plus aptes à déterminer leurs propres besoins et nécessités. Pourtant, nos experts l’affirment : les multiples réformes n’ont servi qu’à attribuer plus de tâches aux élus locaux mais en leur retirant des responsabilités et donc, du pouvoir. Malheureusement, pour nos gouvernements, décentralisation rime avec transfert de compétences. Nos experts pointent du doigt une « recentralisation des pouvoirs associée à une décentralisation des tâches ».
« En un mot, ces réformes ont, dans le même mouvement, donné plus de travail aux élus locaux, tout en leur retirant des prérogatives. Quel comble ! »
Pour nos experts, le problème vient du manque de considération à l’égard des collectivités. Ces dernières ne sont pas assez impliquées dans le processus législatif et l’élaboration des politiques publiques, ce qui implique l’échec de ces réformes. Malheureusement en France, le pouvoir vient du haut et l’exécutif prime. Malgré la loi constitutionnelle de 2003 consacrant un principe d’expérimentation pour les collectivités qui peuvent « déroger au cadre législatif qui régit leurs compétences », pas grand chose n’a bougé. Cette proposition issue de la réforme constitutionnelle de 2003, trop complexe, n’a jamais abouti à des résultats pertinents.
« Les collectivités territoriales – même dans leur représentation nationale, par le Sénat – ont bien du mal à compter face à l’hégémonie du pouvoir exécutif. »
Nos experts dénoncent une subsidiarité jusqu’ici descendante, avec un État trop puissant qui prend les décisions que les collectivités se contentent d’appliquer. Ainsi, ils proposent de décentraliser par le principe de la subsidiarité ascendante afin que les collectivités ne subissent plus « la tutelle de Paris ». Les plus petits échelons prendront les décisions de manière plus efficace qu’à l’échelle nationale.
« Il nous faut donc renverser la vapeur, et proposer une « subsidiarité ascendante », basée sur le fait que ce sont les collectivités territoriales elles-mêmes qui doivent décider de l’échelon territorial le plus efficace pour la mise en œuvre une politique publique. »
Pour lire la tribune de nos experts, cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Le pouvoir aux communes : décentraliser par la subsidiarité ascendante », cliquer ICI.
Publié le 07/06/2023.
Dans sa chronique pour L’Opinion, notre présidente Monique Canto-Sperber défend la liberté de conscience et d’expression face au risque de « décivilisation » qui menacerait une société incapable d’assumer comme de tolérer une diversité de points de vue.
Monique commence par revenir sur le sens moderne de la liberté, définie par la délimitation d’un espace privé et totalement indépendant de pouvoirs extérieurs, qu’ils soient sociaux ou politiques, une sphère protégée où l’individu peut agir selon ses propres convictions. « Ni de droite, ni de gauche », ce principe de liberté « traverse les partages politiques » et fonde toutes les conceptions politiques.
« Pareille conception de la liberté [est] présente chez les libéraux de gauche et les anarchistes comme chez l’économiste Friedrich Hayek. »
Cette vision n’est pas celle d’un individu tout puissant dans ses caprices et ses désirs sans bornes, mais d’une liberté qui peut se déployer au sein de la société civile, garantie par l’État pour que chacun jouisse de cet espace d’autonomie.
« Le vieux rêve d’un contrôle des individus et d’une ingénierie sociale semble du reste réapparaître en version soft dans l’ambition de collecte systématique des traces laissées par les activités humaines afin de prédire nos préférences, pour nous confronter ensuite à une plausibilité statistique de nous-mêmes. »
Cette liberté peut s’exprimer de différentes manières : liberté d’expression, de conscience, d’opinion… et se dresse en rempart face aux forces sociales qui tentent de façonner et contrôler les individus à leur guise. À travers les époques et sous des manifestations différentes, de la liberté religieuse au XVIIème siècle à la Résistance, c’est donc toujours le même principe de liberté qui s’est exprimé face aux autoritarismes cherchant à créer un individu unique et uniforme.
« En procédant à cette forme d’euphémisation du monde, en amenant nos enfants à vivre dans une culture où toute trace de racisme est vouée à disparaître, nous créons une situation où ils ne pourront pas comprendre en quoi nos convictions morales d’aujourd’hui sont liées à une histoire et quelle en est la valeur. »
Aujourd’hui pourtant cette liberté est menacée : par la surveillance de masse indiscriminée ou encore la collecte systématique des données censées prédire nos comportements futurs. Surtout, elle est menacée lorsque certaines opinions sont jugées inadmissibles et inaudibles au sein d’une société, et qu’il est refusé par principe de les discuter. Selon Monique, le processus d’« euphémisation du monde » qui vise à lui retirer toute sa « rudesse » (comme modifier des occurrences racistes ou oppressives dans les écrits du passé) ne peut mener qu’à une homogénéisation de la pensée, et in fine à une société incapable d’interroger ses propres convictions ni d’être en mesure de les défendre, car incapable de les comprendre. Pour Monique, là résiderait vraiment une « décivilisation ».
« A ne tolérer que ce qui est semblable à nous, nous ne deviendrons plus qu’une société d’individus aux jugements réflexes, qui auront oublié la liberté si précieuse de délibérer en soi-même et de se faire son propre jugement. »
Pour lire la chronique de Monique, cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Pour rétablir la liberté d’expression », cliquer ICI.
Publié le 31/05/2023.
Invitée à introduire la conférence intitulée « (Re)penser le travail » organisée à l’Assemblée nationale par Aurélien Pradié (député LR du Lot), notre présidente Monique Canto-Sperber appelle à étudier la question sous un prisme plus moderne et plus libéral.
Aurélien Pradié se penche sur la place du travail dans notre société avec plusieurs collègues députés et experts. Le but est de « repenser le travail dans notre société pour aujourd’hui et pour l’avenir » en évoquant divers sujets comme l’organisation du travail, la rémunération, la formation ou encore la participation.
Notre présidente rappelle sa conviction que le travail est nécessaire à l’organisation de nos sociétés. Il s’agit d’une question clé pour l’avenir de la société, tant au niveau de la liberté que de l’autonomie des êtres humains. Monique retrace l’histoire du travail et rappelle que dès la fin des années 90, des secteurs entiers du travail salarié et des services ont été condamnés, notamment à cause de la robotisation (éducation, santé, administratif…). Une nouvelle réflexion est alors née du « grand scepticisme » à l’égard du travail. Nous avons trouvé plus de fluidité, de souplesse et d’engagement dans le travail. Tout cela nous pousse aujourd’hui encore à réinventer le travail.
« D’une certaine façon, cette prise de conscience collective sur l’importance du travail dans nos vies a été tout à fait salutaire. » – Monique Canto-Sperber
Monique observe une grande effervescence des thématiques évoquées ces dernières années. La crise sanitaire a permis de libérer l’expression de beaucoup d’aspirations. Elle s’est révélée être un moment clé, où les craintes et les inquiétudes des citoyens ont pu s’exprimer. Malheureusement, il y a aussi une forme de « désaffection » de la notion de travail, tant aux États-Unis qu’en France.
« La crise sanitaire du Covid est apparue comme un extraordinaire dispositif d’observation sur les mutations du travail. » – Monique Canto-Sperber
Les débats sur la réforme des retraites se sont focalisés sur la question de l’âge de départ, mais d’autres problématiques plus importantes en ont été écartées. Il est donc nécessaire de ramener dans le débat des questions telles que le travail des jeunes, les nouvelles formes de travail, l’auto-entrepreneuriat, le rapport entre travail et temps libre… Monique propose de donner plus de sens aux pratiques, de décider de notre manière de travailler, d’obtenir plus d’autonomie… Certaines études soulignent une baisse de la productivité des salariés sur leur lieu de travail, mais Monique estime que l’efficacité devrait s’évaluer en fonction des tâches accomplies et non pas du nombre d’heures effectuées.
« Les nouvelles formes de travail hybrides ont permis d’assouplir considérablement la notion de temps de travail. » – Monique Canto-Sperber
De son côté, dans sa chronique de la semaine pour l’Opinion, notre ancien directeur Maxime Sbaihi appelle à revaloriser le travail. Pour lui, les Français « sont plus que jamais au boulot » mais le travail ne permet plus vraiment de gagner sa vie.
Il dénonce lui aussi des débats biaisés lors de la réforme des retraites. Pour Maxime, les Français étaient contre le texte, mais pas contre le fait de travailler ! D’ailleurs, les chiffres de l’INSEE le prouvent : « Au-delà des chiffres exceptionnellement bas du chômage, qui frôlent leur meilleure performance sur trente ans, c’est la vigueur du taux d’activité qui frappe : sur la tranche de référence des 15-64 ans, il a grimpé à 74 % l’année dernière en France. »
« Ni paresseux, ni torturés, les Français sont au travail et heureux à la tâche. Ce constat doit être rétabli dans le débat public et former le point de départ de la réflexion autour du « pacte de la vie au travail » lancée par le gouvernement. » – Maxime Sbaihi
Pour regarder l’intervention de Monique à l’Assemblée Nationale, cliquer ICI.
Pour lire la chronique de Maxime, cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Travailler demain », cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « L’auto-entrepreneur, la révolution en marche », cliquer ICI.
Publié le 25/05/2023.
Avec la loi du 30 juillet 2022 « mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 », la France a connu son « jour de libération ». Depuis cette date, la quasi-totalité des restrictions aux droits et libertés fondamentales liées à la pandémie de covid-19 ont été levées.
Plus de deux ans après la début de la crise sanitaire, la France a enfin retrouvé un fonctionnement institutionnel normal. L’état d’urgence sanitaire a même disparu de notre ordre juridique. On notera, parmi les quatre mesures qui subsistent, la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et la conservation des fichiers recueillant l’identité des personnes touchées par la Covid-19 et vaccinées contre elle. Ces règles ne paraissent pas illégitimes.
Notre travail n’est néanmoins pas terminé. L’Observatoire des Libertés Confinées reste actif, prêt à être mis-à-jour si de nouvelles mesures devaient être prises. Base de données précieuse, il témoigne de l’ampleur des restrictions apportées aux libertés des Français durant la crise.
Avec son chercheur associé et juriste Vincent Delhomme, GenerationLibre démarre une nouvelle série de travaux consacrés aux libertés publiques et à leur évolution ces dernières décennies.
Pour consulter notre Observatoire des Libertés Confinées, cliquer ICI.
Publié le 16/09/2022.
Ce lundi 25 juillet, l’Opinion consacre sa Une à notre nouveau rapport, signé Monique Canto-Sperber, qui propose d’insuffler de l’autonomie dans l’éducation nationale.
Le système éducatif français à des allures de colosse aux pieds d’argile. Dans un pays qui a fait de l’éducation le premier levier de l’émancipation des citoyens, force est de constater que la mécanique est grippée. Les métiers de l’enseignement n’attirent plus, les chefs d’établissements sont sous-payés et sous-formés par rapport à leurs collègues européens et les études PISA révèlent qu’à rebours des principes assignés à l’éducation – au premier rang desquels figure l’égalité – notre système éducatif est l’un des plus inégalitaire d’Europe entre les élèves issus de milieux sociaux favorisés et défavorisés.
S’intéressant aux questions éducatives depuis plus de vingt ans, l’ancienne directrice de l’ENS s’est donnée pour mission, dans notre nouveau rapport, de briser un tabou français en posant la question de l’autonomie des établissements scolaires publics. S’il est vrai que notre culture commune est faite d’« emphase républicaine » avec un « goût prononcé pour l’égalité », l’autonomie que promeut Monique Canto-Sperber ne s’y oppose pas et vise au contraire à renforcer la dimension égalitaire de l’école républicaine. Car en réalité, un système qui se voudrait véritablement égalitaire ne se soucierait pas de défendre l’atavisme d’une pédagogie nationalement partagée mais chercherait à résorber la dégradation du niveau des élèves ainsi qu’à mettre fin à la persistance de fortes inégalités sociales.
« J’ai pris la mesure du fait que depuis vingt ans, le terme « autonomie » était présent dans la quasi- totalité des textes de lois mais sans être présenté comme un principe de l’organisation scolaire. Ces recommandations sont restées sans effet, comme si manquait la volonté politique. »
En étudiant les occurrences du principe d’autonomie dans notre histoire contemporaine de l’éducation, Monique se dit surprise d’avoir constaté que d’illustres figures politiques de la fin du XIXe siècle comme Léon Bourgeois et Jules Simon défendaient ce principe pour l’organisation scolaire du pays. Selon Monique, tous deux avaient compris la possibilité de concilier une organisation libérale de l’éducation avec le principe d’émancipation dévolu à l’école. S’il est, comme le rappelle Monique dans le rapport, du devoir de l’État de s’assurer que l’éducation soit « obligatoire, laïque et gratuite, le socle du pacte civil et la condition de l’émancipation des citoyens à l’égard de toute tutelle religieuse ou identitaire », nul besoin pour lui d’assurer directement la gestion de tous les établissements scolaires publics du pays.
Si elle salue l’expérience marseillaise d’accorder une forme d’autonomie à une soixantaine d’établissements scolaires, Monique conçoit cependant une autonomie plus élargie incluant la pédagogie. Pour l’ancienne directrice de l’ENS, l’autonomie est la clé pour résoudre la crise des vocations qui touche les métiers de l’enseignement en revalorisant la profession et en dispensant des formations régulières aux enseignants (domaine dans lequel la France figure en bas du classement des pays de l’OCDE).
« Il y aura des écoles « autonomes » publiques et d’autres restées dans le système actuel. Cela créera un peu d’émulation. Le paysage d’ensemble ne changera pas fondamentalement. »
Bien sûr, Monique anticipe les sempiternelles oppositions exprimées contre l’autonomie scolaire : marchandisation et privatisation de l’éducation, immixtion du dogmatisme religieux, anarchie pédagogique et professeurs tire-au-flanc. Comme le veut l’adage, on ne juge pas un livre à sa couverture ! Dans notre rapport, Monique étudie et analyse les politiques publiques en matière d’éducation menées dans trois pays : Suède, Angleterre et États-Unis. S’inspirant des éléments encourageants comme l’amélioration du niveau scolaire des élèves défavorisés aux États-Unis et en Angleterre, la chercheur pointe également les manqués comme la gestion de certains établissements scolaires en Suède par des acteurs privés dans le but de réaliser des profits.
En accord avec la tradition républicaine française, GenerationLibre propose de permettre aux établissements scolaires publics, de la maternelle au lycée, de s’autonomiser en nouant un contrat d’objectifs avec l’État et les collectivités territoriales. Le contrat est le texte fondateur présentant les éléments qui justifient l’autonomie, ses objectifs et sa stratégie pour y parvenir. Le contrat devra prendre en compte les spécificités sociales, économiques, démographiques, culturelles, voire linguistiques de l’environnement au sein duquel évolue l’établissement. Il s’agirait donc d’accorder une plus large autonomie de gestion, financière et pédagogique, tout en maintenant une place essentielle à l’État dans la conclusion de ces contrats, ainsi qu’à la sanction de leur non-respect.
Pour lire la Une de l’Opinion consacrée à notre rapport, cliquer ICI.
Pour lire l’entretien de Monique Canto-Sperber dans L’Opinion, cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Un contrat pour les établissements scolaires », cliquer ICI.
Publié le 27/07/2022.